|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Documents de travaux dirigés – 3ème année de Licence – Second semestre
DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama
|
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr
|
|
Université de Nantes Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama
|
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr
|
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Modalités et méthodologie
- Modalités de notation au second semestre
La note de contrôle continu s’établira sur la moyenne de 3 notes :
Lors des séances de travaux dirigés, les étudiants (environ cinq) pourront remettre leurs copies (introduction complète + plan détaillé) de manière volontaire. A défaut, il reviendra au chargé des travaux dirigés de désigner les étudiants qui devront rendre leurs travaux.
Devoir sur table : dissertation ou commentaire lors de la séance 6.
Un exposé oral en début de séance d’une durée maximale de 15 minutes structuré sous la forme d’un plan avec introduction et conclusion ouverte (choix d’un sujet parmi les thèmes mentionnés pour la fiche d’actualité). Un exemplaire du travail réalisé sera à remettre au chargé de TD la veille du passage. Tout moyen utilisé pour favoriser une présentation dynamique sera positif (power point, cartes...). Le programme des exposés devra être établi dès la séance n°2 pour établir un calendrier de passage.
Chacune des 3 notes compte pour 1/3 de la note finale de TD. La moyenne finale du contrôle continu en TD pourra être augmentée grâce à la participation (entre + 0,5 à + 1,5 point supplémentaire sur la moyenne du TD).
- Consignes pour la préparation des exposés
a. Objectif
L’objectif est d’analyser un fait d’actualité ou un thème ayant fait l’objet d’une attention particulière et de l’envisager sous l’angle du droit international public en faisant ressortir la problématique juridique.
b. Détermination du sujet et recherche de l’information
Pour réaliser cet exercice, il convient de procéder par étape et de délimiter le sujet de votre note. Il vous appartient pour cela de vous documenter et de rechercher les informations adéquates.
Vous pouvez vous aider de différents types de supports qu’il convient d’exploiter judicieusement. Aussi, si les ressources électroniques (et notamment internet) peuvent vous donner accès à des documents très récents, il convient de préciser qu’il vous appartient de porter un regard critique sur l’information disponible et de sélectionner les sites internet en fonction de leur pertinence. Par ailleurs, il est recommandé de vous appuyer sur d’autres sources comme votre cours, les manuels de droit international public, les périodiques disponibles en bibliothèque.
c. Structuration de la note
Une fois le sujet de votre note déterminé, il vous revient de structurer les informations que vous avez précédemment rassemblées. Pour cela, il vous appartient de les hiérarchiser afin de mettre en évidence le fruit de votre travail de manière concise et dynamique.
Votre exposé doit ressortir des idées essentielles de telle sorte qu’il permette de rendre compte à la fois de l’état du droit, des problèmes juridiques qui se posent (ou du fonctionnement de l’institution étudiée) et d’envisager le cas échéant les perspectives futures.
Dans la construction de votre exposé vous pourrez utiliser à la fois des indications historiques de nature à révéler l’intérêt du sujet, des données chiffrées pertinentes, annexer une cartographie évolutive ou des graphiques, etc.
d. Rédaction et modalités de notation
ATTENTION ! L’exposé est une présentation synthétique : une feuille recto verso (une tolérance d’une page de plus sera accordée).
. Il ne faut pas oublier que vous ne disposez que de 15 minutes. Donc il est conseillé de ne pas trop lire et d’expliquer un peu votre exposé.
Seront prises en considération dans l’évaluation de votre travail :
* la lisibilité (bonne présentation générale de la note et orthographe correcte)
* la clarté (style d’écriture, compréhension)
* l’originalité (personnaliser l’exposé dans le respect des consignes ; vous pouvez utiliser des images, de la couleur, etc.)
* l’exhaustivité (répondre à tous les objectifs et intégrer tous les éléments demandés)
Il vous est également demandé de préciser sous la forme de notes de bas de page à la fin de votre travail les principales sources utilisées pour l’élaboration de votre exposé, en respectant les exigences formelles de base, propres à la recherche en droit [NOM de l’auteur, Prénom de l’auteur, Titre de l’article entre guillemets, titre de l’ouvrage en italique, Edition, Ville d’édition, Année, Numéro (s) de Page (s)]. Cette bibliographie ne doit occuper qu’une part réduite de votre note d’actualité mais doit être comprise dans la page recto-verso.
L’exposé oral est d’une durée de 15 min maximum, la gestion du temps comptera également dans la notation. L’exposé devra être structuré à l’aide d’un plan équilibré. Tout support est autorisé et les documents utilisés par l’étudiant devront être envoyés la veille au chargé(e) de TD.
Le contenu de l’exposé doit correspondre aux exigences données ci-dessus. En outre, l’aptitude des étudiants à s’exprimer clairement à l’oral sera également prise en compte dans la notation.
- Liste des thèmes
Les femmes et les conflits armés
Le doit international et le droit des femmes en Iran
L’extradition en droit international public
La protection diplomatique
La guerre au Yémen
Le pavillon de l’Aquarius
La Chine et la Lune
Les déchets spatiaux
L’Ambassade des États-Unis à Jérusalem
Le retrait des troupes américaines de Syrie
Les États-Unis et le Mexique : la question du mur
Le Venezuela et le reste du monde
La cyberguerre
Le Conseil de sécurité de l’ONU face au conflit syrien
Migrations et droit de la mer
Le réfugié climatique en droit international
L’encadrement des armes nucléaires
Droit international et accès à l’eau douce
L’Antarctique et la puissance étatique
L’accord de Paris sur le climat
- Les conflits de souveraineté dans l’Arctique
- L’OMS et la protection contre les risques radioactifs
- L’utilisation des drones dans les conflits armés
- Haïti : Le statut international des victimes de catastrophes naturelles
- L’évolution des opérations de maintien de la paix
- Patrimoine mondial, patrimoine commun de l’humanité, bien public mondial, personne juridique : quelle qualification juridique pour une protection effective des ressources naturelles ?
- Partage et protection des ressources halieutiques
- La Cour pénale spéciale en Centrafrique
- Les conflits territoriaux dans la Mer des Caraïbes
- Le « crime d’agression » et la Cour Pénale Internationale
- Le rôle de l’Union européenne dans les opérations de maintien de la paix
- Droit humanitaire et justice pénale internationale
- L’enfant combattant en droit international
- Les sanctions économiques et financières dans la lutte contre le terrorisme
- La responsabilité de l’ONU pour les dommages causés lors de ses interventions
- Le CICR et les prisonniers soupçonnés de terrorisme
- Le « One Planet Summit »
- Les îles artificielles, une solution pour les réfugiés climatiques ?
- L’OMS et la gestion des crises sanitaires
Le traitement d’autres thématiques pourra éventuellement être possible après approbation du chargé(e) de TD à la séance 2.
Séance n° 1
La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Exercice :
Dissertation :
Quelles conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité sui generis de l’État ?
Documents de travail
1) CIJ, affaire de la Barcelona Traction, light and power company, limited, 5 février 1970, Extrait, para. 31 à 35
2) Projet d’articles sur la responsabilité des Etats adopté par la Commission du droit international en 1ère lecture lors de sa 48ème session (1996)
3) Extraits des commentaires et observations reçus des gouvernements, 1998, doc. A/CN.4/448, article 19, commentaire de la France pp 57-58
4) Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat provisoirement adopté par le Comité de rédaction de la Commission du droit international en seconde lecture lors de sa 52ème session (2000)
5) Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite annexé à la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 de l’Assemblée générale des Nations unies
6) Commentaires du chapitre III de la deuxième partie et de l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. 2, pp. 298-307)
7) Extraits de la Résolution adoptée par l'Assemblée générale du 12 décembre 2001 (A/RES/56/83)
8) CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 27 juin 1986 (extraits)
9) TPIY, Chambre d’appel, Affaire IT-94-1-A, Le Procureur c. Tadić (1999), Extrait, para. 137
Indications bibliographiques
- AGO(R), Nouvelles réflexions sur la codification du droit international, RGDIP, 1988, p 539.
- AGO(R), Cinquième rapport sur la responsabilité des États, le fait internationalement illicite de l’État, source de responsabilité internationale, Annuaire C.D.I 1976, vol II, 1ère p., pp 3-57
- AYISSI (J), Responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite : quel est le sort réservé au projet d'articles de la Commission du droit international ?, 28 novembre 2007, note accessible sur le site du Réseau Multipol.
- BELAICH (F), Les réactions des gouvernements au projet de la C.D.I sur la responsabilité des Etats, AFDI, 1998, pp 512-532 (accessible en ligne sur le site Persée, Portail de revues en sciences humaines et sociales)
- COMBACAU (J), SUR (S), Droit international public, 13ème édition, Paris, Editions Montchrestien, 2019, p. 521 et s.
- CONDORELLI (L), L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite: solution classiques et nouvelles tendances, RCADI, Vol VI, Tome 189, 1984, pp 9-222
- CONDORELLI (L), BOISSON DE CHAZOURNES (L), « Quelques remarques à propos de l'obligation des États de 'respecter et faire respecter' le droit international humanitaire 'en toutes circonstances », in. Swinarski (C), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1984. pp. 17-35, accessible en ligne sur le site: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:15023.
- COTTEREAU (G), « Système juridique et notion de responsabilité », in. La responsabilité dans le système international, Actes du Colloque SFDI du Mans de 1990, Paris, Pedone, 1991, pp 3-90.
- CRAWFORD (J), BODEAU (P), PEEL (J), « La seconde lecture du projet d'articles sur la responsabilité des Etats de la Commission du droit international — Evolutions ou bouleversement ? », RGDIP, 2000, pp 911-935.
- DUPUY (P-M), « Le fait générateur de la responsabilité internationale des Etats », RCADI., 1984-V, t. 188, pp. 89-134.
- DUPUY (P-M), « Quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des Etats: un bilan », RGDIP, 2003, pp 305-348
- Dupuy (P.-M.), « Observations sur le crime international de l'Etat », RGDIP, 1980, pp. 449-486.
- DUPUY (P-M), « Action publique et crime international de l'Etat — A propos de l'article 19 du projet de la Commission du Droit International sur la responsabilité des Etats », AFDI, 1979, volume 25, pp. 539-554.
- FORTEAU (M), Droit de la sécurité collective et droit de responsabilité internationale de l'Etat, Paris, Pedone, 2006, 699p.
- PELL (J), « La seconde lecture du projet d’articles sur la responsabilité des États de la Commission du droit international », RGDIP, 2000, pp.919.
- PELLET (A), « Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite: suite et fin », AFDI, 2002, pp 1-23
- PELLET (A), « Remarques sur la jurisprudence récente de la C.I.J. dans le domaine de la responsabilité internationale », in. Perspectives of international Law in the 21st Century- Perspectives du Droit International au 21ème siècle, Liber Amircorum Professor Christian Dominicé in Honour of his 80th Birthday, Martinus Nijhoff, Leiden Boston, 2012, pp. 321-345, accessible en ligne sur le site: http://www.alainpellet.eu/Documents/PELLET-2012- Mélangesoffertssà ChristianDOMINICE.pdf
- PELLET (A), « Remarques sur une révolution inachevée, le projet d'articles de la Commission du Droit international sur la responsabilité des Etats », AFDI, 1996, volume 42, pp. 7-32.
- SANTULLI (C), Travaux de la Commission du droit international (cinquante-troisième session). AFDI 2001 volume 47, pp. 349-378.
- TAVERNIER (J), « La responsabilité des Etats au regard de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise en œuvre de résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies », RGDIP 2013, vol 117, pp 101-122.
- VILLALPANDO (S), « Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l’État: interaction entre la C.D.I et la C.I.J dans la détermination des règles secondaires », AFDI, 2009, pp 39-61
Document n°1 : CIJ, affaire de la Barcelona Traction, light and power company, limited, 5 février 1970, Extrait, para. 31 à 35
31. La Cour a ainsi à examiner une série de problèmes résultant d'une relation triangulaire entre 1'Etat dont des ressortissants sont actionnaires d'une société constituée conformément aux lois d'un autre Etat sur le territoire duquel elle a son siège, 1'Etat dont des organes auraient commis contre la société des actes illicites préjudiciables tant à la société qu'à ses actionnaires, et 1'Etat selon les lois duquel la société s'est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège.
32. Cela étant, il est logique que la Cour commence par traiter ce qui a été originairement présenté comme l'objet de la troisième exception préliminaire, à savoir la question du droit de la Belgique à exercer la protection diplomatique d'actionnaires belges d'une société, personne morale constituée au Canada, alors que les mesures incriminées ont été prises à l'égard non pas de ressortissants belges mais de la société elle-même.
33. Dès lors qu'un Etat admet sur son territoire des investissements étrangers ou des ressortissants étrangers, personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement. Ces obligations ne sont toutefois ni absolues ni sans réserve. Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes.
34. Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23) ; d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel.
35. Les obligations dont la protection diplomatique a pour objet d'assurer le respect n'entrent pas dans la même catégorie (…).
Document n°2 : Projet d’articles sur la responsabilité des Etats adopté par la Commission du droit international en 1ère lecture lors de sa 48ème session (1996)
Document n°3 : Extraits des commentaires et observations reçus des gouvernements, 1998, doc. A/CN.4/448, article 19, commentaire de la France pp 57-58
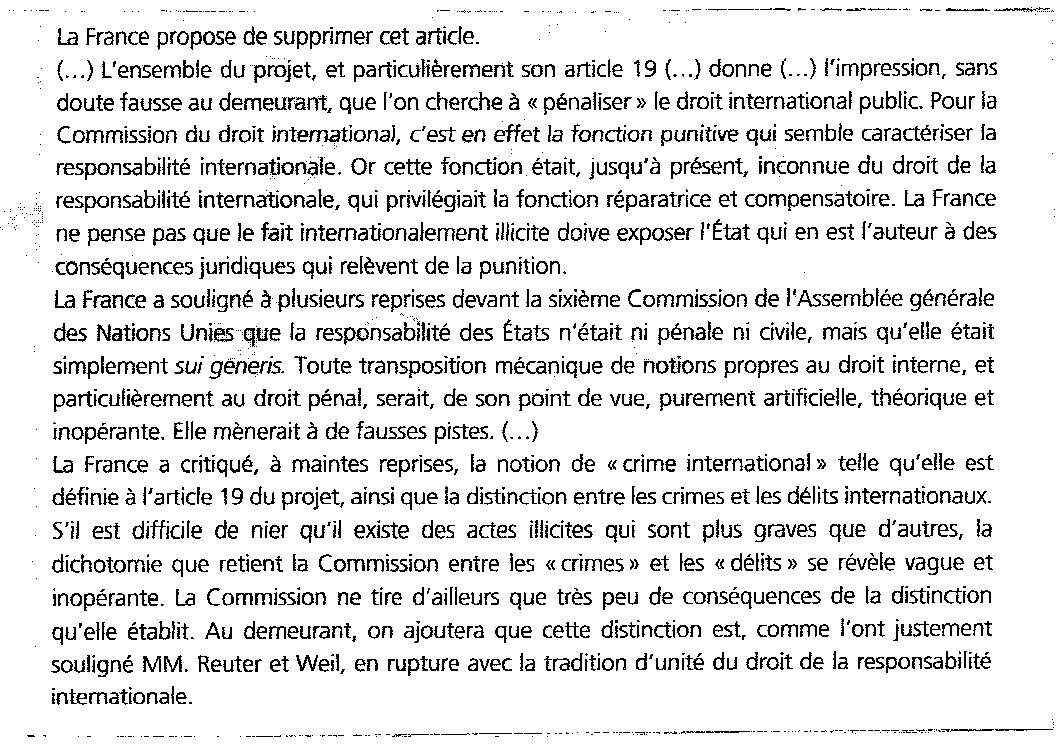
Document n°4 : Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat provisoirement adopté par le Comité de rédaction de la Commission du droit international en seconde lecture lors de sa 52ème session (2000)
Chapitre III
Violations graves d'obligations essentielles envers
la communauté internationale
Article 41
Application du présent chapitre
1. Le présent chapitre s'applique à la responsabilité internationale découlant d'un fait internationalement illicite qui constitue une violation grave par un État d'une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble et essentielle pour la protection de ses intérêts fondamentaux.
2. La violation d'une telle obligation est grave si elle dénote que l'État responsable s'est abstenu de façon flagrante ou systématique d'exécuter l'obligation, risquant de causer une atteinte substantielle aux intérêts fondamentaux protégés par celle-ci.
Article 42
Conséquences des violations graves d'obligations envers la communauté internationale dans son ensemble
1. Une violation grave au sens de l'article 41 peut entraîner pour l'État qui en est responsable l'obligation de verser des dommages-intérêts correspondant à la gravité de la violation.
2. Elle fait naître, pour tous les autres États, les obligations :
a) De ne pas reconnaître comme licite la situation créée par la violation;
b) De ne pas prêter aide ou assistance à l'État responsable pour maintenir la situation ainsi créée;
c) De coopérer autant que possible pour mettre fin à la violation.
3. Le présent article est sans préjudice des conséquences prévues au chapitre II et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner une violation à laquelle s'applique le présent chapitre.
Document n°5 : Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite annexé à la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 de l’Assemblée générale des Nations unies
CHAPITRE III
Violations graves d’obligations
découlant de normes impératives du droit international général.
Article 40 :
Application du présent chapitre
1- Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte d’une violation grave par l’Etat d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général.
2- La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’Etat responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation.
Article 41 :
Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation
en vertu du présent chapitre.
1-Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 40.
2-Aucun Etat ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.
3- Le présent article est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre (…)
Article 48 :
Invocation de la responsabilité par un Etat autre qu’un Etat lésé
1-Conformément au paragraphe 2, tout Etat autre qu’un Etat lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat, si:
a) l’obligation violée est due à un groupe d’Etats dont il fait partie, et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe; ou
b) l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble.
2- Tout Etat en droit d’invoquer la responsabilité en vertu du paragraphe 1 peut exiger de l’Etat responsable:
a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et garanties de non répétition conformément à l’article 30
b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément aux articles précédents, dans l’intérêt de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée (…)
Document n°6 : Commentaires du chapitre III de la deuxième partie et de l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. 2, pp. 298-307)
Chapitre III
Violations graves d’obligations
découlant de normes impératives du droit international général
1) Le chapitre III de la deuxième partie est intitulé «Violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général». Il porte sur certaines conséquences de violations particulières, identifiées selon deux critères: premièrement, il s’agit de violations d’obligations découlant de normes impératives du droit international général; et deuxièmement, les violations visées ont un caractère grave, de par leur échelle ou leur nature. Le chapitre III contient deux articles: le premier définit la portée de l’application du chapitre (art. 40), le second énonce les conséquences juridiques des violations qui relèvent du chapitre (art. 41).
2) La question de savoir s’il y avait lieu d’établir une distinction qualitative entre différentes violations du droit international a suscité un important débat. La Cour internationale de Justice a évoqué cette question dans l’affaire de la Barcelona Traction, lorsqu’elle a indiqué: « une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes ».
La Cour entendait confronter la situation de l’État lésé dans le contexte de la protection diplomatique avec celle de tous les États en cas de violation d’une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble. Bien qu’aucune obligation de ce type n’ait été en cause dans cette affaire, la Cour a clairement indiqué qu’aux fins de la responsabilité des États, certaines obligations sont opposables à la communauté internationale dans son ensemble, et qu’en raison de « l’importance des droits concernés», tous les États ont un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés.
3) La Cour a réaffirmé à plusieurs reprises la notion d’obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, bien qu’elle se soit montrée prudente dans l’application de ce principe. Dans l’affaire du Timor oriental, elle a considéré «qu’il n’y avait rien à redire à l’affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes ». Dans l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (exceptions préliminaires), la Cour a déclaré que «les droits et les obligations consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga omnes ». Cette constatation a contribué à sa conclusion selon laquelle sa compétence rationae temporis concernant la demande n’était pas limitée au moment à partir duquel les parties ont été liées par la Convention.
4) Un fait étroitement lié à ce qui précède est la reconnaissance de la notion de norme impérative du droit international aux articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités . Ces dispositions reconnaissent l’existence de règles de fond si essentielles qu’aucune dérogation n’y est possible, même au moyen d’un traité .
5) On s’est aperçu d’emblée que ce qui précède a des incidences sur les règles secondaires de la responsabilité des États, dont il faudrait tenir compte d’une manière ou d’une autre dans les articles. Au départ, on avait pensé se référer à la catégorie de «crimes internationaux des États», par opposition à tous les autres types de fait internationalement illicite («délits internationaux »). Cependant, on n’a pas vu se développer de conséquences pénales pour les États en cas de violation de ces normes fondamentales. Ainsi, l’allocation de dommages-intérêts punitifs n’est pas reconnue en droit international, même en cas de violations graves d’obligations découlant de normes impératives. Conformément à l’article 34, les dommages-intérêts sont essentiellement de nature compensatoire . Il n’en demeure pas moins, comme l’a indiqué le Tribunal militaire international en 1946, que:
6) En accord avec cette approche, et bien que les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo aient jugé et condamné des agents de l’État pour des crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ni l’Allemagne ni le Japon n’étaient qualifiés d’«États criminels» dans les instruments créant ces tribunaux . Dans la pratique internationale plus récente, c’est une approche analogue qui sous-tend la création des tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui a été décidée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Les deux tribunaux ont été constitués uniquement pour poursuivre des personnes . Dans sa décision relative à un subpoena duces tecum (Procureur c. Blaskić), la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a indiqué que « aux termes du droit international en vigueur, il est évident que les États, par définition, ne peuvent faire l’objet de sanctions pénales semblables à celles prévues par les systèmes pénaux internes ». De même, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, la Cour est compétente pour les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », mais sa compétence est limitée aux personnes physiques (art. 25, par. 1). Il est précisé dans le même article, qu’« aucune disposition du Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international ».
7) En conséquence, les présents articles n’établissent pas de distinction aux fins de la première partie, entre « crimes » et « délits » des États. Il doit toutefois en ressortir que les notions fondamentales de normes impératives du droit international général et d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble emportent certaines conséquences dans le cadre de la responsabilité des États. Que les normes impératives du droit international général et les obligations envers la communauté internationale dans son ensemble soient ou non des aspects différents d’un même concept, on peut dire en tout cas que ces deux notions se recoupent de façon substantielle. Les exemples d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble donnés par la Cour internationale de Justice concernent tous des obligations qui, de l’avis général, découlent de normes impératives du droit international général. De même, les exemples donnés par la Commission dans son commentaire relatif à ce qui est devenu l’article 53 de la Convention de Vienne concernent des obligations envers la communauté internationale tout entière. Cela étant, il existe à tout le moins une différence de perspective. Alors que les normes impératives du droit international général traitent de la portée d’un certain nombre d’obligations fondamentales et du rang de priorité qu’il convient de leur accorder, les obligations envers la communauté internationale dans son ensemble sont axées sur l’intérêt juridique qu’ont tous les États à leur respect, à savoir, dans le cadre du présent article, le fait qu’ils sont habilités à invoquer la responsabilité de tout autre État en cas de violation.
Par conséquent, il est bon de faire le départ entre les conséquences de l’une et de l’autre notion. Premièrement, les violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général peuvent entraîner des conséquences supplémentaires, non seulement pour l’État responsable mais pour tous les autres États. Deuxièmement, tous les États ont le droit d’invoquer la responsabilité pour la violation d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble. La première de ces propositions fait l’objet du présent chapitre ; la seconde est traitée à l’article 48.
Article 40
Application du présent chapitre
[…] Commentaire
1) L’article 40 a pour objet de définir les violations couvertes par le chapitre. Il établit deux critères permettant de distinguer « les violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général » des autres types de violation. Le premier critère a trait à la nature de l’obligation violée, qui doit découler d’une norme impérative du droit international général. Le second porte sur l’intensité de la violation, qui doit avoir un caractère grave. Le chapitre III ne s’applique qu’aux violations du droit international qui satisfont à ces deux critères.
2) Le premier critère a donc trait à la nature de l’obligation violée. Pour que le présent chapitre s’applique, la violation doit concerner une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. Conformément à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités , une norme impérative du droit international général est « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». La notion de « norme impérative du droit international général » est reconnue dans la pratique internationale, dans la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux et internationaux, ainsi que dans la doctrine .
3) Il n’y a pas lieu de donner des exemples de normes impératives dans le texte même de l’article 40 ; il n’y en a d’ailleurs aucun dans le texte de l’article 53 de la Convention de Vienne. Les obligations visées à l’article 40 découlant des règles de fond qui interdisent des comportements considérés comme intolérables en raison de la menace qu’ils représentent pour la survie des États et de leurs peuples, ainsi que pour les valeurs humaines fondamentales.
4) Parmi ces interdictions, on considère généralement que l’interdiction de l’agression est une norme impérative, ce qu’étaient, par exemple, le commentaire de la Commission relatif à ce qui est devenu l’article 53 , les déclarations non démenties faites par les gouvernements au cours de la Conférence de Vienne , les communications des deux parties dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires et la position adoptée par la Cour dans cette affaire . Les autres exemples énumérés par la Commission dans le commentaire relatif à l’article 53, à savoir les interdictions relatives à l’esclavage et à la traite des esclaves, ou au génocide, ainsi qu’à la discrimination raciale et à l’apartheid, semblent eux aussi recueillir une large adhésion. Ces pratiques sont interdites en vertu de conventions et de traités internationaux qui ont été ratifiés par un grand nombre d’États et n’admettent aucune exception. Lors de la Conférence de Vienne, les gouvernements se sont entendus sur le caractère impératif de ces interdictions. Quant à l’interdiction du génocide, son caractère impératif est étayé par plusieurs décisions judiciaires nationales et internationales .
5) Bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans le commentaire de la Commission relatif à l’article 53 de la Convention de Vienne, le caractère impératif de certaines autres normes semble recueillir l’adhésion générale. C’est le cas de l’interdiction de la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 . Le caractère impératif de cette interdiction a été confirmé par les décisions d’organes tant internationaux que nationaux . Au vu de ce que la Cour internationale de Justice a dit des règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés qui ont un caractère « intransgressible », il semblerait aussi justifié de les considérer comme impératives . Enfin, l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination mérite d’être mentionnée. Comme la Cour internationale de Justice l’a noté dans l’affaire du Timor oriental, « le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est l’un des principes essentiels du droit international contemporain », qui donne naissance à une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, qui est tenue d’en autoriser et d’en respecter l’exercice .
6) Il convient de souligner que la liste d’exemples susmentionnée n’est peut-être pas exhaustive. De plus, l’article 64 de la Convention de Vienne prévoit la survenance de nouvelles normes impératives du droit international général, pour autant qu’il s’agisse de normes acceptées et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble, comme en dispose l’article 53. Les exemples donnés sont donc sans préjudice des règles existantes ou en formation du droit international qui satisfont aux critères prévus à l’article 53.
7) Outre qu’il a une portée limitée en raison du nombre relativement restreint de normes impératives, l’article 40 prévoit une autre restriction aux fins du chapitre, à savoir que la violation doit avoir été « grave ». Les violations « graves » sont définies au paragraphe 2 comme
Dénotant «de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation ». Le mot « grave » signifie qu’un certain ordre de grandeur est requis, mais il ne doit pas être interprété comme signifiant que certaines violations ne sont pas graves ou qu’elles sont en quelque sorte excusables. Il reste que l’on peut envisager des violations de normes impératives relativement moins graves et qu’il est nécessaire de limiter la portée du chapitre aux violations les plus graves ou systématiques. La pratique des États étaie dans une certaine mesure une telle restriction. Ainsi, lorsqu’ils réagissent contre des violations du droit international, les États soulignent souvent leur caractère systématique, flagrant ou répété. De même, les procédures de plaintes internationales, par exemple dans le domaine des droits de l’homme, attachent des conséquences différentes aux violations systématiques, notamment en ce qui concerne la non-applicabilité de la règle de l’épuisement des recours internes .
8) Pour être considérée comme systématique, une violation doit avoir été commise de façon organisée et délibérée. En revanche, le terme « flagrante » renvoie à l’intensité de la violation ou de ses effets ; il dénote des violations manifestes qui représentent une attaque directe contre les valeurs protégées par la règle. Les termes ne sont pas mutuellement exclusifs ; les violations graves sont généralement à la fois systématiques et flagrantes. Au nombre des facteurs pouvant déterminer la gravité d’une violation, on citera l’intention de violer la norme ; l’étendue et le nombre des violations en cause et la gravité de leurs conséquences pour les victimes. De plus, certaines des normes impératives en question, en particulier les interdictions d’agression et de génocide, requièrent, de par leur nature même, une violation intentionnelle commise à large échelle .
9) L’article 40 ne prévoit pas de procédure visant à déterminer si une violation grave a été ou non commise. Les articles n’ont pas pour objet d’établir de nouvelles procédures institutionnelles applicables à des cas particuliers, que ceux-ci relèvent ou non du chapitre III de la deuxième partie. De plus, les violations graves dont il est question dans le présent chapitre seront probablement traitées par les organisations internationales compétentes, dont le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. En cas d’agression, le Conseil de sécurité est investi d’un rôle spécifique, qui lui est conféré par la Charte.
Document n°7 : Extraits de la Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 12 décembre 2001 (A/RES/56/83)
56/83. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
L’Assemblée générale,
Ayant examiné le chapitre IV du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session1, qui contient le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,
Notant que la Commission du droit international a décidé de lui recommander de prendre acte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dans une résolution et d’annexer le projet d’articles à ladite résolution, ainsi que d’envisager la possibilité, à un stade ultérieur et compte tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour examiner le projet d’articles en vue de la conclusion d’une convention sur le sujet,
Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif du droit international et sa codification que prévoit l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies,
Notant que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est d’une importance capitale pour les relations entre États,
1. Note avec satisfaction que la Commission du droit international a achevé ses travaux sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et qu’elle a adopté en cette matière un projet d’articles assorti d’un commentaire détaillé ;
2. Rend hommage à la Commission du droit international pour la contribution qu’elle continue d’apporter à la codification et au développement progressif du droit international ;
3. Prend note des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite présentés par la Commission du droit international, dont le texte figure en annexe à la présente résolution, et les recommande à l’attention des gouvernements, sans préjudice de leur adoption éventuelle ou de toute autre mesure appropriée ;
4. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-neuvième session une question intitulée « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ».
85e séance plénière
12 décembre 2001
Annexe
Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
PREMIERE PARTIE
LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ETAT
Chapitre premier
Principes généraux
Article premier
Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite
Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale.
Article 2
Éléments du fait internationalement illicite de l’État
Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission :
a) Est attribuable à l’État en vertu du droit international ; et
b) Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.
Article 3
Qualification du fait de l’État comme internationalement illicite
La qualification du fait de l’État comme internationalement illicite relève du droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite par le droit interne.
Document 8 : CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 27 juin 1986 (extraits)
La Cour doit déterminer si, en raison des liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis, il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement. La Cour estime que les éléments dont elle dispose ne suffisent pas à démontrer la totale dépendance des contras par rapport à l'aide des Etats-Unis. Une dépendance partielle, dont la Cour ne saurait établir le degré exact, peut se déduire du phénomène de sélection des dirigeants par les Etats-Unis mais aussi d'autres éléments tels que l’organisation, l'équipement de la force, la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien fourni. Il n'est donc pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait sur les contras une autorité́ telle qu'on considérer que ces derniers agissent en leur nom.
La cour ayant abouti à la constatation qui précède, elle estime que les contras demeurent responsables de leurs actes, notamment des violations du droit humanitaire qu'ils auraient commises. Pour que la responsabilité́ juridique des Etats-Unis soit engagée, il devrait être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des 0pération~durant lesquelles les violations en question se seraient produites.
Document 9 : TPIY, Chambre d’appel, Affaire IT-94-1-A, Le Procureur c. Tadić (1999), Extrait, para. 137
En somme, lorsqu’il s’agit de déterminer si un individu auquel la législation interne ne confère pas le statut d’agent de l’État peut être considéré́ comme un organe de fait de cet État, la Chambre d’appel est d’avis que les règles de droit international n’exigent pas toujours le même degré de contrôle sur cet individu que sur des membres de groupes armés. Le degré́ de contrôle requis peut, en effet, varier. Lorsque se pose la question de savoir si un particulier isolé ou un groupe qui n’est pas militairement organisé a commis un acte en qualité́ d’organe de fait d’un État, il est nécessaire de déterminer si ce dernier lui a donné des instructions spécifiques pour commettre ledit acte. À défaut, il convient d’établir si l’acte illicite a été a posteriori publiquement avalisé ou approuvé par l’État en question. En revanche, le contrôle exercé par un État sur des forces armées, des milices ou des unités paramilitaires subordonnées peut revêtir un caractère global (mais doit aller au-delà de la simple aide financière, fourniture d’équipements militaires ou formation). Cette condition ne va toutefois pas jusqu’à inclure l’émission d’ordres spécifiques par l’État ou sa direction de chaque opération. Le droit international n’exige nullement que les autorités exerçant le contrôle planifient toutes les opérations des unités qui dépendent d’elles, qu’elles choisissent leurs cibles ou leur donnent des instructions spécifiques concernant la conduite d’opérations militaires ou toutes violations présumées du droit international humanitaire. Le degré de contrôle requis en droit international peut être considèré comme avèré lorsqu’un État (ou, dans le contexte d’un conflit armé, une Partie au conflit) joue un rôle dans l’organisation, la coordination ou la planification des actions militaires du groupe militaire, en plus de le financer, l’entraîner, l’équiper ou lui apporter son soutien opérationnel. Les actes commis par ce groupe ou par ses membres peuvent dès lors être assimilés à des actes d’organes de fait de l’État, que ce dernier ait ou non donné des instructions particulières pour la perpétration de chacun d’eux.
|
Nantes UNIverSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama |
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr
|
|
|
|
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC général
Séance n° 2
LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES
Exercice
Commentaire : Article 15 de la Convention de Montego-Bay (1982)
Documents de travail :
1) Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), opinion individuelle de M. Jessup, CIJ Recueil, 1969, p. 67
2) Article 6 de la Convention de Genève sur le Plateau Continental du 29 avril 1958
3) Articles 15, 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982
4) CIJ, Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal)
5) CIJ, arrêt du 16 mars 2001, Délimitation et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, (Qatar c. Bahreïn), CIJ Recueil, 2001, p. 40, §§. 166-177
6) CIJ, arrêt du 8 octobre 2007, Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), extraits §. 277, §§. 280-282, §.287 et §§. 302-304.
7) CIJ, arrêt du 3 février 2009, Affaire de la délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), extrait §§. 119-122.
8) Tribunal international de la mer, 14 mars 2012, Affaire du différend concernant la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe de Bengale.
9) Cour Internationale de Justice, Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), 2 février 2018 (Extraits)
10) Extraits de l’opinion individuelle de M. le juge Abraham, jointe à l’arrêt de la CIJ du 19 novembre 2012, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
11) CIJ, arrêt du 17 mars 2016, Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombies), Exceptions préliminaires, extraits
12) CIJ, arrêt du 17 mars 2016, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 miles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), Exceptions préliminaires (Extraits)
13) CIJ, arrêt du 3 juin 1985, Affaire du plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), CIJ Recueil, 1985, §. 50 (extrait)
14) CIJ, arrêt du 10 octobre 2002, Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)), §. 304 (extrait)
15) Igor Gauquelin (2016). Mer de Chine : Comprendre l’arbitrage de la Haye [En ligne] www.asialyst.com, 15.07.2016
16) Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l'océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), TIDM Affaire No. 23, 23 Septembre 2017
17) Christophe Prazuck, « Mer de Chine et droit de la mer : le paradoxe chinois » Lettre du Centre Asie, Ifri, 7 mai 2021
Indications bibliographiques :
BELLAYER ROILLE (A), Les enjeux politiques autour des frontières maritimes, CERISCOPE Frontières, 2011 : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/les-enjeux-politiques-autour-des-frontieres-maritimes
CAZALA (J.), « Retour sur les méthodes de délimitation juridictionnelle d’espaces maritimes mises en œuvre dans quelques affaires récentes », A.F.D.I., 2008, pp. 411-427
CHAUMETTE (P.) (dir), Droits maritimes, Dalloz Action, 4ème édition 2021-2022.
COMBACAU (J), Le droit de la mer, PUF, collection « Que sais-je ? » 1985.
DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A), MIRON (A), NGU (QD), Droit international public, 9ème édition, LGDJ, Paris, 2022.
GALLEY (J.B.), « Le juge en quête d’unité de régime juridique en matière de délimitation maritime », Revue de la recherche juridique : Droit prospectif, 2006, pp. 953-985.
KOLB (R.), « Case Law on equitable maritime delimitation, Jurisprudence sur les délimitations maritimes équitables », Martinus Nijhoff Publishers, 2003
LABRECQUE (G), Les frontières maritimes internationales, Editions Harmattan 1998
LUCCHINI (L), « Le juge et l’équidistance : sense or sensibility ? », in. L’Etat souverain dans le monde d’aujourd’hui, Mélanges en l’honneur de J-P Puissochet, Paris, Pedone, 2008 pp 175-18.
MAHINGA (J-G), Le Tribunal international du droit de la mer, Larcier 2013, 378 p.
PANCRACIO (J.P), Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, 536 p.
VINCENT (P), Droit de la mer, Larcier, 2008, 292 p.
Annuaire du Droit de la Mer publié par l’Institut du droit économique de la mer (depuis 1995), Pedone
Annuaire de Droit Maritime et Océanique de Nantes (depuis 1980), Pedone
Site du Tribunal International du Droit de la Mer : https://www.itlos.org/
Site Institut du Droit économique de la Mer : http://www.indemer.org/
Sur l’affaire Bahrein c. Qatar
DECAUX (E), « Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn », fond. Arrêt du 16 mars 2001 (Qatar c. Bahreïn), AFDI, 2001, pp. 177-241
DISTEFANO (G.), « L’arrêt de la C .I.J. du 16 mars 2001 dans l’affaire de la délimitation entre Qatar et Bahreïn » ; R.B.D.I., pp. 357-410
KOHEN (M.), « Les questions territoriales dans l’arrêt de la C.I.J. du 16 mars 2001 en l’affaire Qatar c. Bahreïn », R.G.D.I.P. 2002, pp. 295-328
PASTOR PALOMA (A.), » La qualification juridique des formations maritimes dans l’arrêt du 16 mars 2001 », R.G.D.I.P., 2002, pp 329-356
Sur l’affaire Nicaragua c. Honduras
KIRK (E.A.), “Case concerning territorial and maritime dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea, International and Comparative Law Quarterly”, vol. 57, 2008, pp. 701-709
LATHROP COALTER (G.), “Territorial and maritime dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua V. Honduras)”, American journal of International Law, vol. 102, 2008, pp. 113-119
ROS (N.), « L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 8 octobre 2007 en l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes », Annuaire du droit de la mer, 2007, pp. 9-64
Sur l’affaire Roumanie c. Ukraine
MAHINGA (J.-G.), « La délimitation de la frontière maritime entre la Roumanie et la mer Noire », JDI, vol.4, 2010, pp.1157-1195
WECKEL (P.), « Délimitation maritime en mer Noire », RGDIP, 113-2, 2009, pp. 431-439
Document n° 1 : Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), opinion individuelle de M. Jessup, CIJ Recueil, 1969, p. 67
Pour des raisons qui n'ont pas été divulguées pleinement mais que l'on peut soupçonner, les Parties ont jugé bon de ne parler qu'indirectement, dans leurs écritures ou plaidoiries, de leurs intérêts réels et fondamentaux concernant le plateau continental de la mer du Nord, mais il est évident que la raison pour laquelle elles attachent tant d'importance à la délimitation de leurs zones respectives est l'existence connue ou probable de gisements de pétrole et de gaz naturel sous le lit de la mer
Document n° 2 : Article 6 de la Convention de Genève sur le Plateau Continental du 29 avril 1958
Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
Dans le cas où même le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément aux principes mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article devrait être fait mention de points de repères fixes et permanents à terre.
Document n° 3 : Extraits de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay- Jamaïque)
Article 15 : Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face
Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titre historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.
Article 74 : Délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face
1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.
2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.
3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.
4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.
Article 83 Délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face
La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé par l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, afin d’aboutir à une solution équitable.
S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.
En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concerné, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.
Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.
Document n°4 : extraits de l’arrêt du 16 mars 2001, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)
166. La Cour passera maintenant à l'examen de la question de la délimitation maritime.
167. Les Parties conviennent que la Cour doit se prononcer sur la délimitation maritime conformément au droit international. Ni Bahreïn ni Qatar ne sont parties aux conventions de Genève sur le droit de la mer du 29 avril 1958 ; Bahreïn a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, mais Qatar l'a seulement signée. En conséquence, c'est le droit international coutumier qui est le droit applicable. Cela étant, les deux Parties reconnaissent que la plupart des dispositions de la convention de 1982 qui sont pertinentes en l'espèce reflètent le droit coutumier.
168. Aux termes de la « formule Bahreïnite », adoptée en décembre1990, (voir les paragraphes 67 et 69 ci-dessus), les Parties ont prié la Cour «de tracer une limite maritime unique entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux sur jacentes ». Dans ses conclusions finales, qui sont identiques aux conclusions qu'il a présentées dans la procédure écrite, Qatar a prié la Cour de « tracer une limite maritime unique entre les espaces maritimes comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux sur jacentes qui relèvent respectivement de1'Etat de Qatar et de l'Etat de Bahreïn ... ». Bahreïn, pour sa part, a demandé à la Cour de dire et juger que «la limite maritime entre Bahreïn et Qatar est celle décrite dans la deuxième partie du mémoire de Bahreïn ». Il ressort de ce mémoire et des cartes qui lui sont annexées que Bahreïn demande, lui aussi, à la Cour de tracer une limite maritime unique. Les deux Parties ont ainsi prié la Cour de tracer une limite maritime unique (voir ci-après, p. 92, croquis no 2).
(…)
173. La Cour observe que le concept de limite maritime unique n'est pas issu du droit conventionnel multilatéral mais de la pratique étatique et qu'il s'explique par le vœu des Etats d'établir une limite ininterrompue unique délimitant les différentes zones maritimes - coïncidant partiellement- qui relèvent de leur juridiction. Dans le cas de zones de juridiction qui coïncident, la détermination d'une ligne unique pour les différents objets de la délimitation « ne saurait être effectuée que par l'application d'un critère ou d'une combinaison de critères qui ne favorise pas l'un de ces ... objets au détriment de l'autre et soit en même temps susceptible de convenir également à une division de chacun d'eux », comme l'a relevé la Chambre constituée par la Cour dans l'affaire du Golfe du Maine (C. I. J. Recueil 1984, p. 327, par. 194). Dans cette affaire, il avait été demandé à la Chambre de tracer une ligne unique valant à la fois pour le plateau continental et la colonne d'eau sur jacente.
174. La délimitation des mers territoriales ne soulève pas de problèmes de ce genre car les droits de 1'Etat côtier dans la zone concernée ne sont pas fonctionnels mais territoriaux et impliquent souveraineté sur le fond de lamer, les eaux sur jacentes et l'espace aérien sur jacent. La Cour, pour s'acquitter de cet aspect de sa tâche, doit donc appliquer d'abord et avant tout les principes et règles du droit international coutumier qui ont trait à la délimitation de la mer territoriale, sans oublier que sa tâche ultime consiste à tracer une limite maritime unique qui soit valable aussi à d'autres fins.
175. Les Parties conviennent que les dispositions de l'article 15 de la convention de 1982 sur le droit de la mer qui est intitulé « Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face» font partie du droit coutumier. Cet article dispose: « Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces Etats n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats. »
176. L'article 15 de la convention de 1982 est pratiquement identique au paragraphe 1 de l'article 12 de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, et doit être regardé comme possédant un caractère coutumier. Il y est souvent fait référence comme à la règle «équidistance/circonstances spéciales». La méthode la plus logique et la plus largement pratiquée consiste à tracer d'abord à titre provisoire une ligne d'équidistance et à examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l'existence de circonstances spéciales. Une fois qu'elle aura délimité sur cette base les mers territoriales des Parties, la Cour déterminera quels sont les règles et principes du droit coutumier à appliquer pour la délimitation de leurs plateaux continentaux et de leurs zones économiques exclusives ou de leurs zones de pêche. La Cour décidera alors si la méthode à retenir pour opérer cette délimitation est similaire à celle qui vient d'être décrite ou si elle est différente.
177. La ligne d'équidistance est la ligne dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats est mesurée. Elle ne peut être tracée que lorsque les lignes de base sont connues. Ni l'une ni l'autre des Parties n'a encore précisé quelles sont les lignes de base qui doivent être utilisées aux fins de la détermination de la largeur de leur mer territoriale; elles n'ont pas davantage produit de cartes ou de cartes marines officielles où figuraient de telles lignes de base. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure qu'elles ont fourni à la Cour des points de base approximatifs que la Cour pourrait, à leur avis, utiliser pour déterminer la limite maritime.
Document n°5 : Affaire du différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) du 8 octobre 2007 (extraits).
277. La Cour relève d’emblée que les Parties ont l’une et l’autre fait valoir un certain nombre de considérations géographiques et juridiques au sujet de la méthode qu’elle devrait appliquer pour effectuer la délimitation maritime. Le cap Gracias a Dios, où prend fin la frontière terrestre entre le Nicaragua et le Honduras, est une projection territoriale très convexe touchant à un littoral concave de part et d’autre, au nord et au sud-ouest. Compte tenu de l’article 15 de la CNUDM, et étant donné la configuration géographique décrite ci-dessus, les deux points de base à situer sur l’une et l’autre rives du fleuve Coco, à l’extrémité du cap, auraient une importance critique dans le tracé d’une ligne d’équidistance, en particulier à mesure que celle-ci s’éloignerait vers le large. Ces points de base devant être très proches l’un de l’autre, la moindre variation ou erreur dans leur emplacement s’amplifierait de manière disproportionnée lors de ce tracé. Les Parties conviennent en outre que les sédiments charriés et déposés en mer par le fleuve Coco confèrent un morphodynamisme marqué à son delta, ainsi qu’au littoral au nord et au sud du cap. Aussi l’accrétion continue du cap risquerait-elle de rendre arbitraire et déraisonnable dans un avenir proche toute ligne d’équidistance qui serait tracée aujourd’hui de cette façon.
(…)
280. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente espèce, la Cour se trouve dans l’impossibilité de définir des points de base et de construire une ligne d’équidistance provisoire pour établir la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes au large des côtes continentales des Parties. Même si les particularités déjà évoquées ne permettent pas de tracer une ligne d’équidistance en tant que frontière maritime unique, la Cour doit cependant déterminer si, pour son segment traversant les mers territoriales, la ligne frontière pourrait commencer comme une ligne d’équidistance au sens de l’article 15 de la CNUDM. L’on pourrait faire valoir que, si les saillies de part et d’autre du cap Gracias a Dios étaient utilisées comme points de base, les problèmes liés à la distorsion se poseraient avec moins d’acuité à proximité de la côte (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 17-18).Cela étant, la Cour fait tout d’abord observer que les Parties sont en désaccord quant au titre sur les îles instables qui se sont formées dans l’embouchure du fleuve Coco et dont les Parties avaient laissé entendre, au cours de la procédure orale, qu’elles pourraient servir de points de base. Il est rappelé que, en raison des caractéristiques changeantes de cette zone, la Cour ne s’est pas prononcée sur l’attribution de la souveraineté sur ces îles (voir paragraphe 145 ci dessus). En outre, quels que soient les points de base qui seraient utilisés pour le tracé d’une ligne d’équidistance, la configuration et la nature instable des côtes pertinentes, y compris les îles en litige qui se sont formées dans l’embouchure du fleuve Coco, rendraient en peu de temps incertains ces points de base (qu’ils soient situés au cap Gracias a Dios ou ailleurs).L’article 15 de la CNUDM envisage lui-même la possibilité de déroger au principe du tracé d’une ligne médiane, à savoir lorsque «l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales» le rend nécessaire. Rien dans l’énoncé de l’article 15 ne permet de conclure que des problèmes géomorphologiques ne sauraient en tant que tels constituer des «circonstances spéciales» au sens de cette exception, ni que de telles «circonstances spéciales» ne puissent être invoquées (comme à l’égard des «circonstances pertinentes» aux articles 74 et 83) que pour corriger une ligne déjà tracée. Cette dernière hypothèse serait d’ailleurs en nette contradiction avec le libellé de l’exception décrite à l’article 15. Il est rappelé que l’article 15 de la CNUDM, qui a été adopté sans que la question de la méthode de délimitation de la mer territoriale n’ait donné lieu à débat, est pratiquement identique (quelques modifications d’ordre rédactionnel mises à part) au texte du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958.La genèse du texte de l’article 12 de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë montre que la possibilité de recourir à une méthode différente en cas de configuration spéciale de la côte fut effectivement évoquée (voir Annuaire de la Commission du droit international (Annuaire de la CDI), 1952, vol. II, p. 38, commentaire, par. 4). Le traitement qui fut en 1956 réservé à cette question vient d’ailleurs le confirmer. Les termes de l’exception à la règle générale demeurèrent les mêmes (voir Annuaire de la CDI, 1956, vol. I, p. 306 ; vol. II, p. 271,272, et p. 300 où le commentaire du projet d’articles relatifs au plateau continental relève que«comme pour [les] mers [territoriales], il doit être prévu qu’on peut s’écarter de la règle lorsqu’une configuration exceptionnelle de la côte … l’exige»). On ne trouve pas davantage, dans la jurisprudence de la Cour, d’éléments qui fondent une interprétation allant à l’encontre du sens ordinaire des termes de l’article 15 de la CNUDM. Cette question ne s’est jusqu’à ce jour jamais directement posée. La Cour relève toutefois que, dans certains cas, la ligne d’équidistance n’a pas été utilisée aux fins de la délimitation de la mer territoriale, soit pour des raisons très particulières (voir Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J.Recueil 1982, p. 85,par. 121, affaire dans laquelle la Cour est partie d’une ligne de convergence entre les concessions accordées par chaque Partie et l’a traduite en une ligne tracée à partir d’un point fixé en mer jusqu’au point terminal de la frontière terrestre), soit en raison de l’effet défavorable de certaines configurations côtières (affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, RSA, vol. XIX, p. 187, par. 104).
281. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour se trouve dans le cas de l’exception prévue à l’article 15 de la CNUDM, c’est-à-dire face à des circonstances spéciales qui ne lui permettent pas d’appliquer le principe de l’équidistance. Ce dernier n’en demeure pas moins la règle générale.
282. La Cour relève que, dans la présente espèce, les deux Parties ont l’une et l’autre envisagé pour la délimitation de la mer territoriale d’autres méthodes que celle consistant à tracer une ligne d’équidistance. […]
287. La Cour examinera donc la question de savoir si, en principe, la délimitation pourrait être basée sur la bissectrice de l’angle formé par des lignes représentant les côtes continentales pertinentes. Elle examinera ensuite l’incidence des mers territoriales des îles. Le recours à une bissectrice - la ligne qui divise en deux parts égales l’angle formé par des lignes représentant la direction générale des côtes - s’est avéré être une méthode de remplacement valable dans certaines circonstances où il n’est pas possible ou approprié d’utiliser la méthode de l’équidistance. C’est la configuration des façades côtières pertinentes et des zones maritimes à délimiter ainsi que les rapports entre ces éléments qui justifient le recours à la méthode de la bissectrice en matière de délimitation maritime. Toutefois, lorsque, comme en la présente espèce, tous les points de base que la Cour pourrait déterminer sont par définition instables, la méthode de la bissectrice peut être considérée comme une approximation de celle de l’équidistance. Tout comme celle de l’équidistance, la méthode de la bissectrice est une approche géométrique qui peut être utilisée pour donner un effet juridique au«critère à propos duquel l’équité est de longue date considérée comme un caractère rejoignant la simplicité : à savoir le critère qui consiste à viser en principe — en tenant compte des circonstances spéciales de l’espèce — à une division par parts égales des zones de convergence et de chevauchement des projections marines des côtes des Etats…» (Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 195).
288. Tel était le cas en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), où la méthode de l’équidistance ne pouvait pas être appliquée au deuxième segment de la délimitation parce que le point de départ de ce segment ne se situait sur aucune des lignes d’équidistance possibles. Dans cette affaire, la Cour utilisa une bissectrice pour refléter l’infléchissement vers le nord de la côte tunisienne à partir du golfe de Gabès (C.I.J. Recueil 1982,- 79 -p. 94, par. 133, point C 3)). En l’affaire du Golfe du Maine, la Chambre de la Cour utilisa également la bissectrice de l’angle formé par les côtes continentales du golfe, parce qu’elle estimait que les petites îles situées dans le golfe ne pouvaient pas convenir comme points de base et que le premier segment de la délimitation devait partir du «point A», lequel n’était pas non plus situé sur une ligne d’équidistance. Dans la sentence rendue en 1985 en l’affaire de la Délimitation maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, le tribunal arbitral traça la perpendiculaire (la bissectrice d’un angle de 180o) d’une droite joignant la pointe des Almadies (Sénégal) au cap Shilling (Sierra Leone) pour représenter la direction générale de la côte de «l’ensemble de la région de l’Afrique occidentale». Le tribunal estima nécessaire de choisir cette approche plutôt que celle de l’équidistance pour parvenir à une délimitation équitable qui devait «s’int[égrer] aux délimitations actuelles ou futures de la région» (RSA, vol. XIX, p. 189, par. 108).
289. Pour que sa méthode de délimitation «respecte la situation géographique réelle» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 45, par. 57), la Cour devrait rechercher une solution en déterminant d’abord ce que sont les «côtes pertinentes» des Etats (voir Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 178 ; voir aussi Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J.Recueil 2002, p. 442, par. 90). La détermination de la géographie côtière pertinente nécessite une appréciation réfléchie de la géographie côtière réelle. La méthode de l’équidistance exprime la relation entre les côtes pertinentes des deux Parties en prenant en compte les relations existantes entre des paires de points choisis comme points de base. La méthode de la bissectrice tend elle aussi à exprimer les relations côtières pertinentes, mais elle le fait sur la base de la macro géographie d’un littoral représenté par une droite joignant deux points sur la côte. Aussi, en cas de recours à la méthode de la bissectrice, faut-il veiller à ne pas « refaire la nature entièrement » (Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 91). […]
302. La Cour relève que, en vertu de l’article 3 de la CNUDM, le Honduras a le droit de fixer à 12 milles marins la largeur de sa mer territoriale, tant pour son territoire continental que pour les îles relevant de sa souveraineté. Le Honduras demande en l’espèce, pour les quatre îles en cause, une mer territoriale de 12 milles marins. La Cour estime donc que, sous réserve d’éventuels chevauchements entre les mers territoriales situées respectivement autour d’îles honduriennes et d’îles nicaraguayennes se trouvant alentour, Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay doivent se voir accorder une mer territoriale de 12 milles marins.
303. Une mer territoriale d’une largeur de 12 milles ayant été accordée aux îles de Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay (Honduras) et à l’île d’Edinburgh Cay (Nicaragua), il est évident que les mers territoriales du Nicaragua et du Honduras sont appelées à se chevaucher dans cette région tant au sud qu’au nord du 15e parallèle. Ici encore, la Cour répétera son observation sur les méthodes de délimitation :« La méthode la plus logique et la plus largement pratiquée consiste à tracer d’abord à titre provisoire une ligne d’équidistance et à examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l’existence de circonstances spéciales. » (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 176)
304. Le tracé d’une ligne d’équidistance provisoire entre les îles qui se font face aux fins de la délimitation de la mer territoriale ne présente pas les mêmes difficultés que celui d’une ligne d’équidistance à partir du continent. Les Parties ont fourni à la Cour les coordonnées des quatre îles en litige au nord du 15e parallèle et d’Edinburgh Cay au sud de ce parallèle. Il est possible de délimiter de façon satisfaisante cette zone relativement réduite en traçant une ligne d’équidistance provisoire prenant les coordonnées de ces îles comme points de base de leur mer territoriale dans les zones de chevauchement, entre les mers territoriales de Bobel Cay, Port Royal Cay et South Cay (Honduras), d’une part, et celle d’Edinburgh Cay (Nicaragua), d’autre part. Il n’y a pas de chevauchement entre la mer territoriale de Savanna Cay (Honduras) et celle d’Edinburgh Cay. La Cour considère qu’il n’existe pas, dans cette zone, de « circonstances spéciales» juridiquement pertinentes justifiant l’ajustement de cette ligne provisoire.
Document n° 6 : CIJ, arrêt du 3 février 2009, affaire relative à la délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (extraits)
En la présente affaire, la Cour commencera donc par tracer une ligne d’équidistance provisoire entre les côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine, qui se prolongera par une ligne médiane entre leurs côtes se faisant face.
§120- Le tracé de la ligne finale doit aboutir à une solution équitable (article 74 et 83 de la CNUDM). La cour examinera donc, lors de la deuxième phase, s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt, CIJ. recueil 2002, p. 441, par. 288). La Cour a par ailleurs indiqué clairement que, lorsque la ligne à tracer traverse plusieurs zones de juridiction qui coïncident, « la méthode dite des principes équitables et des circonstances pertinentes peut utilement être appliquée, cette méthode permettant également d’aboutir dans ces zones maritime à un résultat équitables » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par. 271).
121- Il s’agit là de la deuxième étape de la délimitation, à laquelle la Cour s’intéressera après avoir tracé la ligne d’équidistance provisoire.
122- Enfin, la Cour s’assurera, dans une troisième étape, que la ligne (une ligne d’équidistance provisoire ayant ou non été ajustée en fonction des circonstances pertinentes) ne donne pas lieu, en l’état, à un résultat inéquitable du fait d’une disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le rapport des zones maritime pertinentes attribuées à chaque Etats par ladite ligne (voir paragraphes 214-215). La vérification finale du caractère équitable du résultat obtenu doit permettre de s »assurer qu’aucune disproportion marquée entre les zones maritime ne ressort de la comparaison avec le rapport des longueurs des côtes.
Cela ne signifie toutefois pas que les zones ainsi attribuées à chaque Etat doivent être proportionnelles aux longueurs des côtes : ainsi que la Cour l’a indiqué, « c’est… le partage de la région qui résulte de la délimitation et non l’inverse » (Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, CIJ Recueil 1993, p. 67, par. 64).
Document n°7 Tribunal international du droit de la mer, 14 mars 2012, Affaire du différend concernant la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe de Bengale (extraits)
Méthode de délimitation
206. Le Tribunal doit maintenant examiner la méthode à appliquer à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental dans l’affaire dont il est saisi.
207. Les Parties conviennent que la Convention et ses dispositions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental constituent le droit applicable au différend. Elles sont cependant en désaccord sur la méthode appropriée de délimitation.
208. Le Bangladesh reconnaît que la méthode de l’équidistance est utilisée dans des circonstances appropriées comme moyen de parvenir à une solution équitable. Toutefois, en l’espèce, selon lui, l’équidistance ne permet pas d’obtenir un résultat équitable.
209. Le Bangladesh conteste la validité de la méthode de l’équidistance préconisée par le Myanmar pour la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental jusqu’à 200 milles marins. Il fait valoir que la ligne d’équidistance est inéquitable dans le cas d’espèce et ajoute que le Myanmar s’attache tellement à la méthode de l’équidistance qu’il en vient à affirmer que «es droits sur les zones maritimes sont régis par l’équidistance » et à élever l’équidistance, qui reste une simple méthode de délimitation, au rang de règle de droit d’application universelle.
210. Le Bangladesh observe que le recours à la méthode de l’équidistance « peut dans certains cas aboutir à des résultats de prime abord extraordinaires, anormaux ou déraisonnables », comme cela a été déclaré dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord (arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 23, par. 24).
211. Pour le Bangladesh, le cas de côtes concaves, comme celles situées au nord du golfe du Bengale, figure parmi les configurations où l'on a pris pour la première fois conscience du fait que la méthode de l'équidistance produit « des résultats irrationnels ». Il mentionne à cet effet l'affaire du Plateau continental
(Jamahiriya arabe libyenne/Malte), dans laquelle la Cour internationale de Justice a déclaré qu’une ligne d'équidistance « peut donner un résultat disproportionné quand la côte est très irrégulière ou fortement concave ou convexe » (arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 44, par. 56). (…)
212. Le Bangladesh rappelle l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), dans lequel la CIJ a déclaré que « la méthode de l’équidistance n’a pas automatiquement la priorité sur les autres méthodes de délimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs peuvent rendre son application inappropriée » (arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 741, par. 272).
213. Le Bangladesh considère qu’en raison de la configuration particulière de sa côte dans le nord du golfe de Bengale et de la double concavité qui la caractérise, le Tribunal doit appliquer la méthode de la bissectrice pour délimiter sa frontière maritime avec le Myanmar dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental. Il estime que cette méthode éliminerait les iniquités engendrées par la méthode de l’équidistance et permettrait d’aboutir à un résultat équitable. (…)
216. Le Bangladesh déclare que la ligne d’équidistance revendiquée par le Myanmar est inéquitable à cause de l’effet d’amputation qu’elle produit. Il soutient que « malgré son littoral substantiel de 421 kilomètres, les lignes d'équidistance revendiquées par ses voisins l'empêcheraient d'atteindre la limite des 200 milles marins et, a fortiori, le prolongement naturel de son plateau continental étendu au-delà de 200 milles marins ».
217. Le Bangladesh affirme que la méthode de la bissectrice, et plus précisément la ligne d’azimut 215° qu’il propose pour délimiter sa frontière maritime avec le Myanmar sur le plateau continental jusqu’à 200 milles marins et dans la zone économique exclusive permet « d’évite[r] les problèmes inhérents à la méthode de l'équidistance sans générer elle-même d'inéquité ».
218. Selon le Myanmar, le droit de la délimitation a été « considérablement complété, développé et précisé » depuis l’adoption de la Convention en 1982. (…)
219. Le Myanmar déclare que « la formule “ équidistance/circonstances spéciales ” n'est pas en soi une règle de délimitation proprement dite, mais plutôt une méthode qui permet d’ordinaire d’aboutir à un résultat équitable ». (…)
223. Le Myanmar rejette les arguments avancés par Bangladesh, qui soutient que la ligne d’équidistance ne réussit pas à tenir compte des circonstances pertinentes dans le cas d’espèce, en particulier l’effet d’amputation qu’elle produit ainsi que la concavité de sa côte, et il déclare qu’ « [a]ucune des raisons invoquées par le Bangladesh pour écarter la méthode usuelle de tracé de la frontière maritime entre Etats n'a un quelconque fondement dans le droit international de la mer contemporain, en application duquel la première étape consiste à tracer la ligne d'équidistance provisoire ».
224. Selon le Myanmar, la méthode de la bissectrice proposée par le Bangladesh produit un résultat inéquitable, et le Myanmar « réitèr[e] en termes énergiques qu’absolument aucune raison ne justifie le recours à la “ méthode de la bissectrice ” en l’espèce ».
225. Le Tribunal observe que l’article 74, paragraphe 1, et l’article 83, paragraphe 1, de la Convention disposent que la délimitation, respectivement, de la zone économique exclusive et du plateau continental doit être effectuée conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable, sans préciser la méthode à suivre.
226. Les cours et tribunaux internationaux ont contribué à l’élaboration progressive d’un corps de jurisprudence en matière de délimitation maritime qui a réduit la part de subjectivité et d’incertitude dans la détermination des frontières maritimes et dans le choix des méthodes à suivre à cette fin.
227. Dès les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, il a été souligné dans les premières affaires qu’aucune méthode de délimitation n’est obligatoire et que la ligne d’équidistance peut être inéquitable dans certaines situations, du fait de la configuration des côtes des parties l’une par rapport à l’autre. Cette position, énoncée pour la première fois à propos du plateau continental, a été maintenue s’agissant de la zone économique exclusive.
228. Au fil du temps, en l’absence d’une méthode bien établie, on s’est davantage employé à améliorer l’objectivité et la prévisibilité du processus de délimitation. Les situations géographiques variées examinées dans les premières affaires ont cependant confirmé que, même si on s’était trop écarté de la précision objective qu’apporte l’équidistance, l’emploi de la seule équidistance ne pouvait pas garantir une solution équitable dans tous les cas. Une méthode de délimitation généralement appropriée devrait limiter la subjectivité tout en étant suffisamment souple pour tenir compte des circonstances pertinentes en matière de délimitation maritime dans une affaire donnée.(…)
233. Dans l’affaire de la Délimitation maritime en mer Noire, la Cour internationale de Justice a pris appui sur l’évolution de la jurisprudence en matière de délimitation maritime. Elle a décrit dans son arrêt la méthode en trois étapes qu’elle a appliquée à l’espèce. Dans la première étape, elle a établi une ligne d’équidistance provisoire en utilisant des méthodes objectives d’un point de vue géométrique et adaptées à la géographie de la zone à délimiter. « Lorsqu’il s’agit de procéder à une délimitation entre côtes adjacentes, une ligne d’équidistance est tracée, à moins que des raisons impérieuses propres au cas d’espèce ne le permettent pas » (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c.Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116). Dans la deuxième étape, la Cour a examiné « s’il exist[ait] des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable » (ibid., p. 101 et 102, par. 120). Dans la troisième étape, elle s’est assurée que la ligne de délimitation ne donnait pas lieu « à un résultat inéquitable du fait d’une disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chaque Etat par ladite ligne » (ibid., p. 103, par. 122).
234. Le Tribunal note que les cours et tribunaux internationaux, lorsqu’il n’était pas possible ou approprié pour eux de recourir à la méthode de l’équidistance/circonstances pertinentes, ont appliqué à sa place la méthode de la bissectrice, qui est en fait une approximation de la méthode de l’équidistance. La méthode de la bissectrice a été appliquée dans des affaires qui ont précédé l’arrêt Jamahiriya arabe Libyenne/Malte, à savoir l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 94, par. 133 (C) (3)), l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 333, par. 213) et l’affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau (décision du 14 février 1985, RSA, vol. XIX, p. 189-190, par. 108-111). Cette méthode a été récemment appliquée dans l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) (arrêt, C.I.J. Recueil2007, p. 741, par. 272 et p. 746, par. 287).
235. Le Tribunal observe que la question de la méthode à suivre pour tracer la ligne de délimitation maritime doit être examinée à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. La considération ultime qui doit le guider à cet égard est de parvenir à une solution équitable. La méthode à retenir doit donc être celle qui, dans le contexte géographique et les circonstances particulières de chaque cas d’espèce, permettra d’aboutir à une solution équitable.
236. Lorsqu’on applique la méthode de la bissectrice, l’angle et par conséquent la direction de sa bissectrice sont déterminés par le point d’aboutissement de la frontière terrestre et par la généralisation de la direction des côtes respectives des
Parties à partir de ce point. Si l’on fait varier à titre d’hypothèse la direction générale des côtes respectives des Parties à partir du point d’aboutissement de la frontière terrestre, on obtient souvent des angles et de bissectrices différentes. (…)
238. Le Tribunal note qu’une jurisprudence constante s’est constituée en faveur de la méthode équidistance/circonstances pertinentes. C’est en effet cette méthode qui a été adoptée par les cours et tribunaux internationaux dans la majorité des affaires de délimitation qui leur ont été soumises.
239. Le Tribunal décide que la méthode appropriée en l’espèce pour délimiter la zone économique exclusive et le plateau continental entre le Bangladesh et le Myanmar est la méthode équidistance/circonstances pertinentes.
240. En appliquant cette méthode au tracé de la ligne de délimitation en l’espèce, le Tribunal, conscient de la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux à ce sujet, suivra l’approche en trois étapes mise au point dans les décisions les plus récentes en la matière. En conséquence, il procèdera en suivant les étapes ci-après : au cours de la première étape, le Tribunal construit une ligne d’équidistance provisoire en se fondant uniquement sur la géographie des côtes des Parties et des calculs mathématiques. Une fois tracée la ligne d’équidistance provisoire, il passe à la deuxième étape afin de déterminer s’il existe des circonstances pertinentes appelant un ajustement de cette ligne ; si tel est le cas, il procède à l’ajustement produisant un résultat équitable. Dans la troisième et dernière étape du processus, le Tribunal vérifie si la ligne ainsi ajustée, entraîne une disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes des Parties et le rapport des zones maritimes pertinentes attribuées à chacune d’entre elles.
Document n°8 : Cour Internationale de Justice, Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), 2 février 2018 (Extraits)
Éléments de contexte :
Le 25 février 2014, le Costa Rica a introduit une instance contre le Nicaragua au sujet d’un «[d]ifférend relatif à la délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique». Indiquant que les deux Etats ont épuisé tous les moyens diplomatiques de régler les différends qui les opposent en matière de délimitation maritime, le Costa Rica priait la Cour de déterminer, dans son intégralité et sur la base du droit international, le tracé d’une frontière maritime unique entre l’ensemble des espaces maritimes relevant respectivement du Costa Rica et du Nicaragua dans la mer des Caraïbes et dans l’océan Pacifique. Il considérait en effet que leurs côtes leur donnent droit à des espaces qui se chevauchent, d’un côté comme de l’autre de l’isthme.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2016, la Cour a décidé de faire procéder à une expertise pour contribuer à établir certains éléments factuels pertinents aux fins du règlement du différend qui lui est soumis. Par une ordonnance en date du 16 juin 2016, elle a désigné M. Eric Fouache et M. Francisco Gutiérrez en tant qu’experts indépendants, dont la mission était de déterminer l’état de la côte entre chacun des deux points que, dans leurs écritures, le Costa Rica et le Nicaragua présentent comme étant le point de départ de la frontière maritime dans la mer des Caraïbes.
Compte tenu de la nature des demandes formulées par le Costa Rica en l’affaire relative à la Frontière terrestre dans la partie septentrionale d’Isla Portillos (Costa Rica c. Nicaragua) et du lien étroit que celles-ci entretiennent avec certains aspects du différend en l’affaire relative à la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), la Cour, par une ordonnance en date du 2 février 2017, a décidé que les instances dans les deux affaires devaient être jointes.
Après avoir tenu des audiences du 3 au 13 juillet 2017 sur le fond des deux affaires jointes, la Cour a rendu son arrêt le 2 février 2018 dans lequel elle a, entre autres, déterminé le tracé des frontières maritimes uniques entre le Costa Rica et le Nicaragua dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.
Source : http://www.icj-cij.org/fr/affaire/157
Extrait de l’arrêt à commenter :
B. Délimitation de la mer territoriale
90. S’agissant de la délimitation de la mer territoriale, l’article 15 de la CNUDM, qui est applicable entre le Costa Rica et le Nicaragua, tous deux parties à la convention, dispose ce qui suit :
« Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats. »
La Cour emploiera les termes « ligne médiane » conformément à la disposition précitée, mais se référera à la « ligne d’équidistance » lorsqu’elle résumera les exposés des Parties dans lesquels cette dernière expression est utilisée.
91. Le Costa Rica soutient que la Cour devrait d’abord délimiter la frontière entre les Parties dans la mer territoriale, et ensuite la zone économique exclusive et le plateau continental, en employant deux méthodes différentes. Selon lui, la Cour a invariablement établi une distinction entre la délimitation de la mer territoriale en application de l’article 15 de la CNUDM et la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental en application des articles 74 et 83, lesquels disposent que celle-ci « est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable ».
92. Le Nicaragua affirme que l’article 15 de la CNUDM ne dit pas comment il y a lieu d’effectuer la délimitation, mais seulement ce que les Etats doivent faire à défaut d’accord entre eux à cet égard. Selon lui, il est nécessaire d’appliquer avec souplesse la règle équidistance/circonstances spéciales pour « prendre en considération les caractéristiques locales de la configuration côtière ». Le Nicaragua affirme également qu’il n’existe aucune différence, dans la pratique, entre le régime de délimitation de la mer territoriale prévu à l’article 15 de la CNUDM et celui applicable à la zone économique exclusive et au plateau continental, prévu aux articles 74 et 83, respectivement. Il invoque une « convergence des approches relatives à la délimitation des différentes zones maritimes » et estime que toutes les dispositions pertinentes de la CNUDM doivent être lues conjointement et dans leur contexte.
93. Le Costa Rica soutient que, s’agissant de la délimitation de la mer territoriale, le Nicaragua a tenu compte de notions juridiques et de formations géographiques ne pouvant revêtir de pertinence qu’aux fins de la délimitation de sa zone économique exclusive et de son plateau continental. Il indique que, même si les dispositions de la CNUDM ne sauraient être considérées isolément, l’article 15 «ne mentionne ni n’englobe nullement les articles 74 et 83, et inversement» : il est rédigé en des termes différents, n’a pas le même objet et constitue une disposition autonome. Le Costa Rica rappelle que, dans de précédentes affaires portant sur la délimitation de la mer territoriale, la Cour a reconnu la primauté de la méthode de l’équidistance et décidé qu’elle ne s’en écarterait que si l’existence de circonstances spéciales le justifiait. S’il admet qu’il est possible de faire preuve d’une certaine souplesse lorsque l’on ajuste la ligne en fonction de l’existence de circonstances spéciales, le Costa Rica affirme cependant que cette souplesse ne saurait prévaloir sur le sens clair du texte de la CNUDM, qui établit une distinction entre les méthodes de délimitation correspondant à différentes zones maritimes.
94. Les Parties conviennent toutefois que, pour procéder à la délimitation de la mer territoriale, il est nécessaire, tout d’abord, d’établir une ligne d’équidistance. Elles ont envisagé la délimitation de la mer territoriale au moyen de la même méthode, en commençant par tracer une ligne d’équidistance provisoire, avant d’examiner l’existence de circonstances spéciales justifiant d’ajuster cette ligne.
(…)
98. Conformément à sa jurisprudence établie, la Cour procédera en deux étapes: premièrement, elle tracera une ligne médiane provisoire et, deuxièmement, elle examinera s’il existe quelque circonstance spéciale justifiant d’ajuster cette ligne (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 176 ; Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 740, par. 268).
(…)
101. Le Nicaragua soutient que la ligne d’équidistance dans la mer territoriale devrait être ajustée à la lumière de la « circonstance spéciale » que constitue « l’effet d’amputation exagéré qui résulte du passage d’une côte convexe à une côte concave dans les environs immédiats du point de départ de Punta de Castilla ». Il affirme que cette portion de la côte ne reflète pas la direction générale du littoral et relève que la déviation qui en résulte «se poursuit sur une partie substantielle de la ligne » d’équidistance. La combinaison de ces côtes convexe et concave doit, d’après lui, être considérée comme une circonstance spéciale exigeant l’ajustement de la ligne d’équidistance stricte dans la mer territoriale. Selon le Nicaragua, en effet, « [n]ul ne conteste que l’effet d’amputation résultant d’une certaine configuration côtière » peut nécessiter des ajustements de la ligne d’équidistance provisoire.
102. Le Costa Rica affirme qu’il n’existe pas de « circonstances spéciales imposant de procéder à la délimitation de la mer territoriale sur un fondement autre que l’équidistance ». En réponse à l’argument du Nicaragua, il soutient que le recours à une telle ligne ne créerait aucune amputation inéquitable dans cet espace maritime. Il fait valoir que l’argument du Nicaragua repose sur « l’extension artificielle de la zone géographique considérée aux fins de la délimitation de la mer territoriale » et sur une description inexacte des projections côtières qui seraient selon lui amputées. Le Costa Rica estime que la frontière divisant la mer territoriale devrait de ce fait suivre une ligne d’équidistance non ajustée.
103. La Cour considère que, aux fins de la délimitation de la mer territoriale, l’effet conjugué de la concavité de la côte nicaraguayenne à l’ouest de l’embouchure du fleuve San Juan et de la convexité de la côte costa-ricienne à l’est de la lagune de Harbor Head ne porte guère à conséquence et ne constitue pas une circonstance spéciale pouvant justifier un ajustement de la ligne médiane en application de l’article 15 de la CNUDM.
104. La Cour estime toutefois que constitue une circonstance spéciale ayant une incidence sur la délimitation maritime dans la mer territoriale la grande instabilité, et l’étroitesse, de la flèche littorale qui se trouve à proximité de l’embouchure du fleuve San Juan et fait office de barrière entre la mer des Caraïbes et un territoire relativement étendu appartenant au Nicaragua (voir le paragraphe 86 plus haut). L’instabilité de cette formation ne permet pas de choisir un point de base sur cette partie du territoire du Costa Rica, comme le reconnaît celui-ci, ni de relier un point qui s’y trouverait au point fixe choisi en mer pour former le premier segment de la ligne de délimitation. La Cour juge plus approprié de relier par une ligne mobile le point fixe en mer situé sur la ligne médiane, mentionné au paragraphe 86 plus haut, au point de la côte costa-ricienne le plus proche, sur la terre ferme, de l’embouchure du fleuve (…).
105. La Cour considère qu’une autre circonstance spéciale est pertinente aux fins de la délimitation de la mer territoriale. L’instabilité du cordon littoral qui sépare la lagune de Harbor Head de la mer des Caraïbes et sa situation en tant qu’enclave de petite taille en territoire costa-ricien appellent en effet une solution particulière. Si l’enclave devait se voir attribuer des eaux territoriales, celles-ci seraient peu utiles au Nicaragua, tout en brisant la continuité de la mer territoriale du Costa Rica. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte, aux fins de la délimitation de la mer territoriale entre les Parties, d’un quelconque droit qui découlerait de l’enclave.
(…)
La ligne de délimitation est figurée sur le croquis n° 5 ci-dessous.
Document n°9 : Extraits de l’opinion individuelle de M. le juge Abraham, jointe à l’arrêt de la CIJ du 19 novembre 2012, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)
« 21. En ce qui concerne la délimitation maritime, mon désaccord porte moins sur ce qu’a fait la Cour […] que sur la manière de le présenter, qui m’apparaît assez largement fallacieuse. En résumé, mon opinion est que si la Cour affirme qu’elle suit la méthode traditionnelle telle qu’elle a été exposée, notamment, dans l’arrêt rendu en l’affaire Roumanie c. Ukraine […], elle s’en écarte en réalité très largement, et en vérité elle ne peut pas faire autrement car il est manifeste que cette méthode est inadaptée à la présente affaire.
22. La méthode en question est rappelée aux paragraphes 190 à 193 de l’arrêt. Elle consiste à tracer d’abord une ligne médiane provisoire […]. La méthode consiste, dans un deuxième temps, à ajuster ou déplacer la ligne provisoire ainsi obtenue pour tenir compte des circonstances particulières qui, s’il en existe, appelleraient un tel ajustement ou déplacement en vue de parvenir à une solution équitable. Enfin, dans une troisième étape, la Cour doit vérifier que la délimitation obtenue au terme de l’étape précédente n’aboutit pas à attribuer aux Parties des espaces maritimes dont le rapport de superficie serait hors de proportion, de façon marquée, avec la longueur de leurs côtes pertinentes respectives […].
[…]
34. Je ne veux pas dire que la Cour ait eu tort de délimiter les espaces constituant la zone pertinente comme elle l’a fait. Je pense au contraire qu’elle a adopté la solution la plus raisonnable, et que chaque étape de sa construction était intrinsèquement justifiée. Mais mon opinion est qu’il eût été plus clair et plus franc de la part de la Cour de reconnaître qu’elle ne pouvait pas suivre en l’espèce sa méthode dite «de référence » parce que le cadre géographique ne se prêtait absolument pas à l’application de cette méthode. Ainsi se trouvait-elle en l’espèce dans le cas où « des raisons impérieuses propres au cas d’espèce » ne permettaient pas de tracer la ligne médiane provisoire (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101, par. 116), ou, à tout le moins, dans celui où l’application de la méthode de l’équidistance était « inappropriée » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 741, par. 272, mentionné au paragraphe 194 du présent arrêt).
35. Je comprends que la Cour veuille donner à tous ceux qui l’observent, et d’abord aux Etats, le sentiment qu’elle ne procède pas de manière arbitraire pour parvenir à une solution équitable, mais qu’elle met en œuvre des techniques éprouvées et constantes. Et il est parfaitement vrai qu’il n’y a aucun arbitraire dans la démarche de la Cour, mais seulement la recherche scrupuleuse de la meilleure solution. Il est cependant des affaires qui se présentent en des termes tellement spécifiques qu’il est, à tout prendre, préférable de reconnaître que la Cour doit s’écarter de sa technique habituelle, en expliquant pourquoi, plutôt que de sacrifier la clarté et l’intelligibilité à l’apparence d’une illusoire continuité ».
Document n°10 : CIJ, arrêt du 17 mars 2016, Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombies), Exceptions préliminaires, extraits
1. Le 26 novembre 2013, le Gouvernement de la République du Nicaragua (dénommée ci-après le « Nicaragua ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de Colombie (dénommée ci-après la «Colombie») au sujet d’un différend portant sur des «violations des droits souverains et des espaces maritimes du Nicaragua qui lui ont été reconnus par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)] ainsi que sur la menace de la Colombie de recourir à la force pour commettre ces violations ».
(…)
Au cours de la procédure écrite sur le fond, les conclusions ci-après ont été présentées au nom du Gouvernement du Nicaragua dans le mémoire :
«1. Pour les motifs exposés dans le présent mémoire, la République du Nicaragua prie la Cour de dire et juger que, par son comportement, la République de Colombie :
a) a manqué́ à l’obligation lui incombant de ne pas violer les espaces maritimes du Nicaragua tels que délimités au paragraphe 251 de l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, ainsi que les droits souverains et la juridiction du Nicaragua sur lesdits espaces ;
b) a manqué́ à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies et du droit international coutumier de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force ;
c) se trouve, partant, tenue d’effacer les conséquences juridiques et matérielles de ses faits internationalement illicites, et de réparer intégralement le préjudice causé par ceux-ci.
2. Le Nicaragua prie également la Cour de dire et juger que la Colombie doit :
a) cesser tous ses faits internationalement illicites de caractère continu portant atteinte ou susceptibles de porter atteinte aux droits du Nicaragua ;
b) dans toute la mesure du possible, rétablir le statu quo ante,
i) en abrogeant les lois et règlements promulgués par elle qui sont incompatibles avec l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012, notamment les dispositions des décrets 1946 du 9 septembre 2013 et 1119 du 17 juin 2014 relatives aux zones maritimes qui ont été reconnues comme relevant de la juridiction ou des droits souverains du Nicaragua ;
ii) en révoquant les permis délivres à des navires de pêche opérant dans les eaux nicaraguayennes ; et
iii) en faisant en sorte que ni la décision rendue le 2 mai 2014 par la Cour constitutionnelle de la Colombie ni aucune autre décision rendue par une autorité́ nationale n’empêche l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 2012 ;
c) l’indemniser au titre de l’ensemble des dommages causés dans la mesure où ceux-ci n’auront pas été réparés par la restitution, à savoir le manque à gagner résultant, d’une part, des pertes d’investissements qu’ont entrainé les déclarations à caractère comminatoire faites par les plus hautes autorités colombiennes et le recours, par les forces navales colombiennes, à la menace ou à l’emploi de la force à l’encontre de navires de pêche nicaraguayens [ou de navires explorant ou exploitant le sol et le sous-sol du plateau continental du Nicaragua] et de navires de pêche d’Etats tiers détenteurs d’un permis délivré par le Nicaragua, et, d’autre part, de l’exploitation des eaux nicaraguayennes par des navires de pêche agissant en vertu d’une « autorisation » illicite de la Colombie, le montant de l’indemnité devant être déterminé lors d’une phase ultérieure de la procédure;
d) donner des garanties appropriées de non-répétition de ses faits internationalement illicites.»
Document n°11 : CIJ, arrêt du 17 mars 2016, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 miles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), Exceptions préliminaires (Extraits)
1. Le 16 septembre 2013, le Gouvernement de la République du Nicaragua (dénommée ci-après le « Nicaragua ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre la République de Colombie (dénommée ci-après la «Colombie») au sujet d’un «différend port[ant] sur la délimitation entre, d’une part, le plateau continental du Nicaragua s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale du Nicaragua et, d’autre part, le plateau continental de la Colombie ».
(…)
«Le Nicaragua prie la Cour de déterminer:
Premièrement : Le tracé précis de la frontière maritime entre les portions de plateau continental relevant du Nicaragua et de la Colombie au-delà des limites établies par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012.
Deuxièmement: Les principes et les règles de droit international régissant les droits et obligations des deux Etats concernant la zone de plateau continental où leurs revendications se chevauchent et l’utilisation des ressources qui s’y trouvent, et ce, dans l’attente de la délimitation de leur frontière maritime au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne. »
Document n°12 : CIJ, arrêt du 3 juin 1985, Affaire du plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), CIJ Recueil, 1985, §. 50 (extrait)
Les ressources effectivement contenues dans le plateau continental soumis à délimitation, « pour autant que cela soit connu ou facile à déterminer », pourraient effectivement constituer des circonstances pertinentes qu'il pourrait être raisonnable de prendre en compte dans une délimitation, comme la Cour l'a déclaré dans les affaires du Plateau continental la mer du Nord
Document n°13 : CIJ, arrêt du 10 octobre 2002, Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée Équatoriale (intervenant)), §. 304 (extrait)
Dans l'ensemble, il ressort de la jurisprudence que, si l'existence d'un accord exprès ou tacite entre les parties sur l'emplacement de leurs concessions pétrolières respectives peut indiquer un consensus sur les espaces maritimes auxquels elles ont droit, les concessions pétrolières et les puits de pétrole ne sauraient en eux-mêmes être considérés comme des circonstances pertinentes justifiant l'ajustement ou le déplacement de la ligne de délimitation provisoire. Ils ne peuvent être pris en compte que s'ils reposent sur un accord exprès ou tacite entre les parties. En la présente espèce, il n'existe aucun accord entre les Parties en matière de concessions pétrolières.
Document n°14 : Igor Gauquelin (2016). Mer de Chine : Comprendre l’arbitrage de la Haye [En ligne] www.asialyst.com, 15.07.2016
Le verdict était attendu fiévreusement. Le 12 juillet dernier, un tribunal arbitral international, constitué sur la base de l’Annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), a rendu des conclusions explosives relatives au litige qui oppose la Chine et les Philippines dans l’étendue d’eau qui les sépare, la mer de Chine méridionale. La Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye, en qualité de greffe, a donné totalement raison à Manille, qui avait lancé cet arbitrage pour s’insurger contre la politique menée par Pékin dans les îles Spratleys et les hauts-fonds de Scarborough. La République populaire de Chine, qui rejette depuis le début cette procédure arbitrale, se retrouve ainsi en contradiction ouverte avec une convention de l’ONU dont elle est signataire. Puissance unilatérale contre droit multilatéral, qui l’emportera ?
CONTEXTE :
L’arbitrage rendu cette semaine a été lancé en janvier 2013, à l’initiative du gouvernement philippin sous la présidence de Benigno Aquino. Elu en mai 2010 après une campagne centrée sur la lutte anticorruption, dans un contexte de scandales impliquant des investissements chinois dans son pays, Aquino s’en était remis à la justice internationale pour défendre les intérêts maritimes de Manille, après la prise de contrôle par Pékin des hauts-fonds de Scarborough, au large de la grande île philippine de Luzon, en 2012.
Depuis, si la configuration naturelle de cet élément maritime n’a pas été modifiée, la Chine a en revanche altéré massivement l’environnement de plusieurs autres éléments maritimes disputés, dont des récifs revendiqués par les Philippines. Et notamment Mischief, dans l’est des Spratleys au large de Puerto Princesa. Tombé sous le joug chinois en 1995, cet atoll corallien immergé à marée haute est désormais une île artificielle dotée d’infrastructures stratégiques.
En mai 2016, alors que les conclusions de l’arbitrage étaient encore attendues, et que les relations entre Manille et Pékin étaient devenues exécrables, les Philippins ont porté au pouvoir un nouveau président, Rodrigo Duterte. L’ancien maire de Davao l’avait annoncé : il a tendu la main à la Chine, en se déclarant prêt à rouvrir le dialogue avec Pékin, pour parvenir éventuellement à un nouvel accord entre les deux pays sur le partage des richesses en mer de Chine méridionale.
Les Philippines, pays pauvre sous bouclier militaire américain depuis les années 1950, ne peuvent entrer en guerre contre le géant chinois. Car l’archipel a des besoins cruciaux d’infrastructures, donc d’investissements, et doit se tourner vers la Chine. Tel fut le credo développé par Rodrigo Duterte pendant toute sa campagne présidentielle de 2016, pour justifier sa main tendue à Pékin. La sentence rendue par le Tribunal arbitral cette semaine, conclusion d’une procédure lancée par le prédécesseur de Duterte il y a trois ans, afin de contre-carrer les ambitions chinoises dans la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins revendiquée par Manille sur la base de la CNUDM, pourrait donc ne pas constituer un obstacle au rapprochement entre les deux pays. D’ailleurs, le président Duterte a annoncé ce jeudi 14 juillet que l’ancien chef de l’Etat Fidel Ramos serait prochainement envoyé en Chine pour rouvrir un canal de discussion au sujet de ce litige.
En revanche, les conclusions particulièrement « salées » de l’arbitrage, rendu par cinq juges internationaux ce mardi 12 juillet, constituent un précédent auquel les pays concernés de près ou de loin par ces conflits territoriaux en mer de Chine (par exemple les Etats-Unis, le Japon, le Vietnam et même l’Indonésie prêteront une grande attention. Car c’est désormais officiel : si la Chine entend se constituer, comme d’autres superpuissances mondiales en devenir avant elle, une « chasse gardée » en mer de Chine méridionale (ou un « jardin », pour reprendre une expression de Ronald Reagan utilisée dans un tout autre contexte), cela ne se fera pas en adéquation avec le droit international, mais bien contre lui.
Qu’elle reconnaisse le droit de la mer, comme c’est le cas actuellement, ou qu’elle s’en éloigne – elle récemment a menacé de le faire -, la Chine est désormais pointée du doigt non plus par ses rivaux, mais par la CNUDM. C’est ce qui ressort du communiqué de presse et de la sentence délivrés via la CPA par le Tribunal arbitral en charge du dossier sino-philippin de l’affaire ce 12 juillet (disponibles en bas de cet article). Pour rappel, la Chine revendique la souveraineté de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud. Elle contrôle l’archipel des Paracels, les hauts-fonds de Scarborough ainsi qu’une partie des Spratleys, où elle remblaie du sable à grande vitesse pour créer des îles artificielles, des « polders » dotés d’infrastructures stratégiques et donc potentiellement militaires (ports, pistes d’atterrissage ou systèmes radars).
Face à l’expansion démesurée des intérêts chinois en mer de Chine méridionale, ambition débordant petit à petit sur des territoires revendiquées ou administrés par d’autres pays dont les Philippines, le Tribunal arbitral n’était pas habilité à déterminer quel îlot appartient à quel pays. Mais Manille avait posé quatre questions précises, au nom de son droit à une ZEE de 200 milles marins le long de ses côtes, principe de base de la CNUDM. Une ZEE est en effet essentielle pour la prospection et l’exploitation des ressources, ainsi que pour se défendre. Avant tout, les autorités philippines souhaitaient savoir si la carte sous-régionale élaborée par la Chine de longue date était valable. Cette carte est surnommée « ligne en neuf traits » et stipule sans coordonnées géographiques précises que la quasi-intégralité de la mer de Chine du Sud appartient à Pékin compte tenu de « droits historiques » (découverte et administration exclusive de ces îles dans le glorieux passé maritime de la Chine). Et sur cette question centrale, la réponse du Tribunal fut tout simplement « non ». Un rejet cinglant pour la Chine.
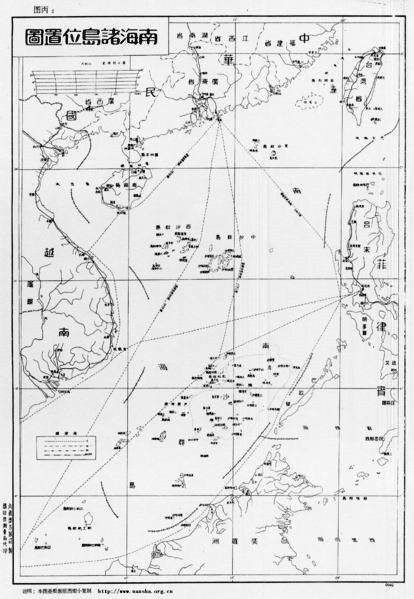 Carte de la mer de Chine du Sud dite "ligne à neuf traits" pour montrer la zone de souveraineté chinoise dans la zone, réalisée en 1947 à Nankin par la Chine du Kuomintang. (Source : Wikimedia Commons)
Carte de la mer de Chine du Sud dite "ligne à neuf traits" pour montrer la zone de souveraineté chinoise dans la zone, réalisée en 1947 à Nankin par la Chine du Kuomintang. (Source : Wikimedia Commons)
DROITS HISTORIQUES CHINOIS « ÉTEINTS »
Le problème ? Comment interpréter la Convention de l’ONU, qui fait état du droit à une ZEE, mais aussi à des « droits historiques » pouvant s’enchevêtrer sur une même zone ? Dans l’élaboration de la CNUDM, considère finalement le Tribunal, « la protection des droits préexistants sur des ressources a été considérée, mais elle n’a pas été adoptée dans la Convention. Par conséquent, le Tribunal estime que, dans la mesure où la Chine avait des droits historiques sur des ressources dans les eaux de la mer de Chine méridionale, ces droits ont été éteints étant donné qu’ils étaient incompatibles avec les zones économiques exclusives prévues par la Convention. » Le Tribunal note également que, « bien que les navigateurs et pêcheurs chinois, ainsi que ceux d’autres États, ont, historiquement, fait usage des îles de la mer de Chine méridionale, il n’existe aucune preuve que la Chine a, historiquement, exercé un contrôle exclusif sur les eaux et leurs ressources. »
Le Tribunal conclut donc sans ambiguïté qu’il n’y a « aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques sur des ressources dans les zones maritimes à l’intérieur de la « ligne en neuf traits ». » L’intégralité de la doctrine chinoise en mer de Chine méridionale se retrouve ainsi balayée en une phrase. Mais ce n’est pas l’unique camouflet subi par Pékin. Les Philippines souhaitaient également que la justice internationale clarifie le statut juridique de tous les éléments maritimes disputés des Spratleys, et notamment ceux récemment « poldérisés » par la Chine, dont certains sont revendiqués par Manille aussi. Autrefois immergés tout ou partie à marée haute, les récifs de Mischief, Fiery Cross, Johnson South, Cuarteron, Subi, Gaven et Hughes, sont désormais des îles artificielles émergées. Confèrent-ils ainsi les droits maritimes qu’offre une « île » à son occupant au regard de la CNUDM ? La réponse est à nouveau « non ».
Certes, « les éléments qui sont découverts à marée haute génèrent un droit à une mer territoriale d’au moins 12 milles marins [tout autour, NDLR], contrairement aux éléments recouverts à marée haute », rappelle le Tribunal. Mais ce dernier « constate que les récifs ont été modifiés de manière considérable par les activités de réclamation de terre et de construction », et « rappelle que la Convention catégorise les éléments en fonction de leur état naturel, et s’appuie sur des documents historiques afin d’évaluer les éléments ». Ce qui signifie qu’un récif comme celui de Mischief par exemple, autrefois immergé dans son état naturel, n’est pas devenu une île au regard du droit international, même si Pékin l’a fait émerger de l’eau en le poldérisant. C’est son état d’origine qui compte. Il n’offre donc pas à ses occupants actuels de droit d’administration et d’exploitation sur les eaux alentours (pêche, prospection ou exploitation d’hydrocarbures, etc.).
LES ÎLES SPRATLEYS, DES « ROCHERS » ET NON DES « ÎLES »
Pour bien enfoncer le clou, le Tribunal ajoute que les constructions artificielles de Pékin en mer ne lui offrent pas non plus de ZEE de 200 milles marins, et encore moins de « plateau continental« , autour de ces îles. « En vertu de la Convention, une île génère une zone économique exclusive de 200 milles marins et un plateau continental, mais les « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental « . » Le Tribunal offre alors une conclusion radicale, argumentation à l’appui : aucune île des Spratleys « n’est capable de générer une zone maritime étendue ». Et d’ajouter, par conséquent, que « certaines zones maritimes sont comprises dans la zone économique exclusive des Philippines, parce que ces zones ne sont chevauchées par aucun droit de la Chine ». Point positif au passage : la foire d’empoigne des Spratleys peut désormais redevenir à peu près lisible, seule primant sur place aux yeux du droit les zones d’exclusivité générées par les côtes des Etats, et non plus par les îles et récifs qu’ils prétendent administrer, ce qui créait des convictions totalement contradictoires.
Sur ce point précis, Taïwan fait office de victime collatérale de la requête des Philippines. Héritier des nationalistes chinois de Chiang Kaï-chek, le régime taïwanais a en effet les mêmes revendications que la Chine populaire en mer de Chine méridionale, à défaut d’avoir l’ambition de restreindre l’accès de ces zones aux autres, contrairement à Pékin. Taipei contrôle, depuis la fin de la guerre civile chinoise, une position dans les Spratleys du nom d’Itu Aba (Taiping, en chinois). Un élément maritime occupé de longue date, qui dépasse le niveau de la mer à marée haute, et qui est considéré communément comme « la plus grande île de l’archipel ». Taïwan aime d’ailleurs à rappeler que de l’eau potable est puisée en quantité sur place. Mais qu’à cela ne tienne, comme l’intégralité des « îles Spratleys », Itu Aba est désormais renvoyée au statut de « rocher » incapable de « générer une zone maritime étendue ». Autrement dit, Taipei vient de perdre des eaux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir, puisque les autorités de Taïwan ont aussitôt envoyé un navire sur zone pour réaffirmer leur souveraineté sur les eaux entourant Itu Aba.
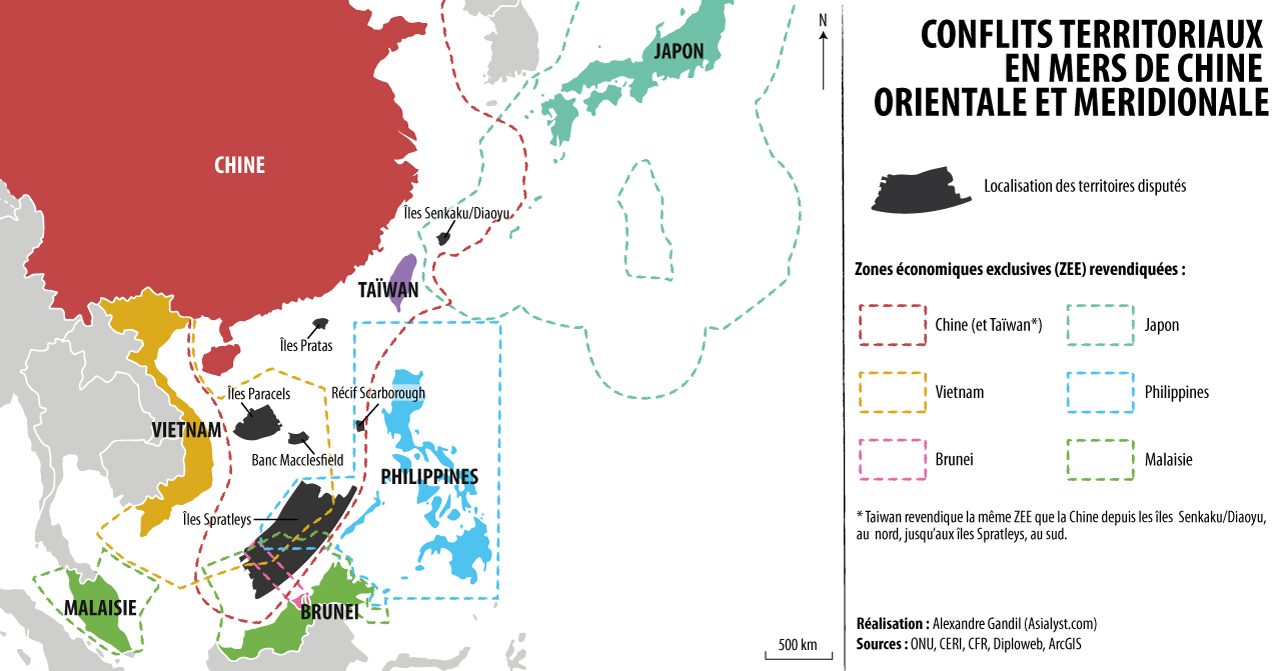 Carte des revendications en mer de Chine du Sud.
Carte des revendications en mer de Chine du Sud.
Troisième question posée par les Philippins : certaines activités chinoises dans la mer de Chine méridionale ont-elles été menées « en violation de la Convention, en portant atteinte à l’exercice des droits souverains et libertés des Philippines en vertu de la Convention ou par ses opérations d’aménagement ou ses pratiques de pêche qui ont endommagé le milieu marin » ? La réponse du Tribunal est « oui ». D’abord, la Chine a violé la CNUDM et la ZEE de Manille « en entravant les activités liées à la pêche et l’exploration pétrolière menées par les Philippines », « en construisant des îles artificielles » et « en n’empêchant pas les pêcheurs chinois de pêcher dans la zone ».
« Le Tribunal considère également que les pêcheurs des Philippines (au même titre que les pêcheurs de la Chine) possèdent des droits de pêche traditionnels à proximité du récif de Scarborough et que la Chine a porté atteinte à ces droits en y limitant l’accès. Le Tribunal conclut, en outre, que les navires de la force publique chinoise ont commis des actes illicites et ont provoqué des risques sérieux d’abordage lorsqu’ils ont bloqué physiquement les navires philippins. »
LE MILIEU MARIN « ENDOMMAGÉ »
Bel et bien, Pékin est par ailleurs clairement accusée d’avoir « endommagé le milieu marin » en mer de Chine méridionale, un comble pour une puissance parvenue à se réinstaller à la fin des années 1980 dans l’archipel des Spratleys avec l’appui de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, un organisme favorisant la coopération pour l’étude des océans. Et le Tribunal ne mâche pas ses mots : « La Chine a causé des dommages graves aux récifs coralliens et a manqué à ses obligations de préserver et protéger les écosystèmes délicats ainsi que l’habitat des espèces en régression, menacées ou en voie d’extinction. Le Tribunal conclut également que les autorités chinoises étaient au courant du fait que les pêcheurs chinois exploitaient, à grande échelle, des tortues de mer, des coraux et des palourdes géantes menacés d’extinction dans la mer de Chine méridionale (en utilisant des méthodes causant des dommages importants à l’environnement des récifs coralliens) et qu’elles ont manqué aux obligations qui leur incombent de mettre fin à ces activités. »
Reste la quatrième question soulevée par les Philippines, qui pourrait se résumer ainsi : la Chine a-t-elle aggravé son cas depuis le lancement de la procédure d’arbitrage ? Cette fois, le « oui » s’accompagne d’un bémol du Tribunal, même si ce dernier donne raison, in fine, aux Philippines : « Le Tribunal estime qu’il n’est pas compétent pour examiner les conséquences d’une confrontation entre la marine philippine et les navires de la force publique chinoise à proximité du récif de Second Thomas, soutenant que ce différend implique des activités militaires et, par conséquent, est exclu du règlement obligatoire. Toutefois, le Tribunal juge que les activités de réclamation de terre à grande échelle et de construction d’îles artificielles sont incompatibles avec les obligations incombant à un État dans le cadre d’une procédure de règlement de différends, dans la mesure où la Chine a infligé des dommages irréversibles au milieu marin, a construit une grande île artificielle dans la zone économique exclusive des Philippines, et a détruit des preuves relatives à l’état naturel de certains éléments en mer de Chine méridionale qui faisaient partie du différend opposant les Parties. »
Compte tenu de cette sentence dénuée d’ambiguïté, et de la nouvelle donne politique aux Philippines, c’est un profil bas qui a été adopté par le nouveau pouvoir à Manille après les conclusions de la CPA et du Tribunal arbitral. « Nous appelons les parties concernées à la retenue et à la sobriété », a déclaré le ministre philippin des Affaires étrangères Perfecto Yasay. Son homologue chinois a pour sa part réitéré intégralement la position de son pays : le Tribunal arbitral est « incompétent », « sa décision est naturellement nulle et non avenue », et cette procédure décidée unilatéralement par les Philippines « viole la législation internationale ». Et d’ajouter que la Chine refusera « tout arbitrage par un tiers » ou « toute solution imposée », et continuera à négocier « avec les États directement concernés ». Message reçu cinq sur cinq à Manille avec l’annonce de l’arrivée prochaine en Chine de l’ancien président Fidel Ramos pour discuter.
VICTOIRE IN FINE DE LA STRATÉGIE CHINOISE ?
Reste que l’arbitrage en présence est un précédent jurisprudentiel susceptible de modifier la donne régionale, et par conséquent mondiale. Si la Chine décide de rester signataire de la CNUDM, elle sera désormais inaudible lorsqu’elle assurera que ses activités en mer de Chine sont en adéquation avec le droit international, et ses adversaires seront confortés dans leur volonté de défendre la liberté de navigation et de vol dans les Spratleys. Une situation paradoxale et dangereuse pour la survie de la CNUDM. Et si à l’inverse, Pékin venait à quitter cette convention onusienne, à laquelle les Etats-Unis n’ont d’ailleurs jamais donné de blanc-seing, alors que resterait-il de la vaste ambition de Montego Bay, qui consistait à doter le monde d’une grande « Constitution des océans » ? Dans les deux cas, si la Chine poursuit ses activités en mer de Chine méridionale, en instaurant par exemple – officiellement cette fois-ci – une zone d’identification de défense aérienne (ZIDA) en mer de Chine méridionale, ce sera une victoire de la stratégie chinoise du « fait accompli« . Une victoire de la puissance sur le droit.
Document n°15 : Christophe Prazuck, « Mer de Chine et droit de la mer : le paradoxe chinois » Lettre du Centre Asie, Ifri, 7 mai 2021
La mer de Chine méridionale est non seulement le théâtre de différends maritimes et territoriaux entre les pays riverains mais aussi le lieu d’une remise en cause du droit international de la mer. La stratégie d’affirmation de puissance déployée par la Chine sur ce théâtre a ceci de paradoxal qu’elle cherche à bâtir une capacité maritime de premier plan en même temps qu’elle sape les fondements du droit de la mer, dont l’un des principes essentiels – la liberté de navigation – a permis son essor économique.
La « mer domine la terre » ? Retournement du droit en mer de Chine du Sud
Les différends maritimes et territoriaux sont entrelacés. Pour mieux distinguer les enjeux, prenons la liberté de simplifier l’équation en séparant les variables : territoriales d’abord, maritimes ensuite, conformément au principe coutumier du droit maritime « la terre domine la mer ».
La partie la plus connue des contestations chinoises concerne la souveraineté sur des îles, des récifs, des hauts-fonds parfois découverts par les flots : les Spratleys, les Paracels, les Pratas, les récifs Louisa, Scarborough, les bancs Macclesfield, Second Thomas, le haut-fond James, etc. Ces souverainetés sont contestées selon les cas par Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan ou encore le Vietnam. Ces souverainetés ouvrent des droits sur les espaces maritimes environnant les terres émergées (eaux territoriales, zones économiques exclusives [ZEE]) disponibles pour la pêche ou l’exploitation d’éventuels gisements d’hydrocarbures. En effet, dans le droit maritime d’aujourd’hui, une souveraineté en mer ne peut découler que d’une souveraineté terrestre. Il n’existe pas de souveraineté maritime si l’on n’est pas riverain de l’espace maritime concerné.
Ces contestations terrestres sont bien connues du grand public. En effet certaines se sont accompagnées de l’occupation des îlots contestés et de poldérisations spectaculaires, comme celle menée par la Chine sur le récif Fiery Cross dans les Spratleys, transformé entre 2014 et 2017, de grand pâté de corail en base militaire avec port en eaux profondes et piste d’atterrissage de 3 000 mètres de long.
Même si ces revendications terrestres étaient reconnues, augmentées des droits maritimes qu’elles ouvrent selon la convention des Nations unies sur le droit de la mer (dite de Montego Bay), elles resteraient en deçà d’une autre revendication chinoise qui la contient et l’amplifie, celle dite de la « langue de buffle », ou de la « ligne en neuf traits », qui délimite 80 % de la mer de Chine méridionale et englobe toutes les îles précédemment citées ainsi que Taïwan. Bien que les juristes chinois s’en défendent, cette revendication inverse de fait le mécanisme du droit de la mer. La règle universelle veut que les droits sur la mer découlent d’une souveraineté sur la terre riveraine. Au contraire, cette langue de buffle est un espace maritime dans lequel toute terre verrait sa souveraineté déduite des droits reconnus sur les eaux qui la baignent.
Présentée pour la première fois en 1949, la ligne des neuf traits est vigoureusement revenue sur le devant de la scène depuis 2009. Dans son argumentation, la Chine n’opère aucune distinction entre zones sous souveraineté (eaux intérieures et mer territoriale) et zones sous juridiction (ZEE). Elle entretient le flou sur les droits qu’elle revendique sous les formules d’ « eaux chinoises historiques », de « zones de souveraineté incontestable » et de « zones de pêche chinoise traditionnelles ». Ces revendications ont été invalidées en juillet 2016 par un tribunal arbitral international constitué à l’initiative des Philippines. La Chine juge cette sentence « nulle et non avenue ».
La remise en cause de la convention de Montego Bay concerne également la définition des lignes de base droites qui permettent de déterminer la limite des eaux territoriales ; elles peuvent ainsi s’étendre par endroits jusqu’à 122 milles nautiques des côtes chinoises au lieu des 12 milles nautiques de la convention. La Chine conteste aussi le droit de passage inoffensif des navires de guerre étrangers dans ses eaux territoriales et soumet les activités militaires dans sa ZEE à notification préalable. Toutes ces exigences sont excessives au regard du droit maritime international. Sont-elles un avant-goût des fameux droits historiques que la Chine souhaite imposer dans l’ensemble du « territoire maritime » délimité par la langue de buffle ?
Déploiement d’une stratégie hybride par la Chine
En soutien de ses revendications, la Chine conduit une stratégie qui impose les uns après les autres une série de « faits accomplis ». Sa manœuvre fait jouer une très large palette de moyens. Ses pêcheurs d’abord qui opèrent en essaims dans les zones contestées (220 bateaux de pêche mouillés autour de l’îlot Julian Felipe en mars 2021). Puis ses milices de la mer qui protègent les pêcheurs, ses garde-côtes qui les soutiennent avec 130 navires de plus de 1 000 tonnes aux pouvoirs de contrainte des navires étrangers étendus par une loi chinoise en février 2021. Et enfin sa marine de guerre dont la croissance en quantité comme en qualité défie désormais la marine américaine. La Chine déploie une posture militaire de surveillance, de suivi, de gesticulation. Les bâtiments de guerre étrangers sont interrogés, accompagnés, survolés. Un transit dans de supposées eaux territoriales provoque une contestation.
Ces manœuvres maritimes et navales sont soutenues par une manœuvre administrative avec la création de nouvelles entités administratives dans les Paracels et les Spratleys, une communication déterminée, une campagne de protection de l’environnement marin (BlueSea 2020) et même l’organisation de visites pour des touristes continentaux.
La Chine déploie également une activité diplomatique dont le principe est la régionalisation des questions liées à la mer de Chine méridionale. Selon Pékin, seule la négociation d’un code de conduite entre pays riverains peut réduire les tensions créées par l’intervention déstabilisante de perturbateurs étrangers, c’est-à-dire les États-Unis. Dans ces négociations bilatérales du code de conduite, les protagonistes ne pèsent évidemment pas du même poids que l’acteur central du processus, la Chine.
Voilà rapidement résumées les tensions croissantes en mer de Chine méridionale. Elles appellent deux séries de remarques, l’une sur la cohérence globale des postures chinoises, l’autre sur les enjeux liés au contrôle de cette mer enclavée.
Une puissance maritime qui affaiblit le droit de la mer : paradoxe du positionnement chinois
La Chine a fait depuis 2005 le choix du grand large. Elle déploie des efforts considérables pour devenir une puissance maritime globale : moyens militaires, commerciaux, scientifiques, portuaires. Sept des dix plus grands ports à conteneurs du monde sont en Chine, sa flotte de pêche n’a pas d’équivalent, et ses armateurs croissent de manière continue. Sa marine, il y a encore quelques années, côtière, aux missions défensives, est devenue hauturière, capable de projeter la puissance de ses porte-avions et la force de ses unités amphibies. Elle navigue désormais sur tous les océans, dispose de son premier point d’appui à Djibouti. Tous les quatre ans, elle met en service l’équivalent de la marine française. Ce développement s’impose pour accompagner un rayonnement commercial mondial, assurer la sécurité d’une flotte civile croissante et d’une recherche océanographique ambitieuse, protéger la première flotte de pêche au monde déployée elle aussi sur tous les océans, et soutenir une immense diaspora qu’il faut évacuer lorsque la situation l’exige, comme en Libye en 2011. Tout cela nécessite la liberté de mouvement, celle de naviguer, de déplacer ses flottes en fonction des opportunités commerciales ou des nécessités stratégiques. Cette agilité, un des fondements de la puissance maritime, est garantie par la convention internationale sur le droit de la mer. Franchir sans l’accord d’un tiers Malacca, Ormuz, Bab-el-Mandeb, Gibraltar, le Pasde-Calais, ou Bering, doubler Ouessant, les caps Comorin ou de Bonne-Espérance, voilà ce que permet aujourd’hui le droit de la mer et qui assure la prospérité et la puissance de la Chine.
C’est pourtant ce même droit qui est aujourd’hui remis en question par la vision historique d’une mer de Chine méridionale vue comme le prolongement liquide du continent. Il y a là une contradiction manifestement assumée. Elle évoque celle de l’Angleterre du XVIIe siècle dont les rois déclaraient ouvertes les mers lointaines et fermées celles qui baignaient leurs côtes. Ou encore la Venise des Doges qui considérait l’Adriatique comme le golfe de la Sérénissime.
Contradictoire ou réaliste, cette posture mobilise des voisins qui se voient dénier l’accès à des ressources halieutiques ou énergétiques, et des nations maritimes plus lointaines qui veulent préserver le droit de la mer. Quelle perspective de gains peut donc motiver une posture si délicate dont le coût politique est élevé ? Une sécurité alimentaire, dit-on, produite par l’exploitation halieutique, 5 à 8 % des prises mondiales qui alimentent 300 millions de personnes en Asie du Sud-est ; des gains économiques liés à de possibles gisements sous-marins d’hydrocarbures ; des gains militaires qui semblent beaucoup plus hypothétiques – en temps de paix, les avant-postes fortifiés sur les Spratleys contribuent au suivi permanent du flux sortant ou se dirigeant vers Malacca. De même, les vigies des Paracels observent les approches de Hainan où seraient basées des unités chinoises. Toutefois ces fonctions pourraient être assurées par le déploiement continu et agile des nombreuses unités navales et aériennes de la marine ou des gardes côtes. En revanche ces postes fixes sont extrêmement vulnérables. Leurs positions sont immuables. Les installations qu’ils abritent sont connues, répertoriées, cartographiées. Elles ne bénéficient pas de la couverture d’un système de défense global et sont implantées sur des territoires contestés. Elles seraient donc des cibles aux premiers moments d’une crise majeure. Cette ligne Maginot maritime n’apporte rien à la maîtrise du sanctuaire des eaux profondes du nord de la mer de Chine méridionale, une zone d’importance majeure qui permet le déploiement en sûreté de sous-marins stratégiques.
Conclusion
Comme l’Allemagne du début du XXe siècle ou comme l’Union soviétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Chine succombe – après y avoir renoncé pendant cinq siècles – à la tentation de la haute mer. Ce choix a contribué à son développement économique stupéfiant. Sur le plan naval, la géographie lui est très défavorable, ses côtes sont enclavées comme l’étaient celles de l’Allemagne en mer du Nord ou celles des flottes rouges de Baltique et de mer Noire. Est-ce cette raison stratégique pour laquelle, depuis 2009, elle prend le risque de la tension avec ses voisins et celui d’affaiblir un droit de la mer qui lui a tant apporté ? Quoi qu’il en soit, cette situation est exemplaire, elle peut inspirer et légitimer d’autres révisionnismes de la norme internationale. Ce sont ces enjeux, d’une nature universelle, qui ont appelé l’engagement régulier, annoncé, persistant de la France dans cette région.
|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama
|
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr
|
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 3
LES FONDS MARINS : PATRIMOINE COMMUN DE L’HUMANITE
Exercice :
Dissertation :
La notion de « Patrimoine commun de l’humanité » et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins.
Documents de travail :
1) Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, intitulée « Déclarations de principes régissant le fond des mers et océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale »
2) Extraits de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994.
3) Extraits de l’Accord relatif à l’application des Nations Unies de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, signé à New York le 28 juillet 1994 entré en vigueur le 28 juillet 1996.
4) Extraits de l’Avis consultatif rendu le 1er février 2011 par la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, Responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone.
5) Michael LODGE, « L’autorité internationale des fonds marins et l’exploitation minière des grands fonds marins », Chronique ONU, Vol. LIV, n°1&2, mai 2017
Indications bibliographiques :
ANDREONE (G), CALIGIURI (A), Droit de la mer et émergences environnementales, 2012, Editoriale scientifica
BELAID (S.), « Communautarisme et individualisme dans le nouveau droit de la mer », Académie de droit International de La Haye, Recueil des cours, 1982, pp. 137-139.
DELFOUR SAMAMA (O.), « De la notion de « patrimoine commun de l’humanité » à celle de « biens communs de l’humanité ». L’espace océanique, terrain de nouvelles expérimentations normatives et institutionnelles?, R.J.E., 2023, à paraître.
DELFOUR SAMAMA (O.), « Le concept de patrimoine commun de l’humanité, fondement du droit international de l’environnement ? » in Koubi (G.), Muller-Quoy (I.) (dir.), Sur les fondements du droit public. De l’anthropologie au droit, Bruylant, 2003
DUCHARNE (S) « La notion de patrimoine commun de l’humanité », 2002 Mémoire Centre de Droit maritime et des transports, Faculté de droit et sciences politiques Aix Marseille III
DUPUY (R.J.), « La notion de patrimoine commun de l’humanité appliquée aux fonds marins », in. Mélanges Colliard, 1984, p. 197.
DUPUY (R.J.), « La zone, patrimoine commun de l’humanité », in. Dupuy (R.J.) et Vignes (D.), Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Economica, 1985, pp.499-505.
GROULIER, « Quelle effectivité juridique pour le concept de patrimoine commun », A.J.D.A 2005, n°19, p 1034 et s.
JAGOTA (S. P.), « Les fonds marins au –delà des limites des juridictions nationales », in. Bedjaoui (M.) [Dir], Droit international : bilan et perspectives, 1991, pp. 977-1011
KISS (A.), « La notion de patrimoine commun de l’humanité », R.C.A.D.I, vol. 175, 1982-II, pp. 96-256.
LEVY (J.-P.), « L’autorité des fonds marins fête ses 10 ans : bilan et perspectives », L’observateur des Nations Unies, 2004, pp. 23-44.
LEVY (J-P.), « La première décennie de l’Autorité des fonds marins », RGDIP, 2005-1, pp.101-146.
LEVY (J-P), « De quelques modifications et interprétations de la Convention sur le droit de la mer », RGDIP 2007-2, pp. 407-421.
MAHINGA (J-Gr), Le tribunal international du droit de la mer organisation, compétence et procédure, Bruxelles Larcier DL 2013
MARTIN (J-C) « Le régime juridique de l'exploration et l'exploitation des grands fonds marins », Dossier spécial dans le tome 16 de l’Annuaire du droit de la mer. 2011 (parution 2012 - Pedone/Indemer), pp. 277-390.
NICIU (M.I.), « La patrimoine commun de l’humanité en droit international maritime et en droit spatial », Annuaire de droit maritime et aéro-spatial, 1995, pp. 9-15.
ORAISON (A.), « Réflexions générales sur le concept de « patrimoine commun de l’humanité » en droit international de la mer », Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques, 2005-3, vol.83, pp. 249-282.
PANCRACIO (J.-P.), Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, pp. 335-340.
PAQUEROT (S), Le statut des ressources vitales en droit international, essai sur le concept de patrimoine commun de l’humanité, Bruxelles, Bruylant, 2002.
PIQUEMAL (A), « Le fonds des mers, patrimoine commun de l’humanité » Publications du Centre National pour l’exploitation des océans n°2 1973 (accessible en ligne : archimener.ifremer.fr/doc/1973/rapport-4803 PDF)
QUILLERE-MAZJOUB (F), « Glaces polaires et icebergs : quid juris gentium ? », in A.F.D.I 2006 Vol 52 pp. 432-454SAVADOGO (L), « Le régime international des câbles sous-marins », in J.D.I 2013 Vol 1 pp. 45-82
SMOLINSKA (A.M.), Le droit de la mer entre universalisme et régionalisme, Bruxelles Bruylant 2014.
SMOUTS (M-C), « Du patrimoine commun de l’humanité aux biens publics mondiaux », accessible sur le lien : horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-07/... · Fichier PDF
VIGNES (D.), « La fin du schisme des fonds marins », R.B.D.I., 1995, pp. 153-163.
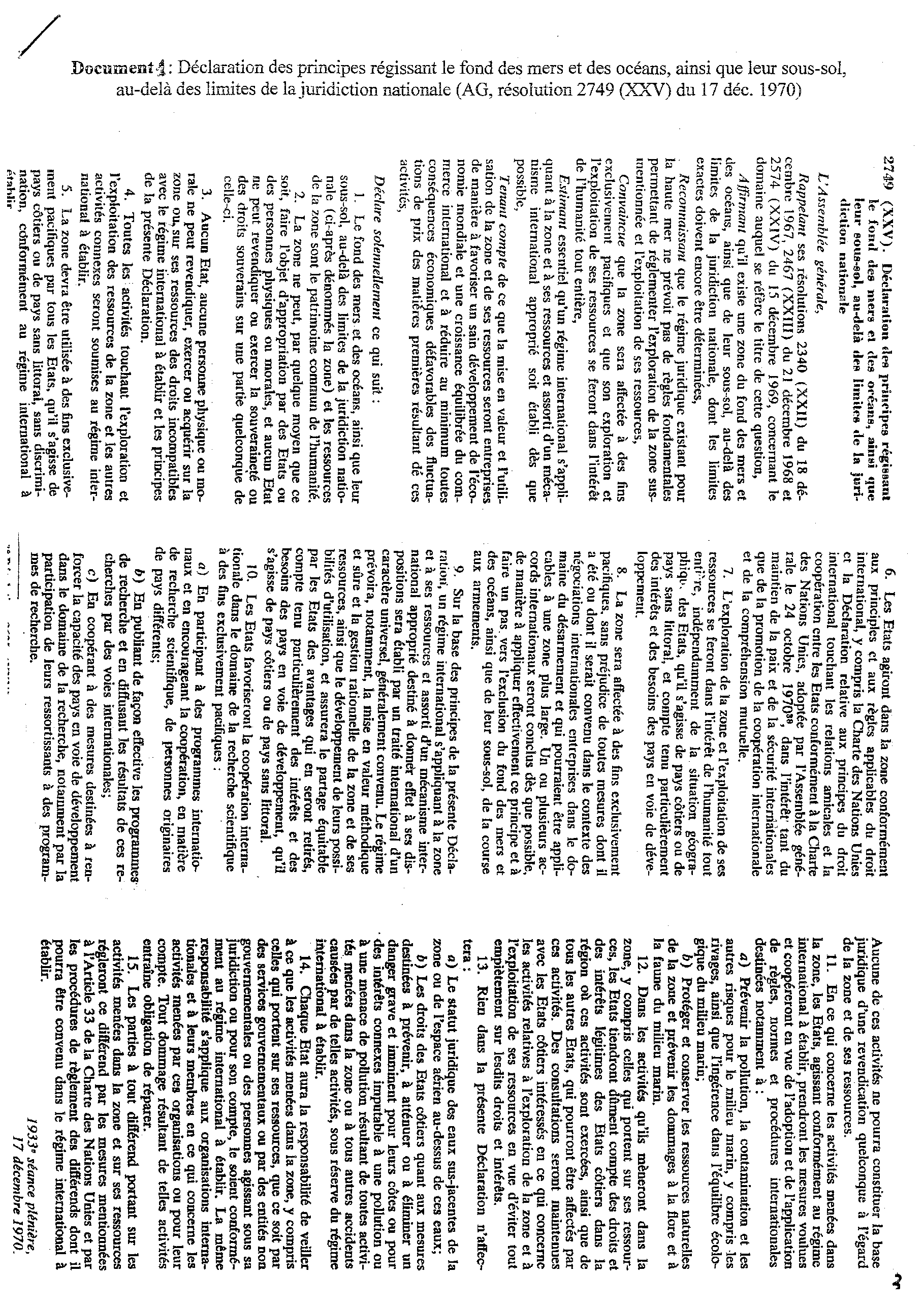
Document n° 2 : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994, Partie XI (extraits).
SECTION 2
Principes régissant la Zone
Article 136
Patrimoine commun de l'humanité
La Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité.
Article 137
Régime juridique de la Zone et de ses ressources
1. Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources ; aucun Etat ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.
2. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'Autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la Zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité.
3. Un Etat ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la Zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus.
…
SECTION 4.
L'Autorité
SOUS-SECTION A.
Dispositions générales
Article 156
Création de l'Autorité
1. Il est créé une Autorité internationale des fonds marins dont le fonctionnement est régi par la présente partie.
2. Tous les Etats Parties sont ipso facto membres de l'Autorité.
3. Les observateurs auprès de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui ont signé l'Acte final et qui ne sont pas visés à l'article 305, paragraphe 1, lettres c), d), e) ou f), ont le droit de participer aux travaux de l'Autorité en qualité d'observateurs, conformément à ses règles, règlements et procédures.
4. L'Autorité a son siège à la Jamaïque.
5. L'Autorité peut créer les centres ou bureaux régionaux qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 157
Nature de l'Autorité et principes fondamentaux
régissant son fonctionnement
1. L'Autorité est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les Etats Parties organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, notamment aux fins de l'administration des ressources de celle-ci, conformément à la présente partie.
2. L'Autorité détient les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
3. L'Autorité est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres.
4. Afin d'assurer à chacun d'eux les droits et avantages découlant de sa qualité de membre, tous les membres de l'Autorité s'acquittent de bonne foi des obligations qui leur incombent en vertu de la présente partie.
Article 158
Organes de l'Autorité
1. Il est créé une Assemblée, un Conseil et un Secrétariat, qui sont les organes principaux de l'Autorité.
2. Il est créé une Entreprise, qui est l'organe par l'intermédiaire duquel l'Autorité exerce les fonctions visées à l'article 170, paragraphe 1.
3. Les organes subsidiaires jugés nécessaires peuvent être créés conformément à la présente partie.
4. Il incombe à chacun des organes principaux de l'Autorité et à l'Entreprise d'exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés. Dans l'exercice de ces pouvoirs et fonctions, chaque organe évite d'agir d'une manière qui puisse porter atteinte ou nuire à l'exercice des pouvoirs et fonctions particuliers conférés à un autre organe.
SOUS-SECTION B
L'Assemblée
Article 159
Composition, procédure et vote
1. L'Assemblée se compose de tous les membres de l'Autorité. Chaque membre a un représentant à l'Assemblée, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
2. L'Assemblée se réunit en session ordinaire tous les ans, et en session extraordinaire chaque fois qu'elle le décide ou lorsqu'elle est convoquée par le Secrétaire général à la demande du Conseil ou de la majorité des membres de l'Autorité.
3. Les sessions de l'Assemblée, à moins qu'elle n'en décide autrement, ont lieu au siège de l'Autorité.
4. L'Assemblée adopte son règlement intérieur. A l'ouverture de chaque session ordinaire, elle élit son président et autant d'autres membres du bureau qu'il est nécessaire. Ils restent en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la session ordinaire suivante.
5. Le quorum est constitué par la majorité des membres de l'Assemblée.
6. Chaque membre de l'Assemblée a une voix.
7. Leurs décisions sur les questions de procédure, y compris la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée, sont prises à la majorité des membres présents et votants.
8. Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette majorité comprenne celle des membres participants à la session. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit d'une question de fond, la question débattue est considérée comme telle, à moins que l'Autorité n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.
9. Lorsqu'une question de fond est sur le point d'être mise aux voix pour la première fois, le Président peut, et doit si un cinquième au moins des membres de l'Assemblée en font la demande, ajourner la décision de recourir au vote sur cette question pendant un délai ne dépassant pas cinq jours civils. Cette règle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à propos de la même question, et son application ne doit pas entraîner l'ajournement de questions au-delà de la clôture de la session.
10. Lorsque le Président est saisi par un quart au moins des membres de l'Autorité d'une requête écrite tendant à ce que l'Assemblée demande un avis consultatif sur la conformité avec la Convention d'une proposition qui lui est soumise au sujet d'une question quelconque, l'Assemblée demande un avis consultatif à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer. Le vote est reporté jusqu'à ce que la Chambre ait rendu son avis. Si celui-ci ne lui est pas parvenu avant la dernière semaine de la session au cours de laquelle il a été demandé, l'Assemblée décide quand elle se réunira pour voter sur la proposition ajournée.
Article 160
Pouvoirs et fonctions
1. L'Assemblée, seul organe composé de tous les membres de l'Autorité, est considérée comme l'organe suprême de celle-ci devant lequel les autres organes principaux sont responsables, ainsi qu'il est expressément prévu dans la Convention. L'Assemblée a le pouvoir d'arrêter, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention, la politique générale de l'Autorité sur toute question ou tout sujet relevant de la compétence de celle-ci.
2. En outre, l'Assemblée a les pouvoirs et fonctions ci-après :
a) élire les membres du Conseil conformément à l'article 161 ;
b) élire le Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Conseil ;
c) élire, sur recommandation du Conseil, les membres du Conseil d'administration de l'Entreprise et le Directeur général de celle-ci ;
d) créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour exercer ses fonctions conformément à la présente partie. En ce qui concerne la composition de tels organes, il est dûment tenu compte du principe de la répartition géographique équitable des sièges, des intérêts particuliers et de la nécessité d'assurer à ces organes le concours de membres qualifiés et compétents dans les domaines techniques dont ils s’occupent ;
e) fixer les contributions des membres au budget d'administration de l'Autorité conformément à un barème convenu, fondé sur le barème utilisé pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, jusqu'à ce que l'Autorité dispose de recettes suffisantes provenant d'autres sources pour faire face à ses dépenses d’administration ;
f) i) examiner et approuver sur recommandation du Conseil, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, ainsi qu'aux contributions prévues à l'article 82, en tenant particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie. Si l'Assemblée n'approuve pas les recommandations du Conseil, elle les renvoie à celui-ci pour qu'ils les réexaminent à la lumière des vues qu'elle a exprimées ;
ii) examiner et approuver les règles, règlements et procédures de l'Autorité, ainsi que tous amendements à ces textes, que le Conseil a provisoirement adoptés en application de l'article 162, paragraphe 2, lettre o), ii). Ces règles, règlements et procédures ont pour objet la prospection, l'exploration et l'exploitation dans la Zone, la gestion financière de l'Autorité et son administration interne et, sur recommandation du Conseil d'administration de l'Entreprise, les virements de fonds de l'Entreprise à l’Autorité ;
g) décider du partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone, d'une manière compatible avec la Convention et les règles, règlements et procédures de l’Autorité ;
h) examiner et approuver le projet de budget annuel de l'Autorité soumis par le Conseil ;
i) examiner les rapports périodiques du Conseil et de l'Entreprise ainsi que les rapports spéciaux demandés au Conseil et à tout autre organe de l’Autorité ;
j) faire procéder à des études et formuler des recommandations tendant à promouvoir la coopération internationale concernant les activités menées dans la Zone et à encourager le développement progressif du droit international et sa codification ;
k) examiner les problèmes de caractère général ayant trait aux activités menées dans la Zone, qui surgissent en particulier pour les Etats en développement, ainsi que les problèmes qui se posent à propos de ces activités à certains Etats en raison de leur situation géographique, notamment aux Etats sans littoral et aux Etats géographiquement désavantagés ;
l) sur recommandation du Conseil, fondée sur l'avis de la Commission de planification économique, instituer un système de compensation ou prendre d'autres mesures d'assistance propres à faciliter l'ajustement économique comme le prévoit l'article 151, paragraphe 10 ;
m) prononcer la suspension de l'exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre, en application de l'article 185 ;
n) délibérer de toute question ou de tout sujet relevant de la compétence de l'Autorité et décider, d'une manière compatible avec la répartition des pouvoirs et fonctions entre les organes de l'Autorité, lequel de ces organes traitera d'une question ou d'un sujet dont l'examen n'a pas été expressément attribué à l'un d'eux.
SOUS-SECTION C Le Conseil
Article 161
Composition, procédure et vote
1. Le Conseil se compose de 36 membres de l'Autorité, élus par l'Assemblée dans l'ordre suivant :
a) quatre membres choisis parmi les Etats Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, 2 p.100 du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste), ainsi que le plus grand consommateur ;
b) quatre membres choisis parmi les huit Etats Parties qui ont effectué, directement ou par l'intermédiaire de leurs ressortissants, les investissements les plus importants pour la préparation et la réalisation d'activités menées dans la Zone, dont au moins un Etat de la région de l'Europe orientale (socialiste) ;
c) quatre membres choisis parmi les Etats Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux Etats en développement dont l'économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux ;
d) six membres choisis parmi les Etats Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des Etats à population nombreuse, des Etats sans littoral ou géographiquement désavantagés, des Etats qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des Etats potentiellement producteurs de tels minéraux et des Etats les moins avancés ;
e) dix-huit membres élus suivant le principe d'une répartition géographique équitable de l'ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu'au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont : l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe orientale (socialiste), ainsi que l'Europe occidentale et autres Etats.
2. Lorsqu'elle élit les membres du Conseil conformément au paragraphe 1, l'Assemblée veille à ce que :
a) la représentation des Etats sans littoral et des Etats géographiquement désavantagés corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l’Assemblée ;
b) la représentation des Etats côtiers, en particulier des Etats en développement, qui ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1, lettre a), b), c) ou d), corresponde raisonnablement à leur représentation au sein de l’Assemblée ;
c) chaque groupe d'Etats Parties devant être représentés au Conseil soit représenté par les membres éventuellement désignés par ce groupe.
(…)
SOUS-SECTION D Le Secrétariat
Article 166
Le secrétariat
1. Le Secrétariat de l'Autorité́ comprend un Secrétaire général et le personnel nécessaire à l'Autorité.
2. Le Secrétaire général est élu par l'Assemblée parmi les candidats proposés par le Conseil pour une durée de quatre ans et il est rééligible.
3. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Autorité́ et agit en cette qualité́ à toutes les réunions de l'Assemblée et du Conseil et de tout organe subsidiaire ; il exerce toutes autres fonctions administratives dont il est chargé par ces organes.
4. Le Secrétaire général présente à l’Assemblée un rapport annuel sur l'activité de l'Autorité.
Document n° 3 : Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, signé à New York le 28 juillet 1994, entré en vigueur le 28 juillet 1996 (extraits).
Les États Parties au présent Accord,
Reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (ci-après dénommée "la Convention") constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,
Réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés "la Zone"), et les ressources de la Zone, sont le patrimoine commun de l'humanité,
Conscients de l'importance que revêt la Convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l'environnement mondial,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur les résultats des consultations officieuses entre États qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommées "la partie XI"),
Notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l'économie de marché, qui affectent l'application de la partie XI,
Désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,
Considérant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l'application de la partie XI,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Application de la partie XI
1. Les États Parties au présent Accord s'engagent à appliquer la partie XI conformément au présent Accord.
2. L'Annexe fait partie intégrante du présent Accord.
Article2
Relation entre le présent Accord et la partie XI
1. Les dispositions du présent Accord et de la partie XI doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et la partie XI, les dispositions du présent Accord l'emportent.
2. Les articles 309 à 319 de la Convention s'appliquent au présent Accord comme ils s'appliquent à la Convention.
…
Annexe
SECTION 1. COÛTS POUR LES ÉTATS PARTIES ET ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS
1. L'Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée "l'Autorité") est l'organisation par l'intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l'administration des ressources de celle-ci. L'Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu'implique nécessairement l'exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États Parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d'économie. Ce principe s'applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.
3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l'Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.
4. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l'Autorité seront exercées par l'Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu'à l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation.
5. Entre l'entrée en vigueur de la Convention et l'approbation du premier plan de travail relatif à l'exploitation, l'Autorité s'attache à :
a) Étudier les demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration conformément à la partie XI et au présent Accord ;
b) Appliquer les décisions de la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international du droit de la mer (ci-après dénommée "la Commission préparatoire") concernant les investisseurs pionniers enregistrés et les États certificateurs, y compris leurs droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 308, paragraphe 5 de la Convention et du paragraphe 13 de la résolution II ;
c) Veiller au respect des plans de travail relatifs à l'exploration approuvés sous la forme de contrats ;
d) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et perspectives en la matière ;
e) Étudier l'impact potentiel de la production de minéraux provenant de la Zone sur les économies des pays en développement producteurs terrestres de ces minéraux qui sont susceptibles d'être le plus gravement affectés afin de réduire au minimum leurs difficultés et de les aider dans leurs efforts d'ajustement économique, compte tenu des travaux réalisés à cet égard par la Commission préparatoire ;
f) Adopter les règles, règlements et procédures nécessaires à la conduite des activités menées dans la Zone au fur et à mesure de leur avancement. Nonobstant les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, lettres b) et c) de l'annexe III de la Convention, ces règles, règlements et procédures tiennent compte des dispositions du présent Accord, des longs délais dans la production commerciale des minéraux marins et du rythme probable des activités menées dans la Zone ;
g) Adopter des règles, règlements et procédures incorporant les normes applicables de protection et de préservation du milieu marin ;
h) Promouvoir et encourager la conduite de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone ainsi que la collecte et la diffusion des résultats des recherches et analyses, lorsqu'ils sont disponibles, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone ;
i) Acquérir les connaissances scientifiques et suivre le développement des technologies marines en rapport avec les activités menées dans la Zone, et en particulier des technologies relatives à la protection et à la préservation du milieu marin ;
j) Évaluer les données disponibles concernant la prospection et l’exploration ;
k) Élaborer en temps voulu des règles, règlements et procédures applicables à l'exploitation, y compris en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.
6. a) Une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est examinée par le Conseil après réception d'une recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son annexe III, ainsi qu'au présent Accord, étant entendu que :
i) Un plan de travail relatif à l'exploration soumis au nom d'un État ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1, lettre a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée l'approbation si l'État ou les États qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des États-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 p.100 au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan de travail, s'il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention ainsi qu'aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Convention, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, paragraphe 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence ;
ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, lettre a) de la résolution II, un investisseur pionnier enregistré peut demander l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration dans les 36 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention. Le plan de travail relatif à l'exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu'après l'enregistrement et être accompagné d'un certificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l'état de l'exécution des obligations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du paragraphe 11, lettre a) de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été approuvé. Il revêtira la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'investisseur pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent Accord. Le droit de 250 000 dollars des États-Unis versé conformément au paragraphe 7, lettre a) de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d'exploration conformément à la section 8, paragraphe 3 de la présente annexe. La section 3, paragraphe 11 de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence ;
iii) Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les États ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) et non moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un État ou une entité, ou à une composante d'une entité, visés au sous-alinéa i) de l'alinéa a), le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-alinéa ii) de l'alinéa a), sous réserve que lesdites dispositions n'affectent pas les intérêts de l'Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables ;
iv) L'État qui patronne une demande d'approbation d'un plan de travail conformément aux dispositions des sous-alinéas i) ou ii) de l'alinéa a) peut être un État Partie, un État qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l'article 7 ou un État qui est membre de l'Autorité à titre provisoire en vertu du paragraphe 12 ;
v) Le paragraphe 8, lettre c) de la résolution II est interprété et appliqué conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) ;
b) Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 153, paragraphe 3 de la Convention.
SECTION 2. L'ENTREPRISE
1. Le Secrétariat de l'Autorité s'acquitte des fonctions de l'Entreprise jusqu'à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l'Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l'exercice de ces fonctions par le Secrétariat.
Il s'agit des fonctions suivantes :
a) Suivre et étudier les tendances et l'évolution touchant les activités d'exploitation des ressources des fonds marins, notamment en analysant régulièrement la situation du marché mondial des métaux ainsi que les cours des métaux et les tendances et les perspectives en la matière ;
b) Évaluer les résultats de la recherche scientifique marine relative aux activités menées dans la Zone, en mettant l'accent en particulier sur les recherches touchant l'impact sur l'environnement des activités menées dans la Zone ;
c) Évaluer les données disponibles concernant les activités de prospection et d'exploration, notamment les critères applicables aux dites activités ;
d) Évaluer les innovations technologiques intéressant les activités menées dans la Zone, et en particulier les techniques relatives à la protection et la préservation du milieu marin ;
e) Évaluer les informations et données relatives aux secteurs réservés à l’Autorité ;
f) Évaluer les approches en matière d'entreprises conjointes ;
g) Rassembler des informations sur la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée ;
h) Étudier les politiques de gestion pouvant être appliquées à l'administration de l'Entreprise aux différentes étapes de ses opérations.
2. L'Entreprise mène ses premières opérations d'exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d'entreprises conjointes. Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploitation présenté par une entité autre que l'Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d'entreprise conjointe avec l'Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l'Entreprise indépendamment du Secrétariat de l'Autorité. S'il estime que les opérations d'entreprise conjointe sont conformes aux principes d'une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l'Entreprise, conformément à l'article 170, paragraphe 2 de la Convention.
3. L'obligation des États Parties de financer un site minier de l'Entreprise prévu à l'annexe IV, article 11, paragraphe 3, de la Convention ne s'applique pas et les États Parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l'Entreprise ou dans le cadre de ses accords d'entreprise conjointe.
4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l'Entreprise. Nonobstant les dispositions de l'article 153, paragraphe 3, et de l'annexe III, article 3, paragraphe 5 de la Convention, tout plan de travail de l'Entreprise revêt, lorsqu'il est approuvé, la forme d'un contrat conclu entre l'Autorité et l'Entreprise.
5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l'Autorité en tant que secteur réservé a un droit de priorité pour conclure avec l'Entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration et de l'exploitation dudit secteur. Si, dans les 15 ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l'Autorité ou dans les 15 ans de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité, si cette date est plus tardive, l'Entreprise ne présente pas de demande d'approbation d'un plan de travail en vue d'activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d'approbation d'un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'Entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.
6. L'article 170, paragraphe 4, l'annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives à l'Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.
SECTION 3. PRISE DE DÉCISIONS
1. Les politiques générales de l'Autorité sont arrêtées par l'Assemblée en collaboration avec le Conseil.
2. En règle générale, les organes de l'Autorité s'efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l'Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l'article 159, paragraphe 8 de la Convention.
4. Les décisions de l'Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l'Assemblée n'accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l'Assemblée.
5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l'opposition de la majorité au sein de l'une quelconque des chambres mentionnées au paragraphe 9. Lorsqu'il prend des décisions, le Conseil s'attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l'Autorité.
Document n° 4 : Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, avis consultatif, 1er février 2011, Responsabilités et obligations des Etats qui patronnent des personnes et entités dans le cadre d’activités menées dans la Zone (extraits).
« (…) Introduction
I. La demande
Le Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins,
Considérant que les activités de développement dans la Zone ont déjà commencé,
Ayant à l’esprit l’échange de vues sur les points de droit entrant dans le cadre de ses activités,
Décide, conformément à l’article 191 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (« la Convention »), de demander à la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer, en application de l’article 131 du Règlement dudit Tribunal, de rendre un avis consultatif sur les questions suivantes :
1. Quelles sont les responsabilités et obligations juridiques des Etats parties à la Convention qui patronnent des activités menées dans la Zone en application de la Convention, en particulier de la partie XI et de l’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ?
2. Dans quelle mesure la responsabilité d’un Etat Partie est-elle engagée à raison de tout manquement aux dispositions de la Convention, en particulier de la partie XI, et de l’Accord de 1994, de la part d’une entité qu’il a patronnée en vertu de l’article 153, paragraphe 2, lettre b), de la Convention ?
3. Quelles sont les mesures nécessaires et appropriées qu’un Etat qui patronne la demande doit prendre pour s’acquitter de la responsabilité qui lui incombe en application de la Convention, en particulier de l’article 139 et de l’annexe III ainsi que de l’Accord de 1994 ?
(…)
II. Evénements ayant conduit à la demande
4. La Chambre juge nécessaire de rappeler les événements ayant conduit à la demande d’avis consultatif :
- Le 10 avril 2008, l’Autorité a reçu deux demandes d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration dans des secteurs réservés aux activités menées par l’Autorité par l’intermédiaire de l’Entreprise ou en association avec des Etats en développement, conformément à l’article 8 de l’annexe III à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (ciaprès dénommée « la Convention »). Ces demandes ont été présentées par la Nauru Ocean Resources Inc. (patronnée par la République de Nauru) et par la Tonga Offshore Mining Ltd. (Patronnée par le Royaume de Tonga) ;
- Ces demandes ont été soumises à la Commission juridique et technique de l’Autorité. Le 5 mai 2009, les auteurs des demandes ont présenté à l’Autorité une requête sollicitant le report de l’examen de ces demandes.
Lors de la quinzième session de l’Autorité, tenue du 25 mai au 5 juin 2009, cette Commission a décidé de reporter l’examen de cette question ;
- Le 1er mars 2010, la République de Nauru a communiqué au Secrétaire général une proposition énoncée dans le document ISBA/16/C/6 visant à solliciter l’avis consultatif de la Chambre sur un certain nombre de questions spécifiques concernant la responsabilité et les obligations des Etats qui patronnent une demande ;
- A l’appui de sa demande, Nauru a présenté, entre autres, les considérations ci-après :
En 2008, la République de Nauru a patronné une demande d’approbation d’un plan de travail présenté par Nauru Ocean Resources Inc. en vue de l’exploration de nodules polymétalliques dans la Zone. Nauru, comme beaucoup d’autres pays en développement, ne possède pas encore les moyens techniques et financiers nécessaires pour mener des opérations d’extraction minière sous-marine dans les eaux internationales. Pour participer effectivement aux activités menées dans la Zone, ces Etats doivent faire appel à des contractants du secteur privé mondial (de la même manière que certains pays en développement ont besoin d’investissements directs étrangers). Non seulement ils n’ont pas les moyens financiers d’exécuter un projet d’extraction minière sous-marine dans les eaux internationales, mais certains n’ont pas non plus les moyens de faire face aux risques juridiques que peut comporter un tel projet. N’ignorant pas cela, lorsqu’il a initialement patronné la société Nauru Ocean Resources Inc., Nauru est parti de l’hypothèse qu’il pourrait effectivement atténuer (avec un degré de certitude élevé) les obligations financières ou coûts pouvant découler de son patronage. Ceci était important car ces obligations ou coûts pourraient dans certaines circonstances excéder de beaucoup les capacités financières de Nauru (comme celles de nombreux autres pays en développement). Si dans le cas d’opérations d’extraction minière terrestre, un Etat ne risque de perdre que ce qu’il a déjà (par exemple, son environnement naturel), un Etat en développement qui verrait sa responsabilité engagée à raison d’activités menées dans la Zone risquerait de perdre plus que ce qu’il a effectivement. (ISBA/16/C/6, paragraphe 1) ; Finalement, si un Etat qui patronne une demande est exposé à d’importants risques financiers, Nauru, comme d’autres pays en développement, risque de ne pas pouvoir participer effectivement aux activités menées dans la Zone, alors que cette participation est l’un des buts et principes de la partie XI de la Convention, et qu’elle est en particulier prévue à l’article 148, à l’alinéa c) de l’article 150 et au paragraphe 2 de l’article 152. Nauru considère donc qu’il est crucial de disposer d’indications sur l’interprétation des dispositions pertinentes de
la partie XI relatives à la responsabilité, afin que les Etats en développement puissent déterminer s’ils sont en mesure de réduire effectivement les risques encourus et décider en connaissance de cause de participer ou non aux activités dans la Zone. (ISBA/16/C/6, paragraphe 5) ;
- La proposition de Nauru a été inscrite à l’ordre du jour de la seizième session du Conseil de l’Autorité et ce point de l’ordre du jour a fait l’objet de débats approfondis au cours des 155ème, 160ème et 161ème séances ;
- Le Conseil a décidé de ne pas adopter la proposition telle que formulée par Nauru. Conformément aux vœux exprimés par de nombreux participants au débat, il a décidé de demander un avis consultatif sur trois questions de portée générale mais succinctes ;
- Ces questions ont été formulées dans la décision ISBA/16/C/13, adoptée par le Conseil à sa 161ème séance le 6 mai 2010. Comme indiqué par l’Autorité dans son exposé écrit et au cours de la procédure orale, la décision du Conseil a été adoptée le 6 mai 2010 « sans vote» et « sans objection » (exposé écrit paragraphe 2.4; Compte rendu du 14 septembre 2010, ITLOS/PV.2010/1/Rev.1, p. 11, lignes 23 à 29).
(…)
IV. Rôle de la Chambre dans les procédures consultatives
25. La Chambre est un organe judiciaire distinct du Tribunal et, par sa compétence contentieuse et consultative, a la tâche exclusive d’interpréter la partie XI de la Convention et les annexes et règles pertinentes qui constituent le fondement juridique de l’organisation et de la gestion des activités menées dans la Zone.
(…)
Question 1
(…)
VII. Intérêts et besoins des Etats en développement
151. En ce qui concerne les activités menées dans la Zone, le cinquième alinéa du préambule de la Convention spécifie que la réalisation des objectifs fixés dans les précédents alinéas : contribuera à la mise en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral.
152. En conséquence, il est nécessaire de déterminer si les Etats qui patronnent, qui sont des Etats en développement, bénéficient d’un traitement en matière de responsabilité plus favorable que celui accordé aux Etats qui patronnent, qui sont des Etats développés, aux termes de la Convention et des instruments qui s’y rapportent.
153. Conformément à l’article 140, paragraphe 1, de la Convention :
« Les activités menées dans la Zone le sont, ainsi qu'il est prévu expressément dans la présente partie, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, qu'il s'agisse d'Etats côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement (...) »
154. Conformément à l’article 148 de la Convention :
« La participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone est encouragée, comme le prévoit expressément la présente partie, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces Etats, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la Zone et de leurs difficultés d'accès à la Zone et depuis celle-ci. »
155. Ces dispositions développent le cinquième alinéa du préambule de la Convention s’agissant des activités menées dans la Zone.
156. Aux fins du présent avis consultatif, et notamment de la Question 1, il importe de préciser le sens de l’article 148 de la Convention. Selon cette disposition, l’objectif général qui consiste à encourager la participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone en tenant compte de leurs intérêts et besoins particuliers doit être atteint « comme le prévoit expressément » la partie XI (expression qui figure également à l’article 140 de la Convention). Ceci signifie qu’il n’existe aucune clause générale destinée à prendre en compte ces intérêts et besoins au-delà des prescriptions des dispositions spécifiques de la partie XI de la Convention. L’analyse de la partie XI fait immédiatement apparaître que plusieurs dispositions ont pour objet de garantir la participation des Etats en développement aux activités menées dans la Zone et de prêter une attention particulière à leurs intérêts et à leurs besoins spécifiques.
157. L’approche adoptée dans la Convention au sujet de cette question ressort particulièrement des dispositions qui octroient une préférence aux Etats en développement qui souhaitent participer à des opérations d’extraction minière sousmarines dans les secteurs des grands fonds marins réservés à l’Autorité (articles 8 et 9 de l’annexe III à la Convention); de l’obligation des Etats de favoriser la coopération internationale en matière de recherches scientifiques marines dans la Zone, en veillant à ce que des programmes soient élaborés « au bénéfice des Etats en développement » (article 143, paragraphe 3, de la Convention); de l’obligation de l’Autorité et des Etats Parties de favoriser le transfert des techniques aux Etats en développement et de permettre au personnel des pays en développement de recevoir une formation aux techniques et sciences marines (article 144, paragraphe 1 et 2, de la Convention, modifié par la section 5 de l’annexe à l’Accord de 1994); de l’autorisation faite à l’Autorité, dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, d’accorder une attention particulière aux Etats en développement, tout en évitant toute discrimination (article 152 de la Convention); de l’obligation faite au Conseil de tenir « particulièrement compte des intérêts et besoins des Etats en développement » lorsqu’il recommande et approuve, respectivement, les règles, règlements et procédures relatifs au partage équitable des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone (articles 160, paragraphe 2, lettre f), alinéa i) et 162, paragraphe 2, lettre o), alinéa i), de la Convention).
158. Toutefois, aucune des dispositions générales de la Convention visant les obligations et la responsabilité qui incombent à l’Etat qui patronne ne « prévoit expressément » qu’un traitement préférentiel doive être accordé à ces Etats lorsqu’ils sont des Etats en développement. Comme il a été constaté plus haut, il n’existe pas de disposition nécessitant la prise en compte de ces intérêts et besoins au-delà de ce qui est expressément prévu dans la Partie XI. On peut donc conclure que les dispositions générales sur les obligations et la responsabilité de l’Etat qui patronne s’appliquent de la même manière à tous les Etats qui patronnent, qu’ils soient en développement ou développés.
159. Cette égalité de traitement entre Etats qui patronnent, qu’ils soient en développement ou développés répond à une nécessité : éviter que des entreprises commerciales ayant leur siège dans des Etats développés créent des sociétés dans des Etats en développement, obtenant ainsi leur nationalité et leur patronage, dans le but de bénéficier d’une réglementation et de contrôles moins stricts. La multiplication d’Etats qui patronnent « de complaisance » compromettrait l’application uniforme des normes les plus élevées de protection du milieu marin, la sécurité du développement des activités menées dans la Zone et la protection du patrimoine commun de l’humanité.
160. De telles observations n’excluent pas que des règles établissant les obligations directes des Etats qui patronnent puissent prévoir un traitement différencié, selon qu’ils sont développés ou en développement.
161. Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe 125, les dispositions du Règlement relatif aux nodules et celles du Règlement relatif aux sulfures qui imposent à l’Etat qui patronne l’obligation d’appliquer l’approche de précaution pour assurer une protection efficace du milieu marin, se réfèrent au principe 15 de la Déclaration de Rio. Comme on l’a déjà observé, le principe 15 dispose que des mesures de précaution doivent être appliquées par les Etats « selon leurs capacités ». En conséquence, les critères de mise en oeuvre de l’obligation d’appliquer l’approche de précaution pourront être plus stricts pour les Etats développés qui patronnent que pour les Etats en développement qui patronnent. La référence à des capacités
différentes contenue dans la Déclaration de Rio ne s’applique toutefois pas à l’obligation d’appliquer « les meilleures pratiques écologiques » énoncée, comme indiqué ci-dessus, à l’article 33, paragraphe 2, du Règlement relatif aux sulfures.
162. En outre, la référence aux « capacités » évoque seulement de manière générale et imprécise les différences entre Etats en développement et Etats développés. C’est le niveau de connaissances scientifiques et de capacités techniques dont dispose un Etat donné dans les domaines scientifiques et techniques pertinents qui est déterminant dans une situation particulière.
163. Il convient de signaler que le cinquième alinéa du préambule de la Convention souligne que la réalisation des objectifs de la Convention « contribuera à la mise en place d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral ». Comme on l’a précédemment noté, l’article 148 de la Convention parle de la participation effective des Etats en développement aux activités menées dans la Zone. Et, fait encore plus important, l’article 9, paragraphe 4, de l’annexe III à la Convention se réfère spécifiquement au droit d’un Etat en développement ou de toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui de notifier à l’Autorité son désir de soumettre un plan de travail pour un secteur réservé. Ces dispositions ont pour effet de réserver à l’Autorité et aux Etats en développement la moitié des secteurs de contrat proposés. Celles-ci, de même que les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 157, doivent être effectivement mises en oeuvre, pour que les Etats en développement soient en mesure de participer aux activités minières relatives aux grands fonds marins sur un pied d’égalité avec les Etats développés. Les Etats en développement devraient recevoir l’assistance nécessaire, y compris dans le domaine de la formation.
(…)
242. Par ces motifs,
LA CHAMBRE,
1. A l’unanimité,
Dit qu’elle a compétence pour donner l’avis consultatif demandé.
2. A l’unanimité,
Décide de donner suite à la demande d’avis consultatif.
3. A l’unanimité,
Répond comme suit à la Question 1 soumise par le Conseil :
Les Etats qui patronnent ont deux types d’obligations aux termes de la Convention et
des instruments qui s’y rapportent.
A. L’obligation de veiller au respect par le contractant patronné des termes du contrat et des obligations énoncées dans la Convention et les instruments qui s’y rapportent.
Il s’agit d’une obligation de « diligence requise ». L’Etat qui patronne est tenu de faire de son mieux pour que les contractants patronnés s’acquittent des obligations qui leur incombent. La norme relative à la diligence requise peut varier dans le temps et dépendre du niveau de risque des activités concernées. Cette obligation de « diligence requise » nécessite que l’Etat qui patronne prenne des mesures au sein de son système juridique. Ces mesures doivent être des lois et règlements et des mesures administratives. Ces mesures doivent répondre à une norme, être « raisonnablement appropriées ».
B. Obligations directes auxquelles les Etats qui patronnent doivent se conformer indépendamment de leur obligation de veiller à ce que les contractants patronnés adoptent une certaine conduite.
Le respect de ces obligations peut aussi être considéré comme un facteur pertinent pour que l’Etat qui patronne s’acquitte de son obligation de « diligence requise ». Les obligations directes les plus importantes incombant à l’Etat qui patronne sont les suivantes :
a) l’obligation d’aider l’Autorité, énoncée à l’article 153, paragraphe 4, de la Convention ;
b) l’obligation d’appliquer une approche de précaution, reflétée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio et énoncée dans le Règlement relatif aux nodules et le Règlement relatif aux sulfures. Il convient aussi de considérer que cette obligation fait partie intégrante de l’obligation de « diligence requise » de l’Etat qui patronne et est applicable au-delà du cadre du Règlement relatif aux nodules et du Règlement relatif aux sulfures ;
c) l’obligation d’appliquer les meilleures pratiques écologiques, énoncée dans le Règlement relatif aux sulfures, mais également applicable dans le contexte du Règlement relatif aux nodules ;
d) l’obligation d’adopter des mesures afin que le contractant fournisse des garanties dans l’éventualité d’ordres en cas d’urgence pour assurer la protection du milieu marin ; et
e) l’obligation d’offrir des voies de recours pour obtenir réparation.
L’Etat qui patronne a l’obligation de diligence requise de veiller à ce que le contractant patronné respecte l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement qui lui est faite au paragraphe 7, de la section1 de l’annexe à l’Accord de 1994. L’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement est également une obligation générale en droit coutumier et est énoncée en tant qu’obligation directe de tous les Etats à l’article 206 de la Convention et en tant qu’un des aspects de l’obligation faite à l’Etat qui patronne d’aider l’Autorité en vertu l’article 153, paragraphe 4, de la Convention.
Ces deux types d’obligations s’appliquent également aux Etats développés et aux Etats en développement, sauf disposition contraire dans les textes applicables, tel que le principe 15 de la Déclaration de Rio, dont il est fait mention dans le Règlement relatif aux nodules et dans le Règlement relatif aux sulfures, selon lequel les Etats doivent appliquer l’approche de précaution « selon leurs capacités ».
Les dispositions de la Convention qui prennent en compte des intérêts et des besoins spécifiques des pays en développement devraient être appliquées effectivement afin que les Etats en développement soient en mesure de participer aux activités minières relatives aux grands fonds marins sur un pied d’égalité avec les Etats développés.
4. A l’unanimité,
Répond comme suit à la Question 2 soumise par le Conseil :
La responsabilité de l’Etat qui patronne est engagée lorsqu’il y a manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et des instruments qui s’y rapportent. Le manquement du contractant patronné à ses obligations n’engage pas automatiquement la responsabilité de l’Etat qui patronne. Les conditions auxquelles la responsabilité de l’Etat qui patronne est engagée sont les suivantes :
a) Manquement de l’Etat qui patronne aux obligations qui lui incombent aux termes de la Convention ;
b) Existence d’un dommage.
La responsabilité de l’Etat qui patronne en cas de manquement à ses obligations de diligence requise nécessite qu’un lien de causalité soit établi entre ce manquement et le dommage. Cette responsabilité est déclenchée par un dommage résultant d’un manquement du contractant patronné à ses obligations.
L’existence d’un lien de causalité entre le manquement de l’Etat qui patronne et le dommage est requise et ne peut être présumée.
L’Etat qui patronne est exonéré de toute responsabilité s’il a pris « toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer le respect effectif », par le contractant patronné, des obligations qui incombent à ce dernier. Cette exonération de responsabilité ne s’applique pas si l’Etat qui patronne a manqué à ses obligations directes.
La responsabilité de l’Etat qui patronne et celle du contractant patronné existent parallèlement et ne sont pas conjointes et solidaires. L’Etat qui patronne n’a pas de responsabilité résiduelle.
En cas de patronage multiple, la responsabilité est conjointe et solidaire sauf si les Règlements de l’Autorité en disposent autrement.
La responsabilité de l’Etat qui patronne doit correspondre au montant effectif du dommage.
Aux termes du Règlement relatif aux nodules et du Règlement relatif aux sulfures, le contractant reste responsable même après l’achèvement de la phase d’exploration. Ceci est également applicable à la responsabilité de l’Etat qui patronne.
Les règles relatives à la responsabilité énoncées dans la Convention et les instruments qui s’y rapportent sont sans préjudice des règles du droit international.
Dans le cas où l’Etat qui patronne a honoré ses obligations, le dommage causé par le contractant patronné n’engage pas la responsabilité de l’Etat qui patronne. Si l’Etat qui patronne a manqué à ses obligations et qu’il n’en est pas résulté de dommages, les conséquences de cet acte illicite sont déterminées par le droit international coutumier.
Il pourrait être envisagé de créer un fonds d’affectation spéciale pour couvrir les dommages non couverts en vertu de la Convention.
5. A l’unanimité,
Répond comme suit à la Question 3 soumise par le Conseil :
La Convention demande que l’Etat qui patronne adopte, au sein de son système juridique, des lois et règlements et prenne des mesures administratives qui ont deux fonctions distinctes, d’une part, faire en sorte que le contractant honore les obligations qui lui incombent, de l’autre, exonérer l’Etat qui patronne de sa responsabilité.
La nature et la portée de ces lois et règlements et des mesures administratives sont fonction du système juridique de l’Etat qui patronne.
Ces lois et règlements et ces mesures administratives peuvent prévoir la mise en place de mécanismes de surveillance active des activités du contractant patronné et de coordination entre les activités de l’Etat qui patronne et celles de l’Autorité.
Les lois et règlements et les mesures administratives devraient être en vigueur aussi longtemps que le contrat passé avec l’Autorité est applicable. L’existence de ces lois et règlements et de ces mesures administratives n’est pas une condition de la conclusion d’un contrat avec l’Autorité ; toutefois, elle est nécessaire pour que l’Etat qui patronne s’acquitte de l’obligation de diligence requise et qu’il puisse être exonéré de sa responsabilité.
Ces mesures nationales devraient aussi couvrir les obligations qui incombent au contractant après l’achèvement de la phase d’exploration, conformément à l’article 30 du Règlement relatif aux nodules et à l’article 32 du Règlement relatif aux sulfures.
Compte tenu de l’exigence selon laquelle les mesures adoptées par l’Etat qui patronne doivent être des lois et règlements et des mesures administratives, on ne saurait considérer que cet Etat a satisfait à ses obligations s’il a seulement conclu un arrangement contractuel avec le contractant.
L’Etat qui patronne ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui concerne l’adoption de lois et règlements et la prise de mesures administratives. Il doit agir de bonne foi en prenant en considération les différentes options qui se présentent à lui d’une manière raisonnable, pertinente et favorable à l’intérêt de l’humanité tout entière.
En matière de protection du milieu marin, les lois et règlements et les mesures administratives de l’Etat qui patronne ne peuvent pas être moins stricts que ceux adoptés par l’Autorité ou moins efficaces que les règles, règlements et procédures internationaux.
Les dispositions que l’Etat qui patronne peut juger nécessaire d’inclure dans sa législation nationale peuvent concerner, entre autres, la viabilité financière et les capacités techniques des contractants patronnés, les conditions régissant la délivrance d’un certificat de patronage et les sanctions en cas de manquement desdits contractants.
Au titre de son obligation de « diligence requise », l’Etat qui patronne doit veiller à ce que les obligations du contractant patronné soient rendues exécutoires. Des indications précises quant au contenu des mesures nationales à prendre par l’Etat qui patronne sont données dans diverses dispositions de la Convention et des instruments qui s’y rapportent. Ceci s’applique, en particulier, aux dispositions de l’article 39 du Statut requérant que les décisions de la Chambre soient exécutoires sur le territoire des Etats Parties au même titre que les arrêts ou ordonnances de la plus haute instance judiciaire de l’Etat Partie sur le territoire duquel l’exécution est demandée (…) ».
Document n°5 : Michael LODGE, « L’autorité internationale des fonds marins et l’exploitation minière des grands fonds marins », Chronique ONU, Vol. LIV, n°1&2, mai 2017
L’océan profond situé au-dessous de 200 mètres est le plus vaste habitat disponible pour le monde vivant et le plus difficile d’accès. Le plancher océanique, comme l’environnement terrestre, est composé de chaînes montagneuses, de plateaux, de pics volcaniques, de canyons et de vastes plaines abyssales. Il contient la plupart des mêmes minéraux que ceux que l’on trouve sur terre, souvent sous des formes enrichies, ainsi que des minéraux qui sont uniques, comme les encroûtements ferromanganésifères et les nodules polymétalliques.
On connaît l’existence de dépôts minéraux dans les parties les plus profondes de l’océan depuis les années 1860. Dans Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, le capitaine Nemo annonce qu’« il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d’argent, d’or qui seraient très certainement facilement exploitables », prédisant que les ressources marines abondantes pourraient répondre aux besoins des êtres humains. S’il avait raison en ce qui concerne l’abondance des ressources, il s’est certainement trompé sur la facilité avec laquelle elles pourraient être exploitées.
Dans les années 1960, une attention particulière a été portée sur les ressources minérales des grands fonds marins après la publication d’un ouvrage du géologue américain John L. Mero intitulé The Mineral Resources of the Sea, où l’auteur expliquait que les fonds marins pourraient devenir une source importante d’approvisionnement pour couvrir nos besoins en minéraux. Cela a amené l’ambassadeur maltais Arvid Pardo à prononcer un discours devant la Première Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies au cours duquel il a demandé que les ressources des fonds marins soient considérées comme le « patrimoine commun de l’humanité » et vivement souhaité la création d’un système de réglementation internationale pour éviter que les pays les plus avancés sur le plan technologique ne colonisent les fonds marins et ne détiennent le monopole sur ces ressources au détriment des pays en développement.
Cette vision grandiose, fidèle à l’esprit des années 1960, est devenue un moteur essentiel des efforts menés par les Nations Unies pour élaborer un cadre global pour la gouvernance des océans entre 1967 et 1982. En 1970, l’Assemblée générale, dans la résolution 2749 (XXV), a adopté la Déclaration des principes régissant le fonds des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale, qui affirmait que les fonds marins devaient être affectés à des fins exclusivement pacifiques. Suivant les conseils d’Arvid Pardo, l’Assemblée a également déclaré que les ressources minérales des fonds marins étaient « le patrimoine commun de l’humanité » devant être développées dans l’intérêt de l’humanité dans le cadre d’un mécanisme international devant être mis en place à cette fin.
Après l’euphorie initiale des années 1970, la chute des cours des métaux, associée à un accès relativement facile aux minéraux dans le monde en développement, a provoqué une perte de l’intérêt pour les activités d’exploitation minière des fonds marins. Il faudra attendre 24 ans pour que le mécanisme proposé par l’Assemblée générale se concrétise sous la forme de l’Autorité internationale des fonds marins, une organisation au sein du système des Nations Unies, dont le siège se trouve à Kingston, en Jamaïque. Tous les États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sont membres de l’Autorité qui est composée de 168 membres, dont l’Union européenne. L’Autorité est l’une des trois institutions internationales établies par la Convention, les deux autres étant la Commission des limites du plateau continental et le Tribunal international du droit de la mer. Sa principale fonction consiste à réglementer l’exploration et l’exploitation des ressources minérales des grands fonds marins situées dans « la Zone », qui est définie par la Convention comme le fonds des mers et le sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, c’est-à-dire, au-delà des limites extérieures du plateau continental. La Zone représente un peu plus de 50 % de l’ensemble des fonds marins.
Aujourd’hui, après des décennies d’oubli relatif, les possibilités d’exploitation commerciale des ressources minérales des grands fonds marins suscitent, de la part du secteur privé et des gouvernements, un regain d’intérêt dû essentiellement à des facteurs comme les avancées technologiques de l’extraction et du traitement des ressources des grands fonds marins et l’augmentation de la demande de minerais suscitée par la mondialisation et l’industrialisation dans le monde en développement. Les gisements minéraux terrestres sont soumis à des pressions croissantes dues aux besoins d’une population mondiale en constante augmentation, à une classe moyenne en pleine expansion qui accélère l’urbanisation et aux besoins de technologies propres, à faibles émissions de carbone. Facilement exploités, les gisements à haute teneur diminuent rapidement. Bien que de nouvelles ressources existent probablement dans la couche intermédiaire ou dans des lieux éloignés, l’exploitation minière de ces gisements terrestres nécessitera de grandes quantités d’énergie et auront des conséquences sociales et environnementales importantes. Certes, la réutilisation croissant des métaux permettra de préserver les ressources, mais ne suffira pas à satisfaire la demande future anticipée. Les ressources minérales des grands fonds marins pourront donc probablement contribuer de plus en plus au développement durable, en particulier pour les pays qui ne possèdent pas de sources d’approvisionnement sûres sur terre ainsi que pour les petits États insulaires en développement où les possibilités de développement économique manquent.
(…)
Dans le cadre de la Convention, l’exploration et l’exploitation des minéraux des fonds marins dans la Zone ne peuvent être entreprises que dans le cadre d’un contrat avec l’Autorité internationale des fonds marins et en étant soumises à ses règles, à ses réglementations et à ses procédures. Les contrats peuvent être conclus à la fois avec des entreprises minières publiques et privées à condition qu’elles soient parrainées par un État partie à la Convention et remplissent certains critères en matière de capacités technologiques et financières. À terme, les avantages économiques de l’exploitation minière des grands fonds marins, sous la forme la plus probable de redevances versées à l’Autorité, devront être partagés dans « l’intérêt de l’humanité toute entière » en mettant particulièrement l’accent sur les pays en développement qui ne possèdent ni les capacités technologiques ni les capitaux pour entreprendre des activités minières dans les fonds marins.
L’Autorité a élaboré des réglementations, y compris des dispositions relatives à la protection environnementale, afin de régir les activités d’exploration. À ce jour, elle a approuvé 28 contrats d’exploration dans les océans Pacifique, Indien et Atlantique, pour une superficie de fonds marins supérieure à 1,3 million de km2. En janvier 2017, la Pologne a présenté la vingt-neuvième demande de contrat d’exploration. Ces contrats sont détenus par les États parties à la Convention ainsi que par les entreprises parrainées par celles-ci. Parmi les participants gouvernementaux figurent la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et l’Organisation mixte interoceanmetal (un consortium formé par la Bulgarie, Cuba, la République tchèque, la Pologne, la Fédération de Russie et la Slovaquie). Des contrats ont été aussi octroyés à un groupe de plus en plus important d’entités privées parrainées à la fois par les États parties des pays développés et de ceux en développement, y compris les petits États insulaires en développement comme les îles Cook, Kiribati, Nauru, Singapour et Tonga.
L’Autorité se consacre actuellement à la mise en place d’un code de réglementation de l’exploitation de ces ressources. Cela comprend la prise en compte des questions technologiques, financières et environnementales. Bien que le matériel minier requis pour chaque type utilise des technologies différentes, l’idée de base et les méthodes de récupération sont similaires. Dans chaque cas, des engins collecteurs entreront en contact avec le fond marin et récupéreront les minéraux. En ce qui concerne les sulfures massifs et les encroûtements cobaltifères, il s’agira de découper ou de casser les gisements de minéraux pour les détacher du support. Les nodules pourront être prélevés directement du fond marin. Dans tous les cas, les matières extraites, mélangées à l’eau de mer, seront ramenées à la surface par un mécanisme de remontée et transportées sur un navire de surface. Le minerai sera alors séparé de l’eau de mer et transporté dans des usines de transformation sur terre.
À titre d’organisme de réglementation, la principale préoccupation de l’Autorité est probablement d’établir un équilibre entre d’un côté les avantages qu’offre à la société l’exploitation minière des grands fonds marins, y compris l’accès aux minéraux essentiels, le non-déplacement des communautés, l’étude approfondie des fonds marins et le développement technologique et, de l’autre côté, la nécessité de protéger l’environnement. Bien entendu, le fait qu’aucune partie de la Zone ne puisse être exploitée sans l’autorisation de l’Autorité permet de s’assurer que les effets environnementaux de l’exploitation minière seront surveillés et contrôlés par un organisme international. Cela affirme la reconnaissance d’un principe de précaution en matière de développement des fonds marins. Il est toutefois évident que l’exploitation minière aura, dans une certaine mesure, des conséquences sur l’environnement marin, en particulier près des activités minières. Par exemple, celles-ci pourront entraîner la destruction d’organismes vivants, la disparition de l’habitat et la formation de panaches sédimentaires. D’autres dégâts pourront être causés par le mauvais fonctionnement du mécanisme de remontée et de transport, des fuites hydrauliques et la pollution acoustique et lumineuse. Une grande partie des activités menées par l’Autorité consistent, à ce jour, à s’assurer que les contractants titulaires de contrats recueillent des données de base, en particulier sur la composition et la répartition des espèces vivant dans les fonds marins et mènent des recherches scientifiques pour mieux comprendre les effets à long terme de l’exploitation minière des fonds marins.
L’adoption de la Convention en 1982 a été l’un des plus grands succès des Nations Unies. L’une des principales contributions a été de placer plus de 50 % des fonds marins sous la juridiction internationale, hors de portée d’un seul État. Bien qu’il ait fallu 50 ans d’efforts multilatéraux pour commencer à concrétiser la promesse du « patrimoine commun de l’humanité », tel que l’avait envisagée l’ambassadeur Arvid Pardo, et telle qu’elle avait été exprimée dans la Convention, les perspectives en matière d’exploitation durable des ressources minérales des fonds marins sont plus prometteuses aujourd’hui qu’au cours des 30 dernières années. Gérées efficacement, conformément à l’état de droit tel qu’il est inscrit dans la Convention, l’exploitation minière des grands fonds marins peut contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable 14, en particulier pour les États sans littoral et géographiquement désavantagés ainsi que pour les petits États insulaires qui dépendent considérablement de l’océan et de ses ressources pour leur développement économique.
|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama |
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz |
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 4
L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE
Exercice :
Commentaire : AGNU, résolution72/78 « Déclaration sur le cinquantième anniversaire du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », 7 décembre 2017
Documents de travail :
Document n° 1 : AGNU, résolution 1348(XII) « Question de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques », 13 décembre 1958
Document 2 : Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (1967) (Extraits)
Document n° 2 : Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1972)
Document n° 3 : Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979 (Extraits)
Document n°4 : Déclaration de Bogota, 3 décembre 1976 (Extraits)
Document n°5 : AGNU, résolution72/78 « Déclaration sur le cinquantième anniversaire du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », 7 décembre 2017
Indications bibliographiques :
Bochinger, (S)., Les marchés spatiaux : structure, tendances globales et perspectives, in Achilleas, (P)., Droit de l’espace. Télécommunication – Observation – Navigation – Défense – Exploration, Bruxelles, Larcier, Chapter 2 : 33-46, 2009.
BORIES (C.), dir, Droit de l’espace extra-atmosphérique. Questions d’actualité, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2021
Gorove, (S)., Developments in Space Law – Issues and Policies, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1991.
Markoff, (M. G). Traité de Droit International Public de l’espace, Fribourg, Editions universitaires Fribourg Suisse, 1973.
Document 1 : AGNU, résolution 1348(XII) « Question de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques », 13 décembre 1958
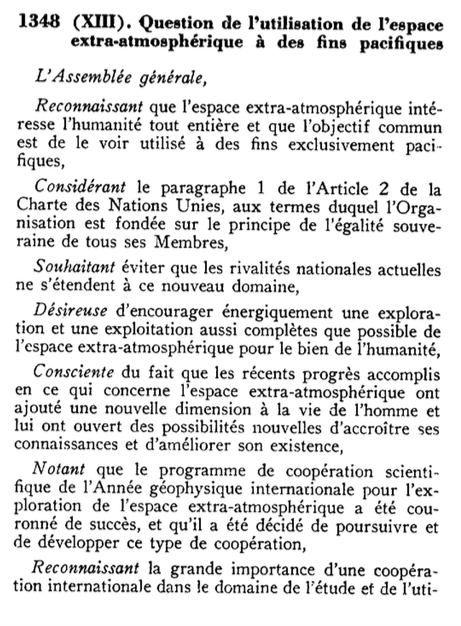
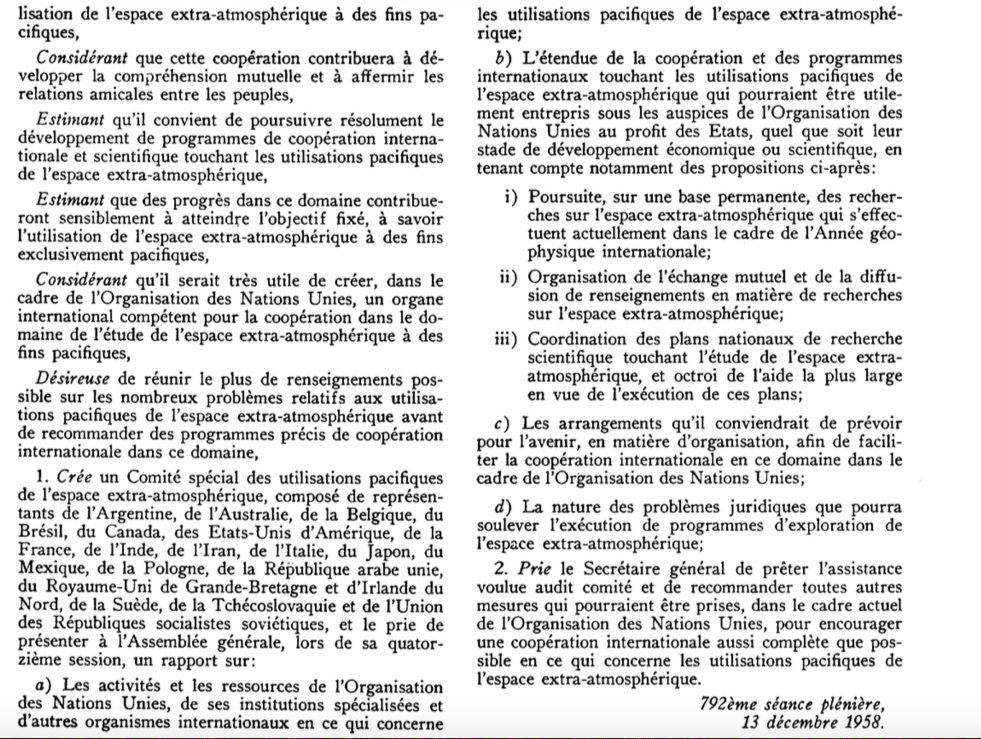
Document n° 2 : Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (1967)
Les États parties au présent Traité,
S’inspirant des vastes perspectives qui s’offrent à l’humanité du fait de la découverte de l’espace extra-atmosphérique par l’homme,
Reconnaissant l’intérêt que présente pour l’humanité tout entière le progrès de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Estimant que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique devraient s’effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique,
Désireux de contribuer au développement d’une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les États et entre les peuples,
Rappelant la résolution 1962 (XVIII), intitulée “Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique”, que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l’unanimité le 13 décembre 1963,
Rappelant la résolution 1884 (XVIII), qui engage les États à s’abstenir de mettre sur orbite autour de la Terre tous objets porteurs d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive et d’installer de telles armes sur des corps célestes, résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée à l’unanimité le 17 octobre 1963,
Tenant compte de la résolution 110 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d’agression, et considérant que ladite résolution est applicable à l’espace extra-atmosphérique,
Convaincus que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, contribuera à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique ; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière.
L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.
Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches.
Article II
L’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.
Article III
Les activités des États parties au Traité relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent s’effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales.
Article IV
Les États parties au Traité s’engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes, de toute autre manière, dans l’espace extra-atmosphérique.
Tous les États parties au Traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes l’aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration pacifique de la Lune et des autres corps célestes.
Article V
Les États parties au Traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l’humanité dans l’espace extra-atmosphérique et leur prêteront toute l’assistance possible en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé sur le territoire d’un autre État partie au Traité ou d’amerrissage en haute mer. En cas d’un tel atterrissage ou amerrissage, le retour des astronautes à l’État d’immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité.
Lorsqu’ils poursuivront des activités dans l’espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d’un État partie au Traité prêteront toute l’assistance possible aux astronautes des autres États parties au Traité.
Les États parties au Traité porteront immédiatement à la connaissance des autres États parties au Traité ou du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les corps célestes, qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.
Article VI
Les États parties au Traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, qu’elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales, et de veiller à ce que les activités nationales soient poursuivies conformément aux dispositions énoncées dans le présent Traité. Les activités des entités non gouvernementales dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance continue de la part de l’État approprié partie au Traité. En cas d’activités poursuivies par une organisation internationale dans l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, la responsabilité du respect des dispositions du présent Traité incombera à cette organisation internationale et aux États parties au Traité qui font partie de ladite organisation.
Article VII
Tout État partie au Traité qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable du point de vue international des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs, sur la Terre, dans l’atmosphère ou dans l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, à un autre État partie au Traité ou aux personnes physiques ou morales qui relèvent de cet autre État.
Article VIII
L’État partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique conservera sous sa juridiction et son contrôle ledit objet et tout le personnel dudit objet, alors qu’ils se trouvent dans l’espace extraatmosphérique ou sur un corps céleste. Les droits de propriété sur les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, y compris les objets amenés ou construits sur un corps céleste, ainsi que sur leurs éléments constitutifs, demeurent entiers lorsque ces objets ou éléments se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique ou sur un corps céleste, et lorsqu’ils reviennent sur la Terre. Les objets ou éléments constitutifs d’objets trouvés au-delà des limites de l’État partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être restitués à cet État partie au Traité, celui-ci étant tenu de fournir, sur demande, des données d’identification avant la restitution.
Article IX
En ce qui concerne l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, les États parties au Traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États parties au Traité. Les États parties au Traité effectueront l’étude de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction de substances extraterrestres et, en cas de besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un État partie au Traité a lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par lui-même ou par ses ressortissants dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d’autres États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, il devra engager les consultations internationales appropriées avant d’entreprendre ladite activité ou expérience. Tout État partie au Traité ayant lieu de croire qu’une activité ou expérience envisagée par un autre État partie au Traité dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de ladite activité ou expérience.
Article X
Pour favoriser la coopération en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conformément aux buts du présent Traité, les États parties au Traité examineront dans des conditions d’égalité les demandes des autres États parties au Traité tendant à obtenir des facilités pour l’observation du vol des objets spatiaux lancés par ces États.
La nature de telles facilités d’observation et les conditions dans lesquelles elles pourraient être consenties seront déterminées d’un commun accord par les États intéressés.
Article XI
Pour favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, les États parties au Traité qui mènent des activités dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, conviennent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, d’informer le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, de la nature et de la conduite de ces activités, des lieux où elles sont poursuivies et de leurs résultats. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies devra être prêt à assurer, aussitôt après les avoir reçus, la diffusion effective de ces renseignements.
Article XII
Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la Lune ou sur d’autres corps célestes seront accessibles, dans des conditions de réciprocité, aux représentants des autres États au Traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée, de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puissent être prises pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l’installation à visiter.
Article XIII
Les dispositions du présent Traité s’appliquent aux activités poursuivies par les États parties au Traité en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, que ces activités soient menées par un État partie au Traité seul ou en commun avec d’autres États, notamment dans le cadre d’organisations intergouvernementales internationales.
Toutes questions pratiques se posant à l’occasion des activités poursuivies par des organisations intergouvernementales internationales en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, seront réglées par les États parties au Traité soit avec l’organisation internationale compétente, soit avec un ou plusieurs des États membres de ladite organisation qui sont parties au Traité.
Article XIV
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont, dans le présent Traité, désignés comme étant les gouvernements dépositaires.
3. Le présent Traité entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Traité, auront déposé leurs instruments de ratification.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Traité ou d’adhésion au présent Traité, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de toute autre communication.
6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XV
Tout État partie au présent Traité peut proposer des amendements au Traité. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie au Traité acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties au Traité et, par la suite, pour chacun des autres États parties au Traité, à la date de son acceptation desdits amendements.
Article XVI
Tout État partie au présent Traité peut, un an après l’entrée en vigueur du Traité, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.
Article XVII
Le présent Traité, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-sept janvier mil neuf cent soixante-sept
Document n° 2 : Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1972) (Extraits)
Les États parties à la présente Convention,
Reconnaissant qu'il est de l'intérêt commun de l'humanité tout entière de favoriser l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,
Tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les États et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d'objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages,
Reconnaissant la nécessité d'élaborer des règles et procédures internationales efficaces relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d'assurer, en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente Convention, d'une indemnisation totale et équitable aux victimes de ces dommages,
Convaincus que l'établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme "dommage" désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d'État ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d'organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens ;
b) Le terme "lancement" désigne également la tentative de lancement ;
c) L'expression "État de lancement" désigne :
i) Un État qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet spatial ;
ii) Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial ;
d) L'expression "objet spatial" désigne également les éléments constitutifs d'un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.
Article II
Un État de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.
Article III
En cas de dommage causé, ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial d'un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial, par un objet spatial d'un autre État de lancement, ce dernier État n'est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.
Article IV
1. En cas de dommage causé, ailleurs qu'à la surface de la Terre, à un objet spatial d'un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial, par un objet spatial d'un autre État de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un État tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers États sont solidairement responsables envers l'État tiers dans les limites indiquées ci-après :
a) Si le dommage a été causé à l'État tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l'État est absolue ;
b) Si le dommage a été causé à un objet spatial d'un État tiers ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d'un tel objet spatial, ailleurs qu'à la surface de la Terre, leur responsabilité envers l'État tiers est fondée sur la faute de l'un d'eux ou sur la faute de personnes dont chacun d'eux doit répondre.
2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers États selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute ; s'il est impossible d'établir dans quelle mesure chacun de ces États était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l'État tiers de chercher à obtenir de l'un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
Article V
1. Lorsque deux ou plusieurs États procèdent en commun au lancement d'un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.
2. Un État de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d'un État auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l'un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
3. Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial est réputé participant à un lancement commun.
Article VI
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un État de lancement est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une faute lourde ou d'un acte ou d'une omission commis dans l'intention de provoquer un dommage, de la part d'un État demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier État représente.
2. Aucune exonération, quelle qu'elle soit, n'est admise dans les cas où le dommage résulte d'activités d'un État de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier, à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
Article VII
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d'un État de lancement :
a) Aux ressortissants de cet État de lancement ;
b) Aux ressortissants étrangers pendant qu'ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu'à sa chute, ou pendant qu'ils se trouvent à proximité immédiate d'une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d'une invitation de cet État de lancement.
Article VIII
1. Un État qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un État de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.
2. Si l'État dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n'a pas présenté de demande en réparation, un autre État peut, à raison d'un dommage subi sur son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un État de lancement.
3. Si ni l'État dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni l'État sur le territoire duquel le dommage a été subi n'ont présenté de demande en réparation ou notifié son intention de présenter une demande, un autre État peut, à raison du dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un État de lancement.
Article IX
La demande en réparation est présentée à l'État de lancement par la voie diplomatique. Tout État qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec cet État de lancement peut prier un État tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet État de lancement. Il peut également présenter sa demande par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'État demandeur et l'État de lancement soient l'un et l'autre Membres de l'Organisation des Nations Unies.
(…)
Article XXI
Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres vitaux, les États parties, et notamment l'État de lancement, examineront la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l'État qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des États parties en vertu de la présente Convention.
Article XXII
1. Dans la présente Convention, à l'exception des articles XXIV à XXVII, les références aux États s'appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l'organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
2. Les États membres d'une telle organisation qui sont des États parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l'organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe précédent.
3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d'un dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des États parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois que :
a) Toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d'abord à l’organisation ; et
b) Seulement dans le cas où l'organisation n'aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l'État demandeur peut invoquer la responsabilité des membres qui sont des États parties à la présente Convention pour le paiement de ladite somme.
4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un État membre de l'organisation qui est un État partie à la présente Convention.
(…)
Document 3 : Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, 5 décembre 1979 (Extraits)
Les États parties au présent Accord,
Notant les succès obtenus par les États dans l’exploration et l’utilisation de la
Lune et des autres corps célestes,
Reconnaissant que la Lune, satellite naturel de la Terre, joue à ce titre un rôle important dans l’exploration de l’espace,
Fermement résolus à favoriser dans des conditions d’égalité le développement continu de la coopération entre États aux fins de l’exploration et de l’utilisation de la Lune et des autres corps célestes,
Désireux d’éviter que la Lune ne puisse servir d’arène à des conflits internationaux,
Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l’exploitation des ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes,
Rappelant le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes1, l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique2, la Convention sur la responsabilité́ internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux3 et Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique4 ,
Prenant en considération la nécessité de définir et de développer, en ce qui concerne la Lune et les autres corps célestes, les dispositions de ces documents internationaux, eu égard aux progrès futurs de l’exploration et de l’utilisation de l’espace,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Les dispositions du présent Accord relatives à la Lune s’appliquent également aux autres corps célestes à l’intérieur du système solaire, excepté la Terre, à moins que des normes juridiques spécifiques n’entrent en vigueur en ce qui concerne l’un de ces corps célestes.
2. Aux fins du présent Accord, toute référence à la Lune est réputée s’appliquer aux orbites autour de la Lune et aux autres trajectoires en direction ou autour de la Lune.
3. Le présent Accord ne s’applique pas aux matières extraterrestres qui atteignent la surface de la Terre par des moyens naturels.
Article 2
Toutes les activités sur la Lune, y compris les activités d’exploration et d’utilisation, sont menées en conformité avec le droit international, en particulier la Charte des Nations Unies, et compte tenu de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies5, adoptée par l’Assemblée générale le 24 octobre 1970, dans l’intérêt du maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour encourager la coopération internationale et la compréhension mutuelle, les intérêts respectifs de tous les autres États parties étant dûment pris en considération.
Article 3
1. Tous les États parties utilisent la Lune exclusivement à des fins pacifiques.
2. Est interdit tout recours à la menace ou à l’emploi de la force ou à tout autre acte d’hostilité ou menace d’hostilité́ sur la Lune. Il est interdit de même d’utiliser la Lune pour se livrer à̀ un acte de cette nature ou recourir à une menace de cette nature à l’encontre de la Terre, de la Lune, d’engins spatiaux, de l’équipage d’engins spatiaux ou d’objets spatiaux créés par l’homme.
3. Les États parties ne mettent sur orbite autour de la Lune, ni sur une autre trajectoire en direction ou autour de la Lune, aucun objet porteur d’armes nucléaires ou de tout autre type d’armes de destruction massive, ni ne placent ou n’utilisent de telles armes à la surface ou dans le sol de la Lune.
4. Sont interdits sur la Lune l’aménagement de bases, installations et fortifications militaires, les essais d’armes de tous types et l’exécution de manœuvres militaires. N’est pas interdite l’utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N’est pas interdite non plus l’utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l’exploration et à l’utilisation pacifiques de la Lune.
(…)
Article 6
1. Tous les États parties ont, sans discrimination d’aucune sorte, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, la liberté de recherche scientifique sur la Lune.
2. Dans les recherches scientifiques et conformément aux dispositions du présent Accord, les États parties ont le droit de recueillir et de prélever sur la Lune des échantillons de minéraux et d’autres substances. Ces échantillons restent à la disposition des États parties qui les ont fait recueillir, lesquels peuvent les utiliser à des fins pacifiques. Les États parties tiennent compte de ce qu’il est souhaitable de mettre une partie desdits échantillons à la disposition d’autres États parties intéressés et de la communauté scientifique internationale aux fins de recherche scientifique. Les États parties peuvent, au cours de leurs recherches scientifiques, utiliser aussi en quantités raisonnables pour le soutien de leurs missions des minéraux et d’autres substances de la Lune.
3. Les États parties conviennent qu’il est souhaitable d’échanger, autant qu’il est possible et réalisable, du personnel scientifique et autre au cours des expéditions vers la Lune ou dans les installations qui s’y trouvent.
Article 7
1. Lorsqu’ils explorent et utilisent la Lune, les États parties prennent des mesures pour éviter de perturber l’équilibre existant du milieu en lui faisant subir des transformations nocives, en le contaminant dangereusement par l’apport de matière étrangère ou d’une autre façon. Les États parties prennent aussi des mesures pour éviter toute dégradation du milieu terrestre par l’apport de matière extraterrestre ou d’une autre façon.
2. Les États parties informent le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’ils prennent en application du paragraphe 1 du présent article et, dans toute la mesure possible, lui notifient à l’avance leurs plans concernant le placement de substances radioactives sur la Lune et l’objet de cette opération.
3. Les États parties font rapport aux autres États parties et au Secrétaire général au sujet des régions de la Lune qui présentent un intérêt scientifique particulier afin qu’on puisse, sans préjudice des droits des autres États parties, envisager de désigner lesdites régions comme réserves scientifiques internationales pour lesquelles on conviendra d’accords spéciaux de protection, en consultation avec les organismes compétents des Nations Unies.
Article 8
1. Les États parties peuvent exercer leurs activités d’exploration et d’utilisation de la Lune en n’importe quel point de sa surface ou sous sa surface, sous réserve des dispositions du présent Accord.
2. À cette fin, les États parties peuvent notamment :
a) Poser leurs objets spatiaux sur la Lune et les lancer à partir de la Lune ;
b) Placer leur personnel ainsi que leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux en n’importe quel point à la surface ou sous la surface de la Lune.
Le personnel ainsi que les véhicules, le matériel, les stations, les installations et les équipements spatiaux peuvent se déplacer ou être déplacés librement à la surface ou sous la surface de la Lune.
3. Les activités menées par les États parties conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas gêner les activités menées par d’autres États parties sur la Lune. Au cas où̀ ces activités risqueraient de causer une gêne, les États parties intéressés doivent procéder à des consultations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 15 du présent Accord.
Article 9
1. Les États parties peuvent installer des stations habitées ou inhabitées sur la Lune. Un État partie qui installe une station n’utilise que la surface nécessaire pour répondre aux besoins de la station et fait connaître immédiatement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies l’emplacement et les buts de ladite station. De même, par la suite, il fait savoir chaque année au Secrétaire général si cette station continue d’être utilisée et si ses buts ont changé́.
2. Les stations sont disposées de façon à ne pas empêcher le libre accès à toutes les parties de la Lune du personnel, des véhicules et du matériel d’autres États parties qui poursuivent des activités sur la Lune conformément aux dispositions du présent Accord ou de l’article premier du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
(…)
Article 11
1. La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité, qui trouve son expression dans les dispositions du présent Accord, en particulier au paragraphe 5 du présent article.
2. La Lune ne peut faire l’objet d’aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen.
3. Ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s’y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d’États, d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales, d’organisations nationales ou d’entités gouvernementales, ou de personnes physiques. L’installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d’ouvrages reliés à sa surface ou à son sous-sol, ne crée pas de droits de propriété́ sur la surface ou le sous-sol de la Lune ou sur une partie quelconque de celle-ci. Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice du régime international visé au paragraphe 5 du présent article.
4. Les États parties ont le droit d’explorer et d’utiliser la Lune, sans discrimination d’aucune sorte, dans des conditions d’égalité́ et conformément au droit international et aux dispositions du présent Accord.
5. Les États parties au présent Accord s’engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible. Cette disposition sera appliquée conformément à l’article 18 du présent Accord.
6. Pour faciliter l’établissement du régime international visé au paragraphe 5 du présent article, les États parties informent le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que le public et la communauté scientifique internationale, autant qu’il est possible et réalisable, de toutes ressources naturelles qu’ils peuvent découvrir sur la Lune.
7. Ledit régime international a notamment pour buts principaux :
a) D’assurer la mise en valeur méthodique et sans danger des ressources naturelles de la Lune ;
b) D’assurer la gestion rationnelle de ces ressources ;
c) De développer les possibilités d’utilisation de ces ressources ; et
d) De ménager une répartition équitable entre tous les États parties des avantages qui résulteront de ces ressources, une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu’aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l’exploration de la Lune.
8. Toutes les activités relatives aux ressources naturelles de la Lune sont exercées d’une manière compatible avec les buts énoncés au paragraphe 7 du présent article et avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du présent Accord.
Article 12
1. Les États parties conservent la juridiction ou le contrôle sur leur personnel, ainsi que sur leurs véhicules, matériel, stations, installations et équipements spatiaux se trouvant sur la Lune. La présence sur la Lune desdits véhicules, matériel, stations, installations et équipements ne modifie pas les droits de propriété les concernant.
2. Les dispositions de l’article 5 de l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace dans l’espace extra-atmosphérique sont applicables aux véhicules, aux installations et au matériel, ou à leurs éléments constitutifs, trouvés dans des endroits autres que ceux où ils devraient être.
3. Dans les cas d’urgence mettant en danger la vie humaine, les États parties peuvent utiliser le matériel, les véhicules, les installations, l’équipement ou les réserves d’autres États parties se trouvant sur la Lune. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou l’État partie intéressé en est informé sans retard.
Document 4 : Déclaration de Bogota, 3 décembre 1976 (Extraits)
The undersigned representatives of the States traversed by the Equator met in Bogota, Republic of Colombia, from 29 November through 3 December, 1976 with the purpose of studying the geostationary orbit that corresponds to their national terrestrial, sea, and insular territory and considered as a natural resource. After an exchange of information and having studied in detail the different technical, legal, and political aspects implied in the exercise of national sovereignty of States adjacent to the said orbit, have reached the following conclusions:
1. The Geostationary Orbit as a Natural Resource
The geostationary orbit is a circular orbit on the Equatorial plane in which the period of sideral revolution of the satellite is equal to the period of sideral rotation of the Earth and the satellite moves in the same direction of the Earth's rotation. When a satellite describes this particular orbit, it is said to be geostationary; such a satellite appears to be stationary in the sky, when viewed from the earth, and is fixed on the zenith of a given point of the Equator, whose longitude is by definition that of the satellite.
This orbit is located at an approximate distance of 35,871 Kmts. over the Earth's Equator.
Equatorial countries declare that the geostationary synchronous orbit is a physical fact linked to the reality of our planet because its existence depends exclusively on its relation to gravitational phenomena generated by the earth, and that is why it must not be considered part of the outer space. Therefore, the segments of geostationary synchronous orbit are part of the territory over which Equatorial states exercise their national sovereignty. The geostationary orbit is a scarce natural resource, whose importance and value increase rapidly together with the development of space technology and with the growing need for communication; therefore, the Equatorial countries meeting in Bogota have decided to proclaim and defend on behalf of their peoples, the existence of their sovereignty over this natural resource. The geostationary orbit represents a unique facility that it alone can offer for telecommunication services and other uses which require geostationary satellites.
The frequencies and orbit of geostationary satellites are limited natural resources, fully accepted as such by current standards of the International Telecommunications Union. Technological advancement has caused a continuous increase in the number of satellites that use this orbit, which could result in a saturation in the near future.
The solutions proposed by the International Telecommunications Union and the relevant documents that attempt to achieve a better use of the geostationary orbit that shall prevent its imminent saturation, are at present impracticable and unfair and would considerably increase the exploitation costs of this resource especially for developing countries that do not have equal technological and financial resources as compared to industrialized countries, who enjoy an apparent monopoly in the exploitation and use of its geostationary synchronous orbit. In spite of the principle established by Article 33, sub-paragraph 2 of the International Telecommunications Convention, of 1973, that in the use of frequency bands for space radiocommunications, the members shall take into account that the frequencies and the orbit for geostationary satellites are limited natural resources that must be used efficiently and economically to allow the equitable access to this orbit and to its frequencies, we can see that both the geostationary orbit and the frequencies have been used in a way that does not allow the equitable access of the developing countries that do not have the technical and financial means that the great powers have. Therefore, it is imperative for the equatorial countries to exercise their sovereignty over the corresponding segments of the geostationary orbit.
Document n°5 : AGNU, résolution72/78 « Déclaration sur le cinquantième anniversaire du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », 7 décembre 2017
L’Assemblée générale
Adopte la déclaration suivante :
Déclaration sur le cinquantième anniversaire du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes
Nous, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies réunis à l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,
1.Réaffirmons l’importance des principes énoncés dans la résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale, en date du 13 décembre 1963, intitulée « Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique » ;
2.Rappelons que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2222 (XXI) du 19 décembre 1966, ouvert à la signature à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967 et est entré en vigueur le 10 octobre 1967 ;
3.Notons qu’au 1er janvier 2017, 105 États étaient devenus parties au Traité et que 25 autres États l’avaient signé ;
4.Réaffirmons le rôle fondamental que joue le Traité pour garantir que l’espace continue d’être utilisé à des fins pacifiques et pour promouvoir les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, de manière à favoriser le maintien de la paix et de la sécurité internationales et à servir la coopération et la compréhension internationales ;
5.Sommes convaincus que le Traité et les principes énoncés dans ses articles premiers à XIII continueront de fournir un cadre indispensable à la conduite des activités spatiales, qui continuent de détenir un énorme potentiel pour faire avancer les connaissances humaines, stimuler le progrès socioéconomique pour l’humanité tout entière et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 ;
6.Considérons que les progrès accomplis en matière d’exploration spatiale et le développement des sciences et des techniques spatiales pour le bien de l’humanité tout entière et les initiatives de coopération internationale menées à ces fins ont dépassé toutes les attentes existantes au moment de l’adoption du Traité ;
7.Constatons que, pour les États, les applications des sciences et des techniques spatiales ont considérablement gagné en importance car elles permettent de mieux comprendre l’univers et la Terre, elles favorisent le progrès, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la surveillance de l’environnement, de la gestion des ressources naturelles terrestres, de la gestion des catastrophes, des prévisions météorologiques, de la modélisation du climat, de la protection du patrimoine culturel, de l’informatique, ainsi que de la navigation et des communications par satellite, et elles concourent au bien-être de l’humanité grâce au développement économique, social et culturel ;
8.Sommes fermement convaincus que le renforcement de la viabilité à long terme des activités spatiales exige des efforts aux niveaux national, régional, interrégional et international ;
9.Soulignons l’évolution constante et la nature de plus en plus multidimensionnelle de la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace, ainsi que la complexité fondamentale des progrès scientifiques et technologiques dans le secteur spatial et la diversité croissante des acteurs de ce domaine, et encourageons par conséquent l’établissement d’un partenariat plus solide et le renforcement de la coopération et de la coordination ;
10.Considérons qu’il faut promouvoir davantage la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement ;
11.Engageons tous les États parties au Traité qui mènent des activités spatiales à se fonder sur les principes de la coopération et de l’assistance mutuelle, en tenant dûment compte des intérêts correspondants des autres États parties au Traité ;
12.Sommes inspirés par les perspectives que les activités humaines dans l’espace continuent d’offrir à l’humanité ;
13.Encourageons les États qui ne sont pas encore parties au Traité, en particulier les États membres du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, à envisager de le devenir ;
14.Soulignons, à cet égard, que les avantages qu’offre l’adhésion au Traité, qui fait partie du régime juridique régissant les activités spatiales, sont importants pour tous les États, indépendamment de leur niveau de développement économique ou scientifique, et que le fait d’être partie à cet instrument améliorerait leur capacité de coopérer à l’action internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques ;
15.Réaffirmons le rôle du Traité en tant que pierre angulaire du régime juridique international régissant les activités spatiales et le fait qu’il énonce les principes fondamentaux du droit international de l’espace ;
16.Affirmons que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, conjointement avec son Sous-Comité juridique et son Sous-Comité scientifique et technique, dispose d’une expérience remarquable en ce qui concerne l’élaboration et le développement du régime juridique international régissant les activités spatiales, que dans le cadre de ce régime, les activités spatiales menées par les États, les organisations internationales intergouvernementales et les entités non gouvernementales connaissent un véritable essor et que, par conséquent, les sciences et les techniques spatiales et leurs applications concourent de façon inestimable à la croissance économique et à l’amélioration de la qualité de vie dans le monde entier ;
17.Demandons au Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique et à son Sous-Comité juridique, avec l’appui du Bureau des affaires spatiales du Secrétariat, de continuer de promouvoir l’adhésion le plus large possible au Traité et son application par les États, et d’encourager le développement progressif du droit international de l’espace ;
18.Prions le Bureau des affaires spatiales de continuer de favoriser le renforcement des capacités dans le domaine du droit de l’espace et de la politique spatiale dans l’intérêt de tous les pays et de continuer de fournir une assistance aux pays en développement, à leur demande, aux fins de l’élaboration de la politique et de la législation spatiales nationales, dans le respect du droit international de l’espace.
|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama
|
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz |
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 5
La légitime défense
Exercice :
Commentaire : La légitime défense préventive existe-elle en droit international ?
Documents de travail :
Article 51 de la Charte des Nations unies
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ Etats-Unis), arrêt C.I.J du 27 juin 1986, par. 193-201 (extraits)
Annexe à la Résolution 3314(XXIX) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 14 décembre 1974 (extraits)
CORTEN (O), L’applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël, Revue belge de droit international, 2012, Volume n°1, p 67
VERHOEVEN (J.), « Les étirements de la légitime défense », Annuaire français de droit international, 2002, pp. 49- 80 [extraits].
Van Steenberghe (R.), La légitime défense en droit international public : Statut, contenu et preuve à la lumière de la pratique contemporaine des Etats, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 270-386 [extraits].
INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, « Problèmes actuels du recours à la force en droit international. A. Légitime défense », Session de Santiago – 2007, 27 octobre 2007 [extraits]
Philippe WECKEL, « Nouvelles pratiques américaines en matière de légitime défense ? », Annuaire Français de Relations Internationales, 2005, volume VI, pp. 128-137 (extraits). Disponible sur http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/AFRI2005_weckel.pdf
R. KHERAD, « La paix et la sécurité internationale à l’épreuve du régime des tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) », in Les Nations Unies et l’Afghanistan, Paris, Pedone, 2003, pp. 47-76 [Extraits].
Conseil de sécurité, résolution 1368 (2001), 12 septembre 2001
Conseil de sécurité, Résolution 2249 (2015), 20 novembre 2015.
Bibliographie :
Corten (O.), Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris, Pedone, 2008
CORTEN (O), Les résolutions de l'Institut de droit international sur la légitime défense et sur les actions humanitaires, Revue belge de droit international, 2007, pp. 598-626
COT (J.-P.), PELLET (A.) et FORTEAU (M.), La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, 3ème édition, Paris, Economica, 2005, pp. 1329-1366.
Dubuisson (F.), « La guerre du Liban de l’été 2006 et le droit de la légitime défense », Revue Belge de Droit international, 2006, n° 2, pp. 529-564
EISEMANN (P-M), « L’arrêt de la C.I.J du 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », Annuaire français de droit international, 1986, pp 153-191
GARCIA Thierry, « Recours à la force et droit international », paru dans Perspectives internationales et européennes, Perspectives mis en ligne le 21 juillet 2005, URL: http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=46
Huet (V.), « Les circonstances excluant l’illicéité et le recours à la force », Journal du droit international, 2008, pp. 75-99
KHERAD (R.) [dir.], Légitimes défenses, Paris, LGDJ, 2007, 312 pages.
WECKEL (P.), « L’usage déraisonnable de la force », Revue générale de droit international public, 2003, pp. 377-400
WECKEL (P), Chronique de jurisprudence internationale, Revue générale de droit international public, 2004, pp. 1017-1044
ZOUREK (J.), « Enfin une définition de l’agression », Annuaire français de droit international, 1974, pp. 9-30
Vidéo d’O. CORTEN, « Dans quelle mesure la légitime défense au sens de l'Article 51 de la Charte peut-elle être invoquée en cas d'attaque menée par une entité non-étatique ? », disponible sur le site internet de la bibliothèque audiovisuelle de droit international, à l’adresse suivante : http://legal.un.org/avl/ls/Corten_PS.html
Document n°1 : Article 51 de la Charte des Nations unies
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Document n°2 : CIJ, arrêt du 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ Etats-Unis), par. 193-201 (extraits)
193. La règle générale d’interdiction de la force comporte certaines exceptions. Etant donné l’argumentation avancée par les Etats-Unis pour justifier les faits qui leur sont reprochés par le Nicaragua, la Cour doit s’exprimer sur le contenu du droit de légitime défense, et plus précisément du droit de légitime défense collective. A l’égard, tout d’abord, de l’existence de ce droit elle constate que, selon le libellé de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, le droit naturel (ou « droit inhérent ») que tout Etat possède dans l’éventualité d’une agression armée s’entend de la légitime défense, aussi bien collective qu’individuelle. Ainsi la Charte elle-même atteste l’existence du droit de légitime défense collective en droit international coutumier. En outre, de même que les mentions de certaines déclarations de l’Assemblée générale adoptées par les Etats attestent leur reconnaissance du principe de prohibition de la force sur le plan proprement coutumier, certaines mentions de ces mêmes déclarations jouent le même rôle à l’égard du droit de légitime défense (collective aussi bien qu’individuelle). Ainsi, dans la déclaration déjà citée relative aux principes du droit international touchant les relations amicales entre les Etats conformément à la Charte, les mentions relatives à la prohibition de la force sont suivies d’un paragraphe aux termes duquel :
« Aucune disposition des paragraphes qui précèdent ne sera interprétée comme élargissant ou diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de la Charte concernant les cas dans lesquels l’emploi de la force est licite. »
Cette résolution démontre que les Etats représentés à l’Assemblée générale considèrent l’exception à l’interdiction de la force que constitue le droit de légitime défense individuelle ou collective comme déjà établie par le droit international coutumier.
194. Pour ce qui est des caractéristiques de la réglementation du droit de légitime défense, les Parties, tenant l’existence de ce droit pour démontrée sur le plan coutumier, se sont concentrées sur les modalités qui en conditionnent l’exercice. En raison des circonstances dans lesquelles est né leur différend, elles ne font état que du droit de légitime défense dans le cas d’une agression armée déjà survenue et ne se posent pas la question de la licéité d’une réaction à la menace imminente d’une agression armée. La Cour ne se prononcera donc pas sur ce sujet. Les Parties sont en outre d’accord pour admettre que la licéité de la riposte à l’agression dépend du respect des critères de nécessité et de proportionnalité des mesures prises au nom de la légitime défense. L’existence du droit de légitime défense collective étant établie en droit international coutumier, la Cour doit définir les conditions particulières auxquelles sa mise en œuvre peut avoir à répondre en sus des conditions de nécessité et de proportionnalité rappelées par les Parties.
195. Dans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si 1’Etat intéressé a été victime d’une agression armée. L’invocation de la légitime défense collective ne change évidemment rien à cette situation. L’accord paraît aujourd’hui général sur la nature des actes pouvant être considérés comme constitutifs d’une agression armée. En particulier, on peut considérer comme admis que, par agression armée, il faut entendre non seulement l’action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore « l’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent » (entre autres) à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières, « ou [au] fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action ». Cette description, qui figure à l’article 3, alinéa g), de la définition de l’agression annexée à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale, peut être considérée comme l’expression du droit international coutumier. La Cour ne voit pas de raison de refuser d’admettre qu’en droit international coutumier la prohibition de l’agression armée puisse s’appliquer à l’envoi par un Etat de bandes armées sur le territoire d’un autre Etat si cette opération est telle, par ses dimensions et ses effets, qu’elle aurait été qualifiée d’agression armée et non de simple incident de frontière si elle avait été le fait de forces armées régulières. Mais la Cour ne pense pas que la notion d’ « agression armée » puisse recouvrir non seulement l’action de bandes armées dans le cas ou cette action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d’armements ou d’assistance logistique ou autre. On peut voir dans une telle assistance une menace ou un emploi de la force, ou l’équivalent d’une intervention dans les affaires intérieures ou extérieures d’autres Etats. Il est clair que c’est l’Etat victime d’une agression armée qui doit en faire la constatation. Il n’existe, en droit international coutumier, aucune règle qui permettrait à un autre Etat d’user du droit de légitime défense collective contre le prétendu agresseur en s’en remettant à sa propre appréciation de la situation. En cas d’invocation de la légitime défense collective, il faut s’attendre à ce que 1’Etat au profit duquel ce droit va jouer se déclare victime d’une agression armée.
196. Reste à déterminer si la licéité de la mise en jeu de la légitime défense collective par 1’Etat tiers au profit de 1’Etat agressé dépend également d’une demande que celui-ci lui aurait faite. Une disposition de la charte de l’Organisation des Etats américains peut être citée ici. La Cour, certes, n’a pas compétence pour considérer cet instrument comme applicable au différend, mais elle peut l’examiner aux fins de déterminer s’il éclaire le contenu du droit international coutumier. La Cour constate que la charte de l’organisation des Etats américains comporte un article 3 f) qui énonce notamment le principe que : « l’agression contre un Etat américain constitue une agression contre tous les autres Etats américains » et un article 27 en vertu duquel :
« Toute agression exercée par un Etat contre l’intégrité ou l’inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l’indépendance politique d’un Etat américain sera considérée comme un acte d’agression contre les autres Etats américains ».
197. La Cour note d’autre part qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du traité interaméricain d’assistance mutuelle signé à Rio de Janeiro le 2 septembre 1947 les Hautes Parties contractantes
« Conviennent qu’une attaque armée provenant de quelque Etat contre un Etat américain sera considérée comme une attaque contre tous les Etats américains ; en conséquence, chacune desdites parties contractantes s’engage à aider à faire face à l’attaque, en exercice du droit immanent de légitime défense individuelle ou collective, que reconnaît l’article 51 de la Charte des Nations Unies »
Selon le paragraphe 2 du même article :
« A la demande de 1’Etat ou des Etats directement attaqués, et jusqu’à la décision de l’organe de consultation du système interaméricain, chaque partie contractante pourra déterminer les mesures immédiates qu’elle adoptera individuellement, en accomplissement de l’obligation dont fait mention le paragraphe précédent et conformément au principe de solidarité continentale. »
(Le traité de Rio de 1947 a été modifié par le protocole de San José, Costa Rica, de 1975, mais celui-ci n’est pas encore en vigueur.)
198. La Cour constate qu’aux termes du traité de Rio de Janeiro les mesures de légitime défense collective que va prendre chaque Etat sont arrêtées « à la demande de 1’Etat ou des Etats directement attaqués ». Il est significatif que cette exigence d’une demande de la part de 1’Etat agressé figure dans la convention spécialement consacrée à ces questions d’assistance mutuelle ; elle ne se retrouve pas dans le texte le plus général (la charte de l’organisation des Etats américains). Cependant l’article 28 de la charte de l’organisation des Etats américains prévoit l’application des mesures et des procédures prévues par les « traités spéciaux qui régissent la matière ».
199. Quoi qu’il en soit, la Cour note qu’en droit international coutumier, qu’il soit général ou particulier au système juridique interaméricain, aucune règle ne permet la mise en jeu de la légitime défense collective sans la demande de 1’Etat se jugeant victime d’une agression armée. La Cour conclut que l’exigence d’une demande de 1’Etat victime de l’agression alléguée s’ajoute à celle d’une déclaration par laquelle cet Etat se proclame agressé.
200. A ce point de son arrêt, la Cour peut se demander s’il existe en droit international coutumier une exigence semblable à celle que prévoit le droit conventionnel de la Charte des Nations Unies et qui impose à 1’Etat se prévalant du droit de légitime défense individuelle ou collective de faire rapport à un organe international habilité à se prononcer sur la conformité au droit international des mesures nationales ; que cet Etat entend par là justifier. Ainsi l’article 51 de la Charte des Nations Unies prescrit aux Etats prenant des mesures dans l’exercice de ce droit de légitime défense de les « porter immédiatement » à la connaissance du Conseil de sécurité. Comme la Cour l’a déjà relevé (paragraphes 178 et 188), un principe consacré par un traité mais existant dans le droit international coutumier peut fort bien, dans celui-ci, être affranchi des conditions et modalités dont il est entouré dans le traité. Quelque influence que la Charte, en ces matières, ait pu avoir sur le droit coutumier, il est clair que, sur le plan de ce droit, la licéité de l’exercice de la légitime défense n’est pas conditionnée par le respect d’une procédure aussi étroitement dépendante du contenu d’un engagement conventionnel et des institutions qu’il établit. En revanche, si un Etat invoquait la légitime défense pour justifier des mesures qui normalement enfreindraient aussi bien le principe du droit international coutumier que celui de la Charte, on s’attendrait à ce que les conditions énoncées par la Charte fussent observées. Par conséquent, dans l’examen effectué au titre du droit coutumier, l’absence de rapport au Conseil de sécurité peut être un des éléments indiquant si l’Etat intéressé était convaincu d’agir dans le cadre de la légitime défense.
201. Pour justifier certaines activités comportant l’utilisation de la force, les Etats-Unis se sont prévalus uniquement de l’exercice de leur droit de légitime défense collective. La Cour, cependant, compte tenu notamment de la non-participation des Etats-Unis à la phase relative au fond, croit devoir examiner si le droit international coutumier applicable au présent différend comporte d’autres règles susceptibles de faire disparaître l’illicéité de telles activités. Elle ne voit pas de raison, toutefois, de rouvrir la question des conditions réglementant l’exercice du droit de légitime défense individuelle, qu’elle a déjà étudiées à propos de la légitime défense collective. En revanche, elle doit s’interroger sur l’existence d’une éventuelle justification des activités en question qui se rattacherait non pas au droit de légitime défense collective contre une agression armée mais au droit de prendre des contre-mesures en riposte à un comportement du Nicaragua dont il ne serait pas allégué qu’il est constitutif d’une agression armée. Elle procédera à cet examen en liaison avec l’analyse du principe de non-intervention en droit international coutumier.
Document n°3 : Annexe à la Résolution 3314(XXIX) de l’Assemblée Générale des Nations Unies, 14 décembre 1974 (extraits)
Définition de l’agression
L’Assemblée générale,
Se fondant sur le fait que l’un des buts essentiels de l’Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales et de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix,
Rappelant que le Conseil de sécurité, conformément à l’Article 39 de la Charte des Nations Unies, constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales,
Rappelant également le devoir qu’ont les États, aux termes de la Charte, de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix, la sécurité et la justice internationales,
Ayant à l’esprit que rien, dans la présente Définition, ne sera interprété comme affectant d’une manière quelconque la portée des dispositions de la Charte en ce qui concerne les fonctions et pouvoirs des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Estimant également que l’agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l’emploi illicite de la force, qui renferme, étant donné l’existence de tous les types d’armes de destruction massive, la menace possible d’un conflit mondial avec toutes ses conséquences catastrophiques, et qu’il convient donc à ce stade de donner une définition de l’agression,
(…)
Convaincue que l’adoption d’une définition de l’agression devrait avoir pour effet de décourager un agresseur éventuel, faciliterait la constatation des actes d’agression et l’exécution des mesures propres à les réprimer et permettrait de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la victime et de venir à son aide,
Estimant que, bien que la question de savoir s’il y a eu acte d’agression doive être examinée compte tenu de toutes les circonstances propres à chaque cas, il est néanmoins souhaitable de formuler des principes fondamentaux qui serviront de guide pour le déterminer,
Adopte la Définition de l’agression ci-après :
Article premier
L’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition.
Note explicative. — Dans la présente Définition, le terme "État" :
a) Est employé sans préjuger la question de la reconnaissance ou le point de savoir si un État est Membre de l’Organisation des Nations Unies ;
b) Inclut, le cas échéant, le concept de "groupe d’États".
(…)
Article 3
L’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec elles, les conditions d’un acte d’agression :
a) L’invasion ou l’attaque du territoire d’un État par les forces armées d’un autre État, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un autre État ;
b) Le bombardement, par les forces années d’un État, du territoire d’un autre État, ou l’emploi de toutes armes par un État contre le territoire d’un autre État ;
c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces années d’un autre État ;
d) L’attaque par les forces années d’un État contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l’aviation civiles d’un autre État ;
e) L’utilisation des forces armées d’un État qui sont stationnées sur le territoire d’un autre État avec l’accord de l’État d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l’accord ;
f) Le fait pour un État d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers ;
g) L’envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action.
Article 4
L’énumération des actes ci-dessus n’est pas limitative et le Conseil de sécurité peut qualifier d’autres actes d’actes d’agression conformément aux dispositions de la Charte.
(…)
Article 6
Rien dans la présente Définition ne sera interprété comme élargissant ou diminuant d’une manière quelconque la portée de la Charte, y compris ses dispositions concernant les cas dans lesquels l’emploi de la force est légitime.
(…)
Document n°4 : CORTEN (O), « L’applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies aux relations entre la Palestine et Israël », Revue belge de droit international, 2012, Volume n°1, p 67 [extraits].
Le peuple palestinien dispose incontestablement du droit à disposer de lui-même, comme l’Assemblée générale l’a affirmé à de nombreuses reprises et comme la Cour internationale de Justice l’a rappelé dans son avis du 9 juillet 2004 (C.I.J., Recueil 2004, p.183, §118). Comme on l’a déjà indiqué, il en découle qu’Israël ne peut utiliser la coercition pour l’empêcher d’accéder à l’indépendance, et que, si tel est le cas, le peuple palestinien a le droit de résister et de recevoir un appui à cette fin. Peut-on considérer qu’il s’agit là d’une application particulière du droit de légitime défense tel qu’il est énoncé à l’article 51 de la Charte, l’alternative présentée plus haut entre droit à l’autodétermination et jus contra bellum devant être dépassée ?
C’est en ce sens que de très nombreux États, appartenant essentiellement au mouvement des non-alignés ainsi qu’au « bloc socialiste » se sont prononcés dans les années 1960 à 1970, au sein des Nations Unies. On a ainsi affirmé que « [la guerre de libération est un cas de légitime défense et le maintien du colonialisme est une agression caractérisée », avec pour conséquence l’applicabilité de l’article 51 de la Charte, y compris dans sa dimension collective. Un des arguments avancés était que cet article ne limite pas expressément sa portée aux relations entre États. Cette position, pour être majoritaire, n’a cependant jamais été partagée par la communauté internationale des États dans son ensemble. Un groupe minoritaire – mais significatif – d’États, principalement occidentaux, a maintenu une objection vigoureuse et constante à cette position. Sur le plan des textes applicables, ces États ont relevé que l’article 2, §4, de même que la notion d’agression, n’étaient manifestement applicables qu’aux relations entre États. La situation d’un mouvement de libération nationale ne pouvait donc justifier un recours à la force, a fortiori dans le chef d’États tiers au titre de la légitime défense collective. Raisonner autrement reviendrait non seulement à contourner la lettre mais aussi l’esprit de la règle, en tentant d’y réintroduire le concept de « guerre juste » que la Charte des Nations Unies avait précisément entendu écarter. Une telle proposition serait donc totalement inacceptable au vu des dangers de conflit qu’elle générerait dans les relations internationales, contrairement à l’objet et au but de la prohibition. Cette objection occidentale explique que les textes classiques relatifs au jus contra bellum, comme les résolutions 2625 (XXV), 3314 (XXIX) ou 42/22 de l’Assemblée générale des Nations Unies, ne consacrent aucun droit de légitime défense au profit d’entités autres que les États.
[…]
Dans le cas des mouvements de libération nationale, cette extension [du droit à la légitime défense] était certes envisagée en faveur – et non à l’encontre – d’une partie dont on reconnaissait, par ailleurs, la lutte comme conforme au droit international. Le refus d’accorder à cette partie un droit de légitime défense semble cependant, a fortiori, devoir s’appliquer à l’égard de l’autre partie, qui prive un peuple de son droit à l’autodétermination en violation de la Charte. En ce sens, on imagine mal que les États admettent une légitime défense au profit d’Israël tout en la déniant par principe au peuple palestinien. On revient à l’impératif de symétrie qui irrigue l’ensemble du jus contra bellum, et qui ne peut mener qu’à une seule conclusion : soit la légitime défense est applicable à toutes les parties, soit elle ne peut être invoquée par aucune d’entre elles. Puisqu’on a clairement rejeté son invocation au bénéfice du peuple occupé, on doit logiquement faire de même en ce qui concerne l’État occupant.
[…]
On connaît plusieurs précédents à l’occasion desquels Israël a invoqué la légitime défense pour justifier une intervention militaire en territoire palestinien. On en connaît, en revanche, aucun dans lequel cet argument aurait [été] accepté par la communauté internationale des États dans son ensemble.
Document n°5 : VERHOEVEN (J.), « Les étirements de la légitime défense », Annuaire français de droit international, 2002, pp. 49- 80 [extraits].
Le droit international est celui qui régit les relations entre les sujets de l'ordre juridique international, au premier rang desquels figurent les États. On comprend qu'il ne se préoccupe dès lors en principe que du recours à la force dans les relations entre ces sujets, que ce soit pour l'interdire en principe ou pour l'autoriser exceptionnellement. Autrement dit, il n'y a normalement légitime défense que si l'auteur comme la victime de l'attaque/agression est un État, ce qui ne préjuge pas de l'emploi de la force - un peu théorique... du moins faut-il l'espérer ! - par des personnalités non étatiques.
Nul doute que le terrorisme complique la vérification de l'existence d'une attaque/agression par un État, comme en témoignent les commentaires qui ont entouré les mesures militaires prises au lendemain des attentats de New York et de Washington.
[…]
L'ampleur des dommages et le nombre des victimes des attentats de New- York et de Washington ont naturellement conduit à s'interroger plus fondamentalement sur la pertinence d'une règle qui se refuse en principe à prendre en considération une agression « privée ». On conçoit que l'hypothèse n'ait pas été sérieusement envisagée lors de l'adoption de la Charte, même si le terrorisme international n'était pas inconnu de l'époque. À l'heure où ses négociateurs s'efforçaient de mettre clairement la force hors la loi dans les rapports entre États, il se comprend sans peine qu'ils ne se soient pas attardés sur les conséquences éventuelles de son usage « privé ». S'ensuit-il que la légitime défense ne peut pas être utilisée lorsque l'attaque contre laquelle elle entend protéger son auteur n'est pas d'une manière ou d'une autre imputable à une autorité étatique ? C'est bien la conclusion que la plupart des commentateurs des événements qui ont fait suite aux attentats du 11 septembre défendent, explicitement ou implicitement, quitte à se satisfaire pour trouver un État attaquant/agresseur des liens très lâches qui existent entre les autorités afghanes et les responsables d'Al-Qaida. Certains n'excluent toutefois pas que la légitime défense puisse le cas échéant être invoquée face à une attaque/agression purement « privée ». L'explication est parfois qu'il serait « déraisonnable » de le contester... sans autrement expliciter la raison sur laquelle cette déraison s'appuie hors la manière d'iniquité à laquelle exposeraient des coups répétés contre lesquels un État ne peut pas se défendre. Ce qui mélange tous les vices et vertus du pragmatisme. D'autres n'hésitent pas à prendre en la matière des positions plus catégoriques, considérant que le droit doit enregistrer les changements intervenus - et notamment les nouveaux « acteurs » apparus - dans un milieu qui se globalise. C'est à la réalité matérielle de l'attaque/agression qu'un droit « menschenrechtlich begrûndet und begrenzt » devrait seul être attentif, ce qui correspondrait d'ailleurs au contenu normatif fondamental de l'idée même de la « paix ». Si cela est vrai, il importe peu qu'un État soit ou non directement en cause. L'important est seulement qu'il y ait effectivement une attaque/agression. La voie est dès lors ouverte au terrorisme transnational, exercé par des groupes s'emparant au passage d'une personnalité juridique fonctionnelle dont le principe est affirmé sans autre réticence.
Il y aurait là l'une des expressions du recentrage sur la personne humaine d'un droit international en voie de désétatisation. C'est peut-être un avenir. Dans l'immédiat, on ne peut sans doute qu'être perplexe devant la personnification qui offrirait à son titulaire le seul avantage de pouvoir être bombardé ou combattu. On voit mal comment il ne revendiquerait pas à son tour celui de combattre et de bombarder, le cas échéant en légitime défense... ce qui est plutôt ce que l'on cherche à exclure. Il est plus simple sans doute d'admettre que la violence privée peut, sans autres implications fondamentales, justifier, comme la violence publique mais bien plus exceptionnellement qu'elle, le recours à la légitime défense lorsque cette violence présente l'intensité de l'attaque/agression visée à l'article.
Il est possible que cette extension de la conception traditionnelle de la légitime défense soit jugée utile dans un contexte politique où le terrorisme croît à raison même de la fragilisation de l'État. La difficulté est toutefois que, dans un espace qui a totalement été réparti entre États « souverains », elle conduit inévitablement à frapper l'un ou l'autre d'entre eux pour des actes qui ne leur sont, par hypothèse, pas imputables. On conçoit que le résultat, tout logique qu'il soit, fasse peur. Cela explique que les tenants de l'agression privée veuillent apparemment limiter à la haute mer (et à l'espace extra-atmosphérique) les mesures qui peuvent de plein droit être prises contre les terroristes-agresseurs. La solution est « réaliste ». Mais elle transforme en un exercice de police de navigation dans des espaces soustraits à une souveraineté exclusive un emploi de la force au titre de la légitime défense... ce qui le dénature fondamentalement.
Document n°6 : Van Steenberghe (R.), La légitime défense en droit international public : Statut, contenu et preuve à la lumière de la pratique contemporaine des Etats, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 270-271 (extraits)
« Il est vrai, comme d’aucuns l’ont souligné, que l’article 51 de la Charte ne subordonne pas le déclenchement du droit de légitime défense à une agression armée étatique. Il parle en effet d’agression armée sans mentionner que celle-ci doit être le fait d’un Etat. Il ne semble pas, néanmoins, que l’on puisse en déduire expressément un droit de riposter en légitime défense à une agression armée non étatique. En effet, on se rappellera que cette hypothèse n’a pas été discutée lors des travaux préparatoires de la Charte. […]. On constate, en ce sens, que l’un des premiers projets de texte de l’actuel article 51 de la Charte, présenté par les Etats-Unis, prévoyait l’exercice du droit de légitime défense en réaction à une agression armée par un Etat. Or, les termes « par un Etat » ont été supprimés dans le texte final sans que cette suppression ait suscité de discussion. Cette absence de débats s’explique certainement par la circonstance qu’à l’époque, l’hypothèse d’une agression armée privée, c’est-à-dire d’une attaque de grande envergure commise par des particuliers sans qu’aucun Etat n’y soit substantiellement impliqué, était difficilement concevable dans les faits. Autrement dit, l’hypothèse n’a pas été discutée car elle n’a tout simplement pas été envisagée, ce qui ne signifie pas qu’elle ait été exclue. Aussi doit-on admettre que les contours de la notion d’agression armée, sont, à cet égard, restés incertains au lendemain de l’adoption de la Charte des Nations Unies, la question du droit de réagir en légitime défense à une agression armée non étatique n’ayant été ni discutée ni tranchée ».
[…]
Document n°7 : INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, « Problèmes actuels du recours à la force en droit international. A. Légitime défense », Session de Santiago – 2007 27 octobre 2007 (extraits)
L’Institut,
Conscient des problèmes que pose l’emploi de la force dans les relations internationales ;
Convaincu que le système de sécurité collective établi par la Charte des Nations Unies renforce la paix et la sécurité internationales ;
Reconnaissant l’importance fondamentale de la légitime défense individuelle et collective en tant que réaction des Etats à l’emploi illicite de la force ;
Conscient que les problèmes de la légitime défense des Etats face aux attaques armées par des acteurs non étatiques, ainsi que ceux des rapports entre légitime défense et organisations internationales, nécessitent des études ultérieures de l’Institut ;
Adopte la Résolution suivante :
1. L’article 51 de la Charte des Nations Unies, tel que complété par le droit international coutumier, régit adéquatement l’exercice du droit de légitime défense individuelle et collective.
2. La nécessité et la proportionnalité sont des éléments essentiels des règles applicables à la légitime défense.
3. Le droit de légitime défense de l’Etat visé prend naissance en cas d’attaque armée (« agression armée ») en cours de réalisation ou manifestement imminente. Il ne peut être exercé que lorsqu’il n’existe pas d’alternative licite praticable pour empêcher, arrêter ou repousser l’attaque armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures effectives nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
4. L’Etat visé doit faire immédiatement rapport au Conseil de sécurité sur les actions de légitime défense qu’il a entreprises.
5. Une attaque armée déclenchant le droit de légitime défense doit avoir un certain degré de gravité. Les actions impliquant un emploi de la force de moindre intensité peuvent donner lieu à des contre-mesures conformes au droit international. En cas d’attaque de moindre intensité, l’Etat visé peut également prendre les mesures de police strictement nécessaires pour repousser l’attaque. Il est entendu que le Conseil de sécurité peut prendre des mesures visées au paragraphe 3.
6. Les doctrines de légitime défense « préventive », en l’absence d’une attaque armée en cours de réalisation ou manifestement imminente, n’ont pas de fondement en droit international.
7. En cas de menace d’une attaque armée contre un Etat, seul le Conseil de sécurité a le pouvoir de décider de l’emploi de la force ou de l’autoriser.
8. La légitime défense collective ne peut être exercée qu’à la demande de l’Etat visé.
9. Lorsque le Conseil de sécurité décide, dans le cadre de la sécurité collective, des mesures requises pour le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale, il peut indiquer les conditions auxquelles l’Etat visé est en droit de continuer à employer la force armée.
10. En cas d’attaque armée d’un Etat par un acteur non étatique, l’article 51 de la Charte, tel que complété par le droit international coutumier, s’applique en principe.
Un certain nombre de situations d’attaque armée par des acteurs non étatiques ont été envisagées et quelques réponses préliminaires aux problèmes complexes qu’elles soulèvent pourraient être les suivantes :
(i) Si des acteurs non étatiques lancent une attaque armée sur les instructions, la direction ou le contrôle d’un Etat, ce dernier peut devenir l’objet de l’action en légitime défense de l’Etat visé.
(ii) Si une attaque armée par des acteurs non étatiques est lancée depuis un espace situé hors la juridiction de tout Etat, l’Etat visé peut exercer son droit de légitime défense dans cet espace contre ces acteurs non étatiques.
L’Etat à partir duquel l’attaque armée d’acteurs non étatiques est lancée doit coopérer avec l’Etat visé.
Document n°8 : Philippe WECKEL, « Nouvelles pratiques américaines en matière de légitime défense ? », Annuaire Français de Relations Internationales, 2005, volume VI, pp. 128-137 (extraits)
La Stratégie de sécurité américaine confirme l’adhésion des Etats-Unis à la doctrine de la légitime défense préventive qu’elle s’efforce d’adapter à la menace terroriste en développant le concept d’action « anticipative » : ce dernier justifierait l’emploi de la force pour prévenir même une attaque armée qui devrait se produire à une date indéterminée.
Les universitaires en Europe sont majoritairement hostiles à la légitime défense préventive et, de ce fait, accueillent avec une sévérité particulière cette extension de la prévention que défend l’Administration du Président Bush. De part et d’autre de l’Atlantique, partisans et adversaires de la légitime défense préventive sont persuadés de trouver dans le droit international un soutien à leur thèse. Cette division est préjudiciable à l’autorité de ce droit ; en réalité, le fossé entre les deux approches est plus apparent que réel : les Etats en général n’ont jamais tranché clairement en défaveur de la théorie de la prévention, parce qu’ils n’envisagent pas de se priver du moyen de se défendre avant qu’il ne soit trop tard ; la nécessité d’adapter la stratégie militaire aux nouvelles menaces internationales est également bien perçue par l’ensemble des Etats. Ainsi, la règle du droit de légitime défense des Etats doit et peut être interprétée de manière à intégrer les préoccupations actuelles des responsables politiques et des stratèges. La véritable difficulté se situe cependant dans la mise en œuvre de la nouvelle doctrine américaine : la portée concrète de cette doctrine est restreinte et elle ne permet assurément pas de substituer la légitime défense au mécanisme normal de prévention que constitue la sécurité collective. La Stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis qui a été adoptée dans la précipitation après le 11 septembre 2001 n’est ni un mal absolu, ni la panacée.
Compatibilité de la nouvelle doctrine avec une interprétation évolutive de la légitime défense
Les Etats-Unis n’ont pas seulement annoncé une réorientation de leur politique de sécurité ; ils ont également mentionné la nécessité de modifier le droit international pour l’adapter aux menaces actuelles. On s’abstiendra de critiquer la démarche unilatérale des Etats-Unis : le droit international est évolutif; il n’est pas figé et il est capable d’adaptation lorsque la nécessité sociale l’impose. L’expérience montre qu’une initiative pilote prise par un Etat ou un groupe d’Etats peut engager un processus de mutation du droit international général en provoquant l’adhésion progressive des autres Etats. Toutefois, le droit de légitime défense des Etats est une règle bien établie du droit international : il s’ensuit qu’en défendant une nouvelle pratique de la légitime défense, les Etats-Unis promeuvent seulement une nouvelle interprétation d’une règle déjà existante. L’observation est importante parce que la pratique joue un rôle essentiel dans le processus de formation d’une nouvelle règle coutumière, mais elle n’est prise en compte que de manière incidente, lorsqu’il s’agit seulement d’adopter une nouvelle interprétation d’une règle existante. S’agissant d’une règle coutumière, l’interprétation ne saurait être littérale et elle se fera à la lumière de l’objet et du but de la règle en question. En l’occurrence l’interprète met en balance une règle cardinale du droit international, l’interdiction du recours à la force, avec le droit essentiel de l’Etat de se défendre. Il ne s’agit pas d’un exercice académique, puisque l’interprétation retenue devrait permettre à la règle générale et à son exception de réaliser effectivement leur objet respectif.
Elle ne se détache donc pas des besoins de la pratique internationale et cette adaptabilité de la règle à travers son interprétation pourrait faciliter la réalisation des objectifs poursuivis par les Etats-Unis.
La modification dont les autorités américaines soutiennent l’introduction en droit international est clairement circonscrite. Il s’agit d’une application particulière de la légitime défense au sujet de laquelle subsistent des zones d’ombre. En effet, la Cour internationale de justice (CIJ) a examiné la légitime défense en tant que réplique à une agression; elle a cependant évité, dans l’affaire «Activités militaires (Nicaragua c. Etats-Unis)», de se prononcer sur la possibilité d’user également de la force pour prévenir une agression qui ne s’est pas encore produite (en réalité, la légitime défense préventive n’était pas en cause en l’espèce (3)); l’avis de 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires n’apporte pas non plus d’indication à ce sujet : on relève certes que, dans cet avis, « les notions de menace et d’emploi de la force au sens de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte vont de pair, en ce sens que si, dans un cas donné, l’emploi même de la force est illicite pour quelque raison que ce soit la menace d’y recourir le sera également» (4); cette formule ne permet pas d’affirmer que certaines menaces militaires pourraient être invoquées pour justifier un emploi de la force au titre de l’article 51 de la Charte.
Si la conformité de la légitime défense préventive au droit n’a jamais été tranchée par la Cour internationale de justice, cet article 51 semble à première vue l’exclure, puisque le droit naturel de légitime défense peut être exercé « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée » (la version anglaise est encore plus nette : « if an armed attack occurs»). Faut-il toutefois s’arrêter à cet argument littéral relatif à l’usage de l’indicatif présent dans ce texte ? Je ne le crois pas. Il est usuel dans tous les systèmes juridiques de considérer qu’un dommage « futur » dont la réalisation est inévitable et certaine ouvre droit à réparation au même titre qu’un dommage actuel : ainsi, les juristes sont habitués à traiter les événements inéluctables comme des faits avérés. Le futur dans toute la mesure où il est certain doit être considéré comme actuel. Dans l’article 51 de la Charte l’indicatif présent a été utilisé pour écarter l’application de la légitime défense à une attaque « éventuelle ». On ne saurait en conclure que la Charte interdirait aux Etats de se défendre contre une agression «future».
Dans la Stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, il est affirmé que «depuis des siècles, le droit international reconnaît que les nations n’ont pas besoin de supporter une attaque avant de pouvoir agir légalement pour se défendre contre des forces qui représentent un danger d’attaque imminente».
Or, dans son avis de 1996, la Cour internationale de justice a invité à ne pas perdre de vue «le droit fondamental qu’a tout Etat à la survie, et donc le droit qu’il a de recourir à la légitime défense». Il n’est pas déraisonnable de considérer que tout rejet catégorique de toute forme d’action préventive serait contraire à ce droit fondamental. Il y a d’ailleurs une part d’irréalisme dans la critique radicale adressée par une majorité de la doctrine européenne à la légitime défense préventive, parce qu’aucun Etat au monde ne respecterait une réglementation du recours à la force qui le contraindrait à attendre que sa disparition soit inéluctable avant de réagir. Ce n’est donc pas la fausse évidence tirée d’un argument purement textuel qui peut empêcher de donner à l’article 51 de la Charte une interprétation conforme au droit naturel de légitime défense.
Il faut, en matière de la légitime défense, se prémunir contre les constructions académiques qui ne tiennent pas compte des nécessités militaires ou d’autres exigences pratiques. Les partisans de la légitime défense préventive cèdent aussi volontiers à la théorisation académique et la Stratégie de sécurité nationale s’en fait l’écho. En effet, le gouvernement des Etats-Unis observe que «les universitaires et les juristes internationaux subordonnent généralement la légitimité d’une action préventive à l’existence d’une menace imminente le plus souvent une mobilisation visible de forces terrestres, navales et aériennes en vue d’une attaque ». Or, il s’en faut de beaucoup qu’une telle interprétation puisse être considérée comme représentative d’une opinion largement partagée dans le monde. Permettre une riposte anticipée dès que les préparatifs de l’armée adverse sont connus revient en général à précipiter la guerre à un moment où il est encore possible de l’éviter. Les préparatifs de guerre constituent des éléments de preuve parmi d’autres, dont il peut être tenu compte dans une certaine mesure pour établir qu’une agression se produira; il n’est pas approprié d’ériger ces éléments en conditions d’exercice de la légitime défense, leur autorité dépendant d’une appréciation concrète des circonstances qui entourent une action militaire défensive.
Or, une attaque terroriste n’est pas annoncée par l’accumulation de forces militaires près des frontières ou d’autres préparatifs de guerre qui s’apparentent à un commencement d’exécution de l’agression. L’Administration américaine conclut : «nous devons adapter le concept de menace imminente aux capacités et aux objectifs des adversaires d’aujourd’hui ». Elle envisage par conséquent la possibilité de mener une action anticipative alors même qu’une «incertitude subsiste quant au moment ou au lieu de l’attaque ennemie». Ainsi, la Stratégie nationale de sécurité innove en étendant la légitime défense à des opérations qui anticipent un événement dont le moment ou bien le lieu où il se produira sont encore inconnus.
Là encore, une formule, en l’occurrence la «menace imminente», concentre l’attention et alimente une analyse littérale. Pourtant, la Cour internationale de justice a balayé ces restrictions sémantiques, lorsqu’elle a analysé dans un domaine qui n’est pas celui de la légitime défense, mais qui n’en est pas éloigné la notion de «péril imminent» et elle apporte ainsi un appui involontaire, mais très efficace, à la position des Etats-Unis en faveur de la légitime défense anticipative. En effet, le critère de l’imminence du danger généralement admis dans la doctrine de la légitime défense préventive a également été retenu par la Commission du droit international comme condition de l’«état de nécessité». Cette exigence a toutefois été interprétée de manière large par la Cour dans l’affaire relative au «Projet Gabcíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie)», puisqu’elle estime qu’un événement peut être considéré comme imminent même lorsqu’il est susceptible de survenir à une date indéterminée et lointaine. «L’imminence est synonyme d’immédiateté ou de proximité et dépasse de loin le concept d’éventualité. Comme l’a souligné la Commission du droit international dans son commentaire, le péril .extrêmement grave et imminent doit s’être trouvé peser au moment même sur l’intérêt menacé.» (Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, 2e partie, 1980, p. 48, par. 33). Cela n’exclut pas, selon la Cour, qu’un «péril» qui s’inscrirait dans le long terme puisse être tenu pour «imminent» dès lors qu’il serait établi, au moment considéré, que la réalisation de ce péril, pour lointaine qu’elle soit, n’en serait pas moins certaine et inévitable.
La préoccupation qui anime la Cour de La Haye n’est guère différente de celle qu’a manifestée le gouvernement des Etats-Unis : dès lors que la survenance de l’événement qui doit être évité apparaît inéluctable, rien ne justifie qu’il soit nécessaire de retarder la réaction au risque d’accroître les difficultés et le coût de la prévention. Avec l’interprétation retenue par la Cour mondiale, l’imminence du péril se rapporte à «une proximité causale et non plus temporelle» avec la situation présente. Il est simplement nécessaire d’établir un lien de causalité directe entre cette situation et l’événement futur : le péril est «imminent» parce que toutes les causes de l’événement futur sont déjà présentes actuellement; peu importe que la date de sa réalisation soit encore inconnue. En définitive, il n’y a aucun obstacle d’ordre logique à admettre la légitime défense anticipative tant qu’elle n’est pas étendue à des menaces potentielles. Ce que ne prétendent pas faire les autorités américaines, sauf à confondre la légitime défense avec la guerre «préemptive». La nouvelle doctrine des Etats-Unis semble donc compatible avec la règle de la légitime défense, telle qu’elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence «Gabcikovo-Nagymaros» de la CIJ.
La Stratégie de sécurité nationale envisage l’emploi de la force au titre de la légitime défense contre des groupes terroristes. Sur ce point également on peut difficilement critiquer cette nouvelle doctrine des Etats-Unis au regard des exigences du droit international : on ne saurait raisonnablement leur contester le droit de se défendre contre cette violence. Il reste que le droit d’un Etat de se défendre a une portée bien plus large que le droit d’exercer la légitime défense et qu’il n’est généralement pas nécessaire, ni admissible, d’invoquer cette dernière pour justifier l’emploi de la force contre des groupes privés. On voit que les vraies difficultés soulevées par la politique américaine se situent au niveau de sa mise en œuvre.
Document n°9 R. KHERAD, « La paix et la sécurité internationale à l’épreuve du régime des tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) », in Les Nations Unies et l’Afghanistan, Paris, Pedone, 2003, pp. 47-76 [Extraits].
En tout état de cause, la lecture de ces deux résolutions permet de dire qu’elles ne sont pas dépourvues ni d’ambiguïté ni de contradiction. Il est en effet tout à fait paradoxal que les attaques terroristes soient implicitement qualifiées d’agression armée, puisque le préambule de la résolution 1368 fait référence à la légitime défense, tandis que le paragraphe 1 qualifie le terrorisme de menace à la paix et la sécurité internationales. Or, l’on ne peut procéder de telle manière. Un acte ne peut être qualifié simultanément d’agression armée et de menace à la paix et à la sécurité internationales. Rien n’empêchait le Conseil, en vertu de l’article 39 de la Charte, de qualifier explicitement les attaques terroristes d’acte d’agression, d’autant plus que la gravité des actes et leur ampleur justifiaient une telle qualification, à moins que les membres du Conseil de sécurité n’aient jugé que seuls les actes terroristes imputables à un Etat pouvaient constituer une agression armée. Dans cette hypothèse, il aurait fallu que le Conseil désignât un Etat impliqué dans les attentats terroristes. Ceci n’est pas aisé, d’autant plus que l’article 51 de la Charte des Nations unies ne définit pas l’agression armée et n’exige, à aucun moment, que son auteur soit nécessairement un Etat. Pour combler cette lacune, la doctrine et la jurisprudence se réfèrent à la résolution 3314 (XXIX) de 1974, seul texte juridique existant en la matière. Celle-ci exige que l’Etat soit impérativement impliqué d’une manière directe (article 1er) ou indirecte (article 3 paragraphe g) dans l’acte d’agression. Qu’en est-il donc de l’implication du régime Tâlebân dans les attentats terroristes du 11 septembre ? Le réseau Al-quaeda a t-il agi au nom et pour le compte de l’Afghanistan ou du régime tâlebân ? La CIJ, dans son arrêt du 24 mai 1980 concernant l’Affaire des otages du personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, privilégie la position de subordination effective de l’individu ou groupe d’individus par rapport à l’Etat lors de la commission de l’acte. Selon la Cour, des actes de particuliers pourront être imputés à l’Etat si ceux-ci agissent “ pour le compte de cet Etat”. La Cour réitère sa position, dans son arrêt du 27 juin 1986 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Elle affirme qu’ “il n’est pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on puisse considérer les contras comme agissant en leur nom ”. En conséquence de quoi, la Cour refuse catégoriquement de “qualifier d’agression le soutien, pourtant particulièrement appuyé, des Etats-Unis aux contras nicaraguayens, alors même que ceux-ci se livraient à de multiples actes que l’on pourrait indéniablement qualifier de « terroristes » ”. De même, l’article 8 du projet adopté par la Commission de droit international en matière de responsabilité internationale des Etats, en août 2001, énonce que “ le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat ”. En l’espèce, nous l’avons vu, les tâlebân n’exercent aucune autorité ni sur le réseau Al-quaeda ni sur son chef, Oussama Ben Laden. Ils ne sont donc, en aucune façon, en mesure de commanditer des actes de terrorisme et même de contrôler les actes de ce réseau, d’autant plus, que les tâlebân n’ont jamais prétendu envoyer eux-mêmes les terroristes. De leur côté, les Américains, n’ont jamais prouvé ou même dit le contraire. Il est donc très difficile d’affirmer que le réseau Al-quaeda a agi au nom et pour le compte de l’Afghanistan ou du régime tâlebân. Que ce dernier héberge le réseau Al-quaeda est une chose mais qu’il ait été l’instigateur de l’attentat contre les Etats-Unis en est une autre. En conséquence de quoi l’on peut s’interroger sur la pertinence de l’affirmation américaine selon laquelle les tâlebân et Al-quaeda seraient “virtuellement interchangeables”.
Même si l’on admet que l’acte terroriste peut constituer une agression armée, son attribution à un Etat reste toujours nécessaire, dans l’état actuel du droit international, pour que la légitime défense soit justifiée. Comme le souligne, à juste titre, Alain Pellet : “s’il y a une agression armée mais pas d’Etat derrière, où s’exercera la légitime défense ? Elle s’effectuera nécessairement sur le territoire d’un Etat qui n’est pas concerné. Peut-on alors violer le principe de l’intégrité territoriale ? ”. Quoi qu’il en soit, la qualification des attentats terroristes de menace à la paix et à la sécurité internationales par les résolutions 1368 et 1373 revêt une importance particulière en l’espèce. En effet, en vertu de l’article 51 de la Charte, l’invocation de la légitime défense est exclusivement subordonnée à une agression armée préalable. Cela signifie qu’un Etat, confronté à une simple menace à la paix n’est en aucun cas habilité à agir en légitime défense. Si l’on accepte ce raisonnement, les Etats-Unis, en l’espèce, ne peuvent invoquer le droit naturel de légitime défense pour justifier leur intervention en Afghanistan.
Ceci dit, on est bien obligé, comme le souligne le Professeur Condorelli, de constater que la communauté des Etats, toutes composantes confondues, semble partager la conception d’après laquelle la campagne militaire lancée en Afghanistan par les Etats-Unis relèverait de la légitime défense. Cette interprétation extensive, et sans doute abusive, de la légitime défense jouerait inévitablement en faveur des puissants au détriment des faibles. Comme naguère, le droit des puissants s’opposerait-il, à l’heure actuelle, à la puissance du droit ?
Document n°10: Conseil de sécurité, résolution 1368 (2001), 12 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Résolu à combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes,
Reconnaissant le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte,
1. Condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington (DC) et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Exprime ses plus profondes sympathie et condoléances aux victimes et à leur famille ainsi qu’au peuple et au Gouvernement des États-Unis d’Amérique;
3. Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et souligne que ceux qui portent la responsabilité d’aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes;
4. Appelle également la communauté internationale à redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue et une pleine application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999;
5. Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
Document n° 11: Conseil de sécurité, Résolution 2249 (2015), 20 novembre 2015.
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1267 (1999), 1368 (2001), 1373 (2001), 1618 (2005), 1624 (2005), 2083 (2012), 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015) et les déclarations pertinentes de son président,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’unité de tous les États conformément aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, le moment et les auteurs,
Considérant que, par son idéologie extrémiste violente, ses actes de terrorisme et les attaques violentes et généralisées qu’il continue de perpétrer systématiquement contre les civils, les atteintes flagrantes, systématiques et généralisées qu’il continue de porter aux droits de l’homme et ses violations du droit international humanitaire, notamment celles fondées sur des motifs religieux ou ethniques, son action d’éradication du patrimoine culturel et ses activités de trafic de biens culturels, mais aussi par le contrôle qu’il exerce sur une grande partie du territoire et des ressources naturelles de l’Iraq et de la Syrie et par son recrutement et la formation de combattants terroristes étrangers qui menacent toutes les régions et tous les États Membres, même ceux qui sont loin des zones de conflit, l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, également connu sous le nom de Daech) constitue une menace mondiale d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales, Rappelant que le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida constituent également une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Résolu à combattre par tous les moyens cette menace d’une gravité sans précédent contre la paix et la sécurité internationales,
Prenant note des lettres datées des 25 juin et 20 septembre 2014 émanant des autorités iraquiennes, dans lesquelles celles-ci déclarent que Daech a établi un sanctuaire hors des frontières iraquiennes, qui constitue une menace directe pour la sécurité du peuple et du territoire iraquiens,
Réaffirmant que les États Membres doivent s’assurer que toute mesure prise pour lutter contre le terrorisme est conforme à l’ensemble des obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire,
Déclarant de nouveau que la situation continuera de se détériorer en l’absence d’un règlement politique du conflit syrien et soulignant qu’il importe que soient appliquées les dispositions du Communiqué de Genève en date du 30 juin 2012 qui est joint en annexe à sa résolution 2118 (2013), de la déclaration conjointe sur les conclusions des pourparlers multilatéraux sur la Syrie tenus à Vienne le 30 octobre 2015 et de la Déclaration du Groupe international d’appui pour la Syrie, en date du 14 novembre 2015,
1. Condamne sans équivoque et dans les termes les plus forts les épouvantables attentats terroristes qui ont été commis par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, le 26 juin 2015 à Sousse, le 10 octobre 2015 à Ankara, le 31 octobre 2015 au-dessus du Sinaï, le 12 novembre 2015 à Beyrouth et le 13 novembre 2015 à Paris, et tous les autres attentats commis par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, y compris les prises d’otage et les assassinats, note que cette organisation a la capacité et l’intention de perpétrer d’autres attentats et considère que tous ces actes de terrorisme constituent une menace contre la paix et la sécurité;
2. Exprime ses très sincères condoléances et sa sympathie aux victimes et à leur famille, aux peuples et aux Gouvernements de la Tunisie, de la Turquie, de la Fédération de Russie, du Liban et de la France, ainsi qu’à tous les gouvernements dont les ressortissants ont été pris pour cibles lors des attentats susmentionnés et à toutes les autres victimes du terrorisme;
3. Condamne également dans les termes les plus forts les atteintes flagrantes, systématiques et généralisées aux droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire, ainsi que les actes barbares de destruction et de pillage du patrimoine culturel que continue de commettre l’EIIL, également connu sous le nom de Daech;
4. Réaffirme que ceux qui commettent des actes terroristes, des violations du droit international humanitaire ou des atteintes aux droits de l’homme, ou qui sont d’une manière ou d’une autre responsables de ces actes ou violations, doivent en répondre;
5. Demande aux États Membres qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les mesures nécessaires, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations Unies, au droit international des droits de l’homme, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire, sur le territoire se trouvant sous le contrôle de l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, en Syrie et en Iraq, de redoubler d’efforts et de coordonner leur action en vue de prévenir et de faire cesser les actes de terrorisme commis tout particulièrement par l’EIIL, également connu sous le nom de Daech, par le Front el-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, ainsi que les autres groupes terroristes qui ont été désignés comme tels par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ou qui pourraient par la suite être considérés comme tels par le Groupe international d’appui pour la Syrie avec l’approbation du Conseil de sécurité, conformément à la Déclaration du Groupe en date du 14 novembre, et d’éradiquer le sanctuaire qu’ils ont créé sur une partie significative des territoires de l’Iraq et de la Syrie;
6. Engage les États Membres à intensifier leurs efforts pour endiguer le flux de combattants terroristes étrangers qui se rendent en Iraq et en Syrie et empêcher et éliminer le financement du terrorisme, et prie instamment tous les États Membres de continuer d’appliquer intégralement les résolutions susmentionnées;
7. Exprime son intention d’actualiser rapidement la liste du Comité des sanctions créé par la résolution 1267 afin qu’elle tienne mieux compte de la menace que représente l’EIIL, également connu sous le nom de Daech;
8. Décide de rester saisi de la question.
|
Nantes UNIVERSITÉ
Faculté de droit et des Sciences politiques
|
|
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama
|
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz |
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 6
|
Devoir sur table |
- Temps : deux ou trois heures (à déterminer selon les possibilités de l’emploi du temps)
- Aucun document autorisé
- Forme du devoir : dissertation ou commentaire de texte
- La note du devoir sur table compte pour 1/3 de la note finale de TD
|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama
|
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz |
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 7
Le recours à la force en cas de menace contre la paix : le cas de la Centrafrique
Exercice : commentaire de texte
Commentaire : Résolution 2566 (2021) du conseil de Sécurité des Nations Unies du 12 mars 2021(Centrafrique) (Document 9)
Documents de travail :
- NOVOSSELOFF (A), SARTRE (P), « L’emploi de la force dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Fondements juridiques et organisation politico-militaire », Annuaire français des relations internationales, Volume 7, 1er janvier 2006
- Article 42 de la Charte des Nations unies
- Article 53 de la Charte des Nations unies
- SICILIANOS (L-A), « Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 2008, t. 339 (extraits) pp. 65-109, 120-140, 211.
- Résolution 2127(2013) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 5 décembre 2013 (Centrafrique), Extraits
- Résolution 2134 (2014) du Conseil de Sécurité des Nations unies du 28 Janvier 2014, (Centrafrique), Extraits
- Résolution 2149 (2014) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 10 avril 2014 (Centrafrique), Extraits
- Résolution 2499 (2019) du Conseil de Sécurité des Nations unies du 15 novembre 2019
- Résolution 2566 (2021) du conseil de Sécurité des Nations Unies du 12 mars 2021(Centrafrique)
Bibliographie :
BOISSON de CHAZOURNES (L.), « Les relations entre organisations régionales et organisations universelles », RCADI, t. 347, 2010, pp. 212-406.
CHRISTAKIS (T.), BANNELIER (K.), « Acteur vigilant ou spectateur impuissant ? Le contrôle exercé par le Conseil de sécurité sur les Etats autorisés à recourir à la force », Revue Belge de Droit International, 2004/2, pp. 498-527.
CORTEN (O.), Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris, Pedone, 2008.
GESLIN (A.), « Le pouvoir d’habilitation du Conseil de sécurité : la délégation des pouvoirs du Conseil aux organisations internationales », Revue Belge de Droit International, 2004-2, pp. 484-497.
LAGRANGE (P.), « Sécurité collective et exercice par le Conseil de sécurité du système d’autorisation de la coercition », in Les métamorphoses de la sécurité collective, Droit, Pratique et enjeux stratégiques, Journée franco-tunisienne SFDI, Paris, Pedone, 2004, p. 56 et s.
MOMTAZ (D.), « La délégation par le Conseil de sécurité de l’exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales », Annuaire français de droit international, 1997, pp. 105-115.
VILLANI (U.), « Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », RCADI, t. 290, 2001, pp. 225-436.
WECKEL (P), « Le Chapitre VII de la Charte et son application par le CS », Annuaire français de droit international, 1991, pp. 165-202.
Liens sur la thématique :
•ARCARI (M), « Maintien de la paix et protection des droits de l’homme : l’action du Conseil de sécurité des Nations Unies », paru dans PIE, 2005, http://revel.unice.fr/pie/index.html?id=31
•AMBROSETTI (D), « L’humanitaire comme norme du discours au Conseil de sécurité : une pratique légitimatrice socialement sanctionnée », Cultures & Conflits, mis en ligne le 23 février 2006,
http://conflits.revues.org/1917
•GABARD (V), « Organisations des Nations Unies La République Centrafricaine et le Conseil de sécurité Compte rendu de débats en cours », Bulletin Sentinelle n°368 du 1er décembre 2013 – URL : www.sentinelle-droit-international.fr.
- MOUBITANG (E), « Afrique Centrafrique : La MINUSCA succède à la MISCA », Bulletin numéro 403 du 21/09/2014 – URL : http://pre.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2014/20140921_bull_403/bulletin_sentinelle_403.php#824
- MIRANDA (M.B.), « Sommet UE- Afrique : La France fait concrétiser l'Eufor- RCA », Bulletin numéro 386 du 06/04/2014 – URL : http://pre.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2014/20140406_bull_386/bulletin_sentinelle_386.php#747
- WECKEL (P.), « Centrafrique, la Communauté internationale face aux exactions massives », Bulletin numéro 378 du 16/02/2014 – URL : http://pre.sentinelle-droit-international.fr/bulletins/a2014/20140216_bull_378/bulletin_sentinelle_378.php#704
- Les rapports de l’ONU sur les questions liées au maintien de la paix : http://www.un.org/fr/peace/
Document n°1 : NOVOSSELOFF (A), SARTRE (P), « L’emploi de la force dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Fondements juridiques et organisation politico-militaire », Annuaire français des relations internationales, Volume 7, 1er janvier 2006
La question de l’usage de la force est, pour l’Organisation des Nations Unies et notamment son Conseil de sécurité, une question à la fois récurrente, complexe et taboue. Dès sa création, le Conseil de sécurité a été pris dans une contradiction entre puissance et impuissance : puissance quand ses Etats s’entendent, impuissance quand ils se querellent; puissance quand ils mettent à sa disposition des moyens, impuissance quand ils lui refusent les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses résolutions; puissance quand ils font du Conseil un organe de consensus pour maintenir la paix et la sécurité internationales, impuissance quand ils usent de cet organe pour se déresponsabiliser de cette charge. A l’image de l’Organisation, cette question a évolué avec la mise sur pied des opérations de maintien de la paix à partir des années 1950 : mécanisme non prévu par la Charte mais se situant pleinement dans son esprit, mécanisme au sein duquel l’usage de la force est retenu et n’est utilisé qu’en dernier recours pour continuer à créer les conditions nécessaires à la poursuite de la mission.
La Charte des Nations Unies est en premier lieu fondée sur l’interdiction du recours à «la menace ou à l’emploi de la force » dans les « relations internationales » entre ses membres (art. 2 §4) ; aussi ceux-ci doivent-ils régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Pour Jean Charpentier, « tout le système de la Charte est construit autour de l’interdiction du recours à la force » et, pour Brigitte Stern, « le but du Chapitre VII est le silence des armes. Cette interdiction est une innovation par rapport au Pacte de la Société des Nations (SDN), car ce n’est plus seulement la guerre qui est interdite, mais tout usage de la force dans les rapports internationaux.
En effet, cette prohibition de l’usage de la force a deux limites : l’action collective prévue au Chapitre VII et la légitime défense. Cette interdiction du recours à la force ne s’applique pas à l’usage collectif de la force au nom de l’Organisation internationale : autrement dit, l’Organisation peut, et c’est là où cet article n’est aucunement en contradiction avec les dispositions du Chapitre VII, utiliser la force, désigner un agresseur et mener une action militaire coercitive.
Le Chapitre VII de la Charte («Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression») contient treize articles : les articles 39 à 42 donnent au Conseil de sécurité les pouvoirs nécessaires pour traiter des menaces contre la paix; les cinq articles suivants lui permettent d’user de mesures militaires; les articles 48 à 50 établissent les obligations des Etats membres et les mesures de compensation envers les Etats touchés par les mesures du Conseil; le dernier article (51) donne le droit aux Etats membres d’invoquer un droit de légitime défense, individuelle ou collective. Il fait suite au Chapitre VI consacré au règlement pacifique des différends. Cet ordre reflète les préoccupations des rédacteurs et leurs intentions : le but principal et la mission de l’Organisation dans son ensemble, la vocation de l’ONU, c’est bel et bien le règlement pacifique et la prévention des crises et des conflits. Cependant, toute prévention véritable ne peut se passer d’une possibilité d’action, coercitive si nécessaire. Si le Chapitre VI est le chapitre du consentement, le Chapitre VII est celui de la contrainte.
Le Chapitre VII est intrinsèquement lié au Conseil de sécurité, lequel détient «la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales» (art. 24). En ce sens, le Conseil de sécurité est le seul habilité à autoriser le recours à la force, puisque c’est à lui seul que revient de «constater l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression», types d’action contre lesquelles des mesures de contrainte peuvent s’imposer. C’est en fonction de cette qualification – très subjective, la Charte ne définissant pas les situations – que le Conseil de sécurité devra «recommander» ou «décider quelles mesures» doivent être prises «pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales» (art. 39) : des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (art. 41) ou toute autre action qu’il juge nécessaire «au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres» (art. 42).
L’article 42 parle donc explicitement de l’emploi de la force armée. D’ailleurs, l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité de l’après-Guerre froide décidant le recours possible à la force armée dans une opération de maintien de la paix autorise les Etats membres «à prendre toutes les mesures nécessaires» ou «tous les moyens nécessaires» pour assurer l’application du mandat délivré par le Conseil.
Toutefois, cette capacité d’adaptation du Conseil l’a également conduit à élargir son champ d’action, le champ d’application des dispositions du Chapitre VII et celui de la notion de menace à la paix : il s’est occupé de conflits interétatiques comme de conflits intra-étatiques; il a dû remplir les rôles de policier, de justicier – par l’imposition de sanctions – et de gardien de la paix – par la construction de la paix. Cependant, l’action du Conseil de sécurité s’est trouvée stoppée par un certain nombre de limites constitutives de l’organe, notamment relatives à son manque de moyens militaires et à l’inconstance de ses Etats membres.
Aucune action militaire votée par le Conseil de sécurité ne l’a été selon les termes exacts et précis de la Charte : le Conseil de sécurité a constamment voulu rester dans le flou. Les références aux articles du Chapitre VII n’ont jamais été faites de façon systématique ou ordonnée : le Conseil a préféré aux expressions «guerrières» («usage de la force armée», «agression», «guerre»), le langage plus doux et général de «tous les moyens nécessaires».
Privé d’un organe de conseil militaire (Comité d’état-major) et face à un ordre du jour pléthorique, le Conseil de sécurité ne dispose ni du temps, ni de la compétence, ni des moyens pour conduire la stratégie de ces opérations avec succès et se contente d’en assurer une direction politique coupée des contingences logistiques et ignorante des réalités militaires. Le maintien de la paix constitue pourtant une préoccupation importante du Conseil et sa responsabilité principale (art. 24 de la Charte), celle qui l’expose le plus aux critiques de l’opinion internationale, qui concourt le plus directement et immédiatement à la survie ou à la mort des populations.
L’emploi de la force par les opérations de paix des Nations Unies a fait l’objet de nombreuses critiques. Il est incontestable que le virage de la vie internationale au début des années 1990 a parfois placé l’outil de maintien de la paix en grave difficulté : sa chaîne de commandement n’a par exemple pas su faire face à la situation à Srebrenica et à Kigali. Cependant, lorsqu’on examine le fil des événements, par exemple à travers le rapport «Srebrenica», on est contraint de reconnaître que ces situations ont surtout été le résultat des contradictions des Etats au sein du Conseil de sécurité, qui ont placé des forces de paix inexpérimentées dans des situations intenables. La narration de la gestion de la crise yougoslave, comme celle des crises somalienne et rwandaise, n’est que la douloureuse litanie des erreurs à ne pas commettre, à New York comme sur le terrain ».
Document n°2 : Article 42 de la Charte des Nations unies
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Document n°3 : Article 53 de la Charte des Nations unies
Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au paragraphe 2 du présent Article, prévues en application de l’Article 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État, d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel État.
Document n°4 : L.-A. Sicilianos, « Entre multilatéralisme et unilatéralisme : l’autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force », RCADI, 2008, t. 339 (extraits) pp. 65-109, 120-140, 211
Un autre élément qui met en évidence la dimension institutionnelle des opérations autorisées résulte du fait que celles-ci sont mises en œuvre « sous l’autorité » du Conseil de sécurité. Cet élément est reflété plus ou moins clairement dans la quasi-totalité des résolutions pertinentes, adoptées au titre du chapitre VII de la Charte, tout en étant mentionné explicitement dans l’article 53, paragraphe 1, en relation avec les mesures coercitives prises par les accords ou organismes régionaux sur autorisation du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VIII.
En pratique, cependant, l’« autorité » exercée par le Conseil consiste en l’encadrement des opérations autorisées, voire en un contrôle global quant à leur déroulement, dont il importe de préciser le contenu. Encore faut-il souligner, toutefois, que le pouvoir du Conseil d’exercer un tel contrôle ne saurait faire l’objet d’une délégation. […].
Sur la base de ces réflexions, de la pratique du Conseil et des débats en son sein, on arrive à la conclusion que le pouvoir d’exercer un contrôle, sinon direct, du moins global sur les opérations autorisées ne saurait faire l’objet d’une délégation. Le Conseil de sécurité peut déléguer — et il délègue souvent en pratique — une partie de ses compétences au Secrétaire général, aux forces onusiennes de maintien de la paix ou à des organismes régionaux. Toutefois, il ne saurait en aucun cas se désister, explicitement ou implicitement, de son pouvoir d’exercer le contrôle nécessaire sur le déroulement des opérations qu’il autorise, faute de quoi la validité de l’habilitation elle-même serait mise en cause. En effet, ainsi qu’il est généralement reconnu dans le droit des organisations internationales, les délégations « sont limitées par les règles constitutionnelles de chaque organisation ». Or, étant donné que l’article 24 de la Charte confère au Conseil de sécurité la « responsabilité principale » du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la délégation du pouvoir de contrôle sur les opérations autorisées serait « inconstitutionnelle ». […]. L’élément primordial de l’autorité exercée par le Conseil de sécurité est la détermination des objectifs et, partant, du mandat des opérations autorisées. Le Conseil est compétent également pour préciser la durée de ces opérations, pour renouveler, le cas échéant, le mandat des forces multinationales et pour décider de la fin de l’autorisation et du départ desdites forces, voire de leur remplacement par des forces onusiennes de maintien de la paix. […].
[L]’Impossibilité de signer les accords spéciaux en application de l’article 43 a mené à la marginalisation de la totalité des articles 42 à 48 et au développement parallèle de substituts du système de sécurité collective. Il s’agit des opérations de maintien de la paix, d’une part, et des opérations autorisées, de l’autre. Mais alors que les premières sont qualifiées d’opérations des Nations Unies et incorporées sans contestation au cadre institutionnel de la Charte, il n’en va pas de même des secondes : les opérations autorisées se distinguent clairement des opérations de maintien de la paix parce qu’elles ne constituent pas « des opérations des Nations Unies » au sens technique de l’expression mais comportent des éléments extra-institutionnels importants, qui les éloignent davantage de la logique du système centralisateur de sécurité collective de la Charte. […]
Section II. Les autorisations « implicites » et la déformation de la Charte
Le point de vue concernant l’autorisation « tacite » ou « implicite » ou l’assentiment tacite du Conseil de sécurité concernant l’entreprise d’une action militaire par les Etats dans des conditions qui dépassent les bornes de la légitime défense n’est pas nouveau. Cette théorie avait été soutenue à plusieurs reprises au cours de la période 1945-1989. Elle a refait son apparition, dans des conditions juridico-politiques différentes, au cours des années quatre-vingt-dix et jusqu’à ce jour, en liaison principalement avec les affaires de l’Iraq et du Kosovo. La position qui affirme que l’emploi de la force peut être fondé sur une autorisation non seulement expresse mais aussi tacite ou implicite, outre qu’elle ne semble pas trouver d’assise dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, implique la rupture de l’équilibre entre les éléments institutionnels et les éléments décentralisés qui caractérise l’institution de l’autorisation en conduisant à une déformation des dispositions de la Charte, voire à la marginalisation du Conseil.
Document 5 : Résolution 2127(2013) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 5 décembre 2013 (Centrafrique), Extraits
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions et déclarations sur la République centrafricaine, en particulier sa résolution 2121 (2013),
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté à l’indépendance, à l’intégrité́ territoriale et à l’unité de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage et de coopération régionale,
Se déclarant vivement préoccupé par l’état de la sécurité qui continue de se détériorer en République centrafricaine et se caractérise par l’effondrement total de l’ordre public, l’absence de l’état de droit et des tensions interconfessionnelles, se déclarant en outre profondément préoccupé par les incidences de l’instabilité de ce pays sur la région de l’Afrique centrale et au-delà, et soulignant à cet égard la nécessité d’une intervention rapide de la communauté internationale,
Demeurant gravement préoccupé par la multiplication et l’intensification des violations du droit international humanitaire et les violations généralisées des droits de l’homme et exactions qui sont commises, en particulier par d’anciens éléments de la Séléka et des milices, en particulier celles connues sous le nom de « antibalaka », notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les violences sexuelles sur la personne de femmes et d’enfants, les viols, le recrutement et l’emploi d’enfants et les attaques contre des civils,
Soulignant qu’il est particulièrement préoccupé par l’apparition d’une nouvelle logique de violences et de représailles et par le risque qu’elle dégénère en fracture religieuse et ethnique à l’échelle nationale, de nature à se muer en situation incontrôlable et s’accompagner de crimes graves au regard du droit international, en particulier des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, ce qui aurait des répercussions graves sur le plan régional,
Préoccupé par le fait que les institutions policières, judiciaires et pénitentiaires n’ont pas les moyens d’amener les auteurs de ces violations et exactions à répondre de leurs actes,
Condamnant toutes violences qui ciblent les membres de groupes ethniques et religieux ainsi que leurs dirigeants, et engageant toutes les parties et les parties prenantes en République centrafricaine à soutenir, avec l’aide de la communauté internationale, le dialogue intercommunautaire et interconfessionnel, et à y concourir, afin d’atténuer les tensions actuelles sur le terrain,
Réaffirmant que tous les auteurs de tels actes doivent en répondre et que certains de ces actes pourraient constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, auquel la République centrafricaine est partie, et rappelant la déclaration faite par le Procureur de la Cour le 7 aout 2013,
Condamnant de nouveau la destruction du patrimoine naturel et notant que le braconnage et le trafic dont fait l’objet la faune sauvage sont au nombre des facteurs qui alimentent la crise en République centrafricaine,
Notant la décision prise par le Processus de Kimberley de suspendre la République centrafricaine,
Saluant le rapport du Secrétaire général, en date du 15 novembre 2013, sur la situation en République centrafricaine et sur la planification de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA) et prenant note des propositions détaillées concernant le soutien que la communauté́ internationale pourrait apporter à la Mission,
Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités de transition de protéger la population civile,
Rappelant ses résolutions 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en période de conflit armé, ses résolutions 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) et 2068 (2012) sur le sort des enfants en temps de conflit armé, et ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013), sur les femmes et la paix et la sécurité, et demandant aux parties en République centrafricaine de collaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit,
Soulignant qu’il importe que les autorités de transition assurent la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité, à toutes les discussions portant sur le règlement du conflit et à toutes les phases du processus électoral,
Soulignant également que la situation en République centrafricaine risque de créer un climat propice au développement d’activités criminelles transnationales, impliquant notamment le trafic d’armes et l’utilisation de mercenaires, et de constituer un terrain fertile pour les réseaux extrémistes,
Rappelant sa résolution 2117 (2013) et se disant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la paix et la sécurité́ en République centrafricaine le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre,
Constatant toujours avec inquiétude que l’Armée de résistance du Seigneur poursuit ses activités en République centrafricaine, en raison notamment de l’insécurité́ qui règne dans le pays,
Se disant de nouveau gravement préoccupé́ par la détérioration de la situation humanitaire en République centrafricaine et condamnant fermement les attaques répétées dirigées contre le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire, leurs biens, avoirs et locaux, et le pillage des stocks d’aide humanitaire ayant pour effet d’entraver l’acheminement de cette aide,
Soulignant qu’il importe de respecter les principes directeurs des Nations Unies relatifs à l’aide humanitaire, dont la neutralité, l’impartialité, l’humanité et l’indépendance dans la fourniture de l’aide humanitaire,
Engageant instamment toutes les parties à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que de leurs biens,
Rappelant la lettre de son président datée du 29 octobre, approuvant le déploiement d’une unité de gardes en République centrafricaine, laquelle ferait partie du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA), et prenant note de la lettre du Secrétaire général datée du 26 novembre 2013, dans laquelle il souligne les progrès réalisés en vue du déploiement d’une unité́ de gardes au sein du BINUCA, ainsi que le consentement exprimé le 5novembre par les autorités de transition à ce déploiement, et saluant à cet égard la contribution du Royaume du Maroc à cette unité,
Se félicitant de la décision prise par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, le 19 juillet 2013, d’autoriser le déploiement de la MISCA, ainsi que l’adoption, le 10 octobre 2013, d’un nouveau concept d’opérations,
Exprimant de nouveau sa gratitude à la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et à son médiateur pour les efforts qu’ils déploient concernant la crise en République centrafricaine, à l’Union africaine pour l’action qu’elle mène en vue de régler la crise, et au Groupe de contact international pour la République centrafricaine pour ses efforts,
Se félicitant du ferme engagement de l’Union européenne en faveur de la République centrafricaine, en particulier des conclusions que le Conseil des affaires étrangères a formulées le 21 octobre 2013 et de l’engagement pris par l’Union européenne de contribuer financièrement au déploiement de la MISCA dans le cadre de la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, et accueillant favorablement les pourparlers en cours au sein de l’Union européenne sur la possibilité́ d’apporter un soutien supplémentaire,
Saluant les efforts que fait le Secrétariat pour étoffer et améliorer le registre d’experts du Service de ses organes subsidiaires, compte tenu des indications données par son président dans la note publiée sous la cote S/2006/997,
Prenant note de la déclaration que le Groupe de contact international pour la République centrafricaine a adoptée à sa troisième réunion, tenue à Bangui le 8 novembre 2013,
Prenant note également du communiqué que le Conseil de paix et de sécurité́ de l’Union africaine a publié le 13 novembre 2013, dans lequel celui-ci exhorte le Conseil de sécurité à adopter rapidement une résolution consacrant et autorisant le déploiement de la MISCA,
Prenant note en outre de la lettre du Président de la Commission de consolidation de la paix, datée du 22 novembre 2013, dans laquelle il souligne à quel point il importe de répondre aux besoins de la République centrafricaine en matière de consolidation de la paix dès que la situation humanitaire et sur le plan de la sécurité aura été stabilisée, et insiste sur l’importance de ce que la Commission fait pour mobiliser et maintenir l’attention des partenaires et des acteurs à l’appui des efforts correspondants des Nations Unies et des acteurs régionaux, et pour pérenniser leur engagement,
Prenant note de la lettre des autorités centrafricaines datée du 20 novembre 2013, dans laquelle celles-ci demandent que la MISCA soit appuyée par les forces françaises,
Soulignant qu’il importe que toutes les organisations internationales, régionales et sous-régionales présentes en République centrafricaine coordonnent davantage leurs activités,
Considérant que la situation en République centrafricaine constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
(…)
Déploiement de la MISCA
28. Autorise le déploiement de la MISCA pour une période initiale de 12 mois après l’adoption de la présente résolution, décision qui sera examinée six mois après l’adoption de la présente résolution, prévoyant toutes les mesures nécessaires, conformément au concept d’opérations adopté le 19 juillet 2013 et revu le 10 octobre 2013, pour contribuer à :
i) Protéger les civils et rétablir la sécurité́ et l’ordre public, en ayant recours aux mesures appropriées;
ii) Stabiliser le pays et restaurer l’autorité́ de l’État sur l’ensemble du territoire;
iii) Créer les conditions propices à la fourniture d’une aide humanitaire aux populations qui en ont besoin;
iv) Soutenir les initiatives de désarmement, démobilisation et réintégration ou désarmement, démobilisation, réintégration et réinstallation ou rapatriement menées par les autorités de transition et coordonnées par le BINUCA;
v) Accompagner les efforts nationaux et internationaux, menés par les autorités de transition et coordonnés par le BINUCA, visant à réformer et restructurer les secteurs de la défense et de la sécurité;
29. Se félicite des consultations tenues entre la Commission de l’Union africaine et les pays de la région de l’Afrique centrale et du concours apporté par l’Organisation des Nations Unies et les États Membres pour arrêter les modalités de la transition entre la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique (MICOPAX) et la MISCA, notamment les résultats des réunions tenues à Addis- Abeba du 7 au 10 octobre 2013;
30. Prie l’Union africaine et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale de veiller à ce que la passation des pouvoirs entre la MICOPAX et la MISCA ait lieu le 19 décembre 2013, note à ce propos que le Conseil de paix et de sécurité a demandé à la Commission de l’Union africaine de prendre d’urgence les mesures voulues afin que la passation des pouvoirs entre la MICOPAX et la MISCA soit réussie, et se félicite de la nomination du nouveau commandement de la MISCA;
31. Souligne qu’il faut que le BINUCA, la Force régionale d’intervention de l’Union africaine (AU-RTF) et la MISCA coordonnent bien leurs activités concernant la protection des civils et leurs opérations de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur, et mettent en commun les informations dont ils disposent;
32. Invite l’Union africaine à lui rendre compte tous les 60 jours, en étroite coordination avec le Secrétaire général et les autres organisations internationales et avec les partenaires bilatéraux concernés par la crise, concernant le déploiement et les activités de la MISCA;
33. Souligne que la MISCA et toutes les forces militaires présentes en République centrafricaine doivent agir, dans l’exécution de leur mandat, en respectant pleinement la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité́ de la République centrafricaine ainsi que les dispositions applicables du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des refugiés, et rappelle que la formation est importante à cet égard;
(…)
Forces françaises
49. Note que dans son communiqué du 13 novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est réjoui du renforcement envisagé du contingent français pour mieux appuyer la MISCA et a encouragé la Commission à travailler à une coordination opérationnelle effective entre la MISCA et les forces françaises;
50. Autorise les forces françaises en République centrafricaine à prendre toutes mesures nécessaires, temporairement et dans la limite de leurs capacités et dans les zones où elles sont déployées, pour appuyer la MISCA dans l’exécution de son mandat, énoncé au paragraphe 28 ci-dessus, prie la France de lui faire rapport sur l’exécution de ce mandat en République centrafricaine et de coordonner les modalités d’établissement de son rapport avec celles énoncées au paragraphe 32 ci- dessus s’appliquant à l’Union africaine, décide de revoir ce mandat six mois au plus tard après qu’il aura débuté, demande aux autorités de transition d’apporter leur entière coopération au déploiement et aux opérations des forces françaises, notamment en assurant la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement de celles-ci, avec accès immédiat et sans entrave à tout le territoire de la République centrafricaine, et invite les pays voisins à prendre les mesures voulues pour soutenir l’action des forces françaises;
Document n°6 : Résolution 2134 (2014) du Conseil de Sécurité des Nations unies du 28 Janvier 2014, (Centrafrique), Extraits
Mandat de l’opération de l’Union européenne en République centrafricaine
43. Autorise l’Union européenne à déployer une opération en République centrafricaine, selon les termes de la lettre de la Haute Représentante de l’Union européenne datée du 21 janvier 2014 (S/2014/45);
44. Autorise l’opération de l’Union européenne à prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de déploiement, dès son déploiement initial et pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle elle aura déclaré être pleinement opérationnelle;
45. Prie l’Union européenne de faire rapport au Conseil sur l’exécution de ce mandat en République centrafricaine et de coordonner ses rapports avec ceux de l’Union africaine, visés au paragraphe 32 de la résolution 2127 (2013);
46. Prie les États Membres, notamment les pays voisins de la République centrafricaine, de prendre les mesures qui s’imposent pour appuyer l’action de l’Union européenne, notamment en facilitant le transfert sans obstacle ni retard vers la République centrafricaine de la totalité du personnel, du matériel, des fournitures, des réserves et des biens divers, y compris les véhicules et les pièces détachées, destinés à l’opération de l’Union européenne;
47. Invite les autorités de transition de la République centrafricaine à conclure dès que possible un accord sur le statut des forces en vue de l’établissement de l’opération de l’Union européenne;
48. Souligne que toutes les forces militaires présentes en République centrafricaine doivent agir, dans l’exécution de leur mandat, en respectant pleinement la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’unité de la République centrafricaine ainsi que les dispositions applicables du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés, et rappelle que la formation est importante à cet égard;
49. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la mise en œuvre du mandat du BINUCA tous les quatre-vingt-dix jours après l’adoption de la présente résolution;
50. Décide de rester saisi de la question.
Document n°7 : Résolution 2149 (2014) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 10 avril 2014 (Centrafrique), Extraits
Opération de maintien de la paix
18. Décide de créer la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) à compter de la date d’adoption de la présente résolution pour une période initiale venant à expiration le 30 avril 2015;
19. Prie le Secrétaire général de fondre au sein de la MINUSCA le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA) à compter de la date d’adoption de la présente résolution et d’assurer la transition sans heurt du BINUCA à la MINUSCA;
20. Décide qu’à compter du 15 septembre 2014, la MINUSCA comprendra initialement un effectif militaire de 10000 hommes, dont 240 observateurs militaires et 200 officiers d’état-major, et un effectif de police de 1 800 hommes, dont 1 400 membres d’unités de police constituées et 400 policiers, et 20 agents pénitentiaires, demande aux États Membres de fournir des contingents et du personnel de police dotés des capacités et de l’équipement nécessaires pour aider la MINUSCA à fonctionner et à s’acquitter de ses responsabilités efficacement, et prie le Secrétaire général de recruter un personnel qualifié justifiant des compétences, du niveau d’instruction, de l’expérience professionnelle et des aptitudes linguistiques requises pour s’acquitter des tâches décrites aux paragraphes 30 et 31, compte tenu de la nécessité de communiquer des informations et d’apporter une assistance technique de la manière la plus accessible possible aux intéressés;
21. Décide en outre que le transfert de responsabilités de la MISCA à la MINUSCA s’effectuera le 15 septembre 2014 et que, pendant la période à partir de l’adoption de la présente résolution à ce transfert de responsabilités, la MINUSCA exécutera les tâches prescrites aux paragraphes 30 et 31 au moyen de sa composante civile, la MISCA devant continuer à accomplir son mandat prévu par la résolution 2127 (2013), et que, dès le 15 septembre 2014, la MINUSCA commencera à exécuter, au moyen de ses composantes militaire et de police, les tâches prescrites aux paragraphes 30 et 31 ci-après;
22. Prie le Secrétaire général d’affecter à la MINUSCA autant de membres du personnel militaire et de police de la MISCA que possible et selon les normes en vigueur à l’ONU, en coordination étroite avec l’Union africaine et la CEEAC et à compter du 15 septembre 2014, conformément à sa politique de vérification des antécédents de respect des droits de l’homme du personnel travaillant pour les Nations Unies;
23. Autorise le Secrétaire général, sans préjudice des dispositions du paragraphe 21 ci-dessus, à déployer au sein de la MINUSCA avant le 15 septembre 2014 des éléments habilitants militaires, y compris en en transférant depuis d’autres opérations de maintien de la paix qui réduisent leurs effectifs et dans le cadre de la coopération entre missions, dans la mesure nécessaire pour renforcer les composantes militaires et de police de la MINUSCA et leur permettre de s’acquitter dès le 15 septembre 2014 des tâches qui leur ont été confiées, et prie en outre le Secrétaire général de déployer les éléments habilitants nécessaires par la passation de contrats, aux mêmes fins;
24. Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures possibles, notamment en usant pleinement des pouvoirs existants, et à sa discrétion, pour accélérer le déploiement des moyens civils et militaires de la MINUSCA en République centrafricaine, de manière à répondre au mieux aux attentes du Conseil et aux besoins des Centrafricains et le prie de prendre les mesures nécessaires pour rendre la MINUSCA prête à commencer ses activités;
25. Demande au Secrétaire général de transférer l’unité de gardes, conformément à son mandat initial approuvé par la lettre du Président du Conseil de sécurité́ en date du 29 octobre 2013, du BINUCA à la MINUSCA de la date d’adoption de la présente résolution au 15 septembre 2014, et décide que de la date d’adoption de la présente résolution au 15 septembre 2014, le mandat de l’unité de gardes tel qu’approuvé dans ladite lettre demeurera inchangé;
26. Invite le Secrétaire général à déployer, en étroite coordination avec l’Union africaine, une équipe de transition chargée de mettre sur pied la MINUSCA et d’assurer le transfert de responsabilités sans heurt de la MISCA à la MINUSCA d’ici au 15 septembre 2014, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer et positionner la MISCA, dès que possible, pour son passage sous commandement d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies;
27. Demande au Secrétaire général de lui présenter, à l’issue d’une mission conjointe menée avec l’Union africaine, le 15août 2014 au plus tard, des informations actualisées sur l’état des préparatifs en vue du transfert sans heurt de responsabilités de la MISCA à la MINUSCA d’ici au 15 septembre 2014;
28. Prie le Secrétaire général de nommer un Représentant spécial pour la République centrafricaine et chef de la MINUSCA, sous l’autorité́ générale duquel, à compter de la date de sa nomination, seront placées la coordination et la conduite de toutes les activités du système des Nations Unies en République centrafricaine;
29. Autorise la MINUSCA à utiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir son mandat, dans les limites de ses capacités et dans ses zones de déploiement;
(…)
Document 8 : Résolution 2499 (2019) du Conseil de Sécurité des Nations unies du 15 novembre 2019
Résolution 2499 (2019)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8666e séance, le 15 novembre 2019
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures, les déclarations de sa présidence et les déclarations à la presse sur la situation en République centrafricaine,
2499 (2019)
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l’importance des principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale,
Réaffirmant également les principes fondamentaux du maintien de la paix, tels que le consentement des parties, l’impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour la défense du mandat, considérant que le mandat de chaque mission de maintien de la paix est adapté aux besoins et à la situation du pays concerné, soulignant que les mandats qu’il autorise sont conformes à ces principes fondamentaux, réaffirmant qu’il escompte l’exécution intégrale des mandats qu’il autorise, et rappelant à cet égard sa résolution 2436 (2018),
Rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités de la République centrafricaine de protéger toutes les populations du pays contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité, et rappelant également à cet égard qu’il importe de rétablir l’autorité de l’État dans tout le pays,
Insistant sur le fait que tout règlement durable de la crise en République centrafricaine, y compris le processus politique, doit être aux mains de la République centrafricaine et accorder la priorité à la réconciliation du peuple centrafricain, dans le cadre d’un processus sans exclusive associant les hommes et les femmes, y compris les personnes qui ont été déplacées du fait de la crise, quelle que soit leur origine sociale, économique, politique, religieuse et ethnique,
Se félicitant de la signature, à Bangui le 6 février 2019, de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine par les autorités de la République centrafricaine et 14 groupes armés (l’« Accord de paix »), à l’issue des pourparlers de paix qui se sont tenus à Khartoum du 24 janvier au 5 février 2019 dans le cadre de l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation et sous les auspices de l’Union africaine,
Condamnant avec la plus grande fermeté les violations de l’Accord de paix et les violences commises par les groupes armés et autres milices dans tout le pays, notamment à Paoua en mai 2019 et dans la préfecture de la Vakaga en septembre et octobre 2019, les incitations à la haine et à la violence ethniques et religieuses, les violations du droit international humanitaire et les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, notamment celles commises contre les enfants et les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis en période de conflit, et les violences dirigées contre les populations civiles de certaines communautés, qui ont fait des morts et des blessés et causé des déplacements,
Soulignant qu’il est impératif de mettre fin de toute urgence à l’impunité en République centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits,
Soulignant également qu’il est nécessaire de soutenir les efforts faits au niveau national pour étendre l’autorité de l’État et réformer le secteur de la sécurité en République centrafricaine,
Saluant le travail accompli par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et la mission militaire de formation de l’Union européenne en République centrafricaine (EUTM-RCA) et l’assistance apportée par d’autres partenaires internationaux et régionaux de la République centrafricaine, dont les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la France et la République populaire de Chine, en vue de former et de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité de la République centrafricaine, et appelant à la cohérence, à la transparence et à la coordination effective de l’appui international à la République centrafricaine,
Condamnant les activités criminelles transfrontières, telles que le trafic d’armes, le commerce illicite, l’exploitation illégale et le trafic de ressources naturelles, notamment l’or et les diamants, le braconnage et le trafic d’espèces sauvages, l’utilisation de mercenaires, ainsi que le commerce illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre, qui menacent la paix et la stabilité de la République centrafricaine, et soulignant qu’il importe que les autorités de la République centrafricaine finalisent et mettent en œuvre, en coopération avec les partenaires pertinents, une stratégie de lutte contre l’exploitation illégale et le trafic des ressources naturelles,
Prenant note de la tenue prochaine, en 2020 et 2021, d’élections présidentielle, législatives et locales, soulignant qu’il incombe au premier chef aux autorités de la République centrafricaine d’organiser, dans le respect des délais fixés par la Constitution, des élections inclusives, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, en garantissant notamment la participation pleine, effective et véritable des femmes, réaffirmant l’importance de la participation des jeunes, et encourageant les autorités de la République centrafricaine à promouvoir, avec le concours des partenaires pertinents, la participation des personnes déplacées et des réfugiés conformément à la Constitution centrafricaine,
Rappelant ses résolutions sur la protection des civils en période de conflit armé, sur le sort des enfants en temps de conflit armé et sur les femmes et la paix et la sécurité, et demandant à toutes les parties en République centrafricaine de coopérer avec la Représentante spéciale pour le sort des enfants en temps de conflit armé et la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit,
Se déclarant gravement préoccupé par la situation humanitaire catastrophique qui règne en République centrafricaine et par les conséquences de la détérioration des conditions de sécurité sur l’accès humanitaire, condamnant avec la plus grande fermeté les attaques incessantes dont les travailleurs humanitaires font l’objet, et appelant l’attention sur les besoins humanitaires actuels de plus de la moitié de la population du pays et sur la situation alarmante des déplacés et des réfugiés dans les pays voisins,
Conscient des effets néfastes que les changements climatiques, les changements écologiques et les catastrophes naturelles, entre autres facteurs, ont sur la stabilité de la région de l’Afrique centrale, notamment la sécheresse, la désertification, la dégradation des terres, l’insécurité alimentaire et le manque d’accès à l’énergie, et soulignant qu’il importe que l’Organisation des Nations Unies procède à une évaluation appropriée des risques relatifs à ces facteurs et que les gouvernements de la région de l’Afrique centrale et l’Organisation adoptent des stratégies de long terme visant à appuyer la stabilisation et à renforcer la résilience,
Condamnant dans les termes les plus vifs toutes les attaques, provocations et incitations à la violence visant la MINUSCA et d’autres forces internationales, qui sont notamment le fait des groupes armés, rendant hommage aux membres du personnel de la MINUSCA qui ont sacrifié leur vie au service de la paix, soulignant que les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre, rappelant à toutes les parties leurs obligations au regard du droit international humanitaire, et demandant instamment aux autorités de la République centrafricaine de prendre toutes les mesures possibles pour garantir que les auteurs de ces actes seront arrêtés et traduits en justice,
Rappelant sa résolution 2378 (2017), dans laquelle il avait prié le Secrétaire général de veiller à ce que les données relatives à l’efficacité des opérations de maintien de la paix, y compris celles portant sur l’exécution de ces opérations, soient utilisées pour améliorer l’analyse et l’évaluation des opérations des missions sur la base de critères précis et bien définis, rappelant également sa résolution 2436 (2018), dans laquelle il avait prié le Secrétaire général de veiller à ce que soient prises sur la base de mesures objectives de la performance les décisions visant à reconnaître l’excellence des performances ou à inciter à l’excellence et les décisions ayant trait aux déploiements, à la remédiation, à la formation, au gel des remboursements et au rapatriement de personnel en tenue ou au renvoi de personnel civil, et soulignant qu’il convient d’évaluer régulièrement la performance de la MINUSCA pour que la Mission conserve les compétences et la souplesse dont elle a besoin pour s’acquitter de son mandat,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 15 octobre 2019 (S/2019/822),
Constatant que la situation en République centrafricaine continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
[…]
Efficacité de la MINUSCA
35. Prie le Secrétaire général de déployer et d’affecter le personnel et les compétences disponibles au sein de la MINUSCA de façon à ce que les priorités définies aux paragraphes 32 à 34 de la présente résolution soient prises en compte, et d’adapter constamment ce déploiement en fonction des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du mandat ;
36. Constate une fois de plus avec inquiétude que la MINUSCA ne dispose toujours pas de certaines capacités essentielles et rappelle qu’il est nécessaire de combler les besoins, en particulier dans le domaine des hélicoptères militaires, et qu’il importe que les actuels et futurs pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police fournissent des contingents ou du personnel de police ayant les capacités, le matériel et la formation préalable au déploiement nécessaires pour aider la MINUSCA à bien fonctionner ;
37. Constate que l’exécution effective des mandats de maintien de la paix relève de la responsabilité de toutes les parties prenantes et qu’elle dépend de plusieurs facteurs essentiels, notamment des mandats bien définis, réalistes et réalisables, la volonté politique, le bon encadrement, l’efficacité et la responsabilité à tous les niveaux, des ressources, une politique, une planification et des directives opérationnelles appropriées, la formation et l’équipement ;
38. Se félicite des initiatives lancées par le Secrétaire général pour instituer une culture de la performance dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, rappelle que, dans ses résolutions 2378 (2017) et 2436 (2018), il a prié le Secrétaire général de veiller à ce que les données relatives à l’efficacité des opérations de maintien de la paix soient utilisées pour améliorer le fonctionnement des missions, notamment les décisions portant sur le déploiement, la remédiation, le rapatriement et les mesures incitatives, se déclare de nouveau favorable à l’élaboration d’un dispositif de gestion de la performance complet et intégré qui définisse des normes de performance claires pour l’évaluation de l’ensemble du personnel civil et en tenue des Nations Unies qui travaille dans les opérations de maintien de la paix ou les appuie, qui permette la bonne et pleine exécution des mandats, qui prévoie des méthodes complètes et objectives fondées sur des critères précis et bien définis pour sanctionner les résultats insuffisants et récompenser ou reconnaître les résultats exceptionnels, demande à l’Organisation de l’appliquer à la Mission comme indiqué dans la résolution 2436 (2018), en particulier en enquêtant sur les manquements graves concernant l’application de la stratégie de protection des civils et en prenant des mesures immédiates, y compris la relève, le rapatriement, le remplacement ou le renvoi des membres du personnel civil ou en uniforme de la Mission qui sont fautifs, y compris le personnel d’encadrement de la Mission et le personnel d’appui à la Mission, conformément à la résolution 2436 (2018), prend note des efforts déployés par le Secrétaire général pour élaborer un système complet d’évaluation de la performance et prie le Secrétaire général et les pays qui fournissent des contingents ou du personnel de police de s’employer à augmenter le nombre de femmes au sein de la Mission et de veiller à ce que ces dernières participent pleinement, effectivement et véritablement à tous les aspects des opérations ;
39. Prend note avec satisfaction de la détermination dont font preuve les pays fournisseurs de contingents et de personnel de police dans l’exécution du mandat de la Mission dans des conditions difficiles, et souligne à cet égard que les restrictions nationales non déclarées, le défaut de commandement et de contrôle efficaces, le refus d’obéir aux ordres, la défaillance des réactions aux attaques perpétrées contre des civils et l’insuffisance du matériel risquent de compromettre l’exécution efficace du mandat dont chacun partage la responsabilité et ne devraient pas être tolérés par le Secrétaire général ;
40. Encourage la MINUSCA à poursuivre l’application des recommandations issues de l’enquête indépendante menée par le général de brigade Amoussou afin d’améliorer les mesures qu’elle prend pour protéger les civils ;
41. Prie le Secrétaire général d’appliquer une politique de tolérance zéro en cas de faute grave, d’exploitation et d’atteintes sexuelles, de harcèlement sexuel, de fraude, de corruption, de trafic de ressources naturelles ou d’espèces sauvages, notamment en utilisant pleinement les pouvoirs actuels de son représentant spécial pour faire en sorte que le personnel de la Mission réponde de ses actes et en mettant en place un dispositif efficace d’appui à la Mission, rappelle la déclaration de sa présidence S/PRST/2015/22 et sa résolution 2272 (2016), prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que l’ensemble du personnel de la MINUSCA respecte pleinement la politique de tolérance zéro de l’Organisation à l’égard de l’exploitation et des atteintes sexuelles et de le tenir pleinement informé des progrès faits par la Mission à cet égard, notamment en lui rendant compte de la date à laquelle ont débuté les examens prescrits dans la résolution 2272 (2016), des délais convenus et de leur résultat, et prie instamment les pays fournisseurs de contingents ou de personnel de police de prendre des mesures de prévention appropriées, notamment la vérification des antécédents de tous les membres du personnel, l’organisation d’une formation de sensibilisation avant et pendant le déploiement, l’ouverture rapide d’enquêtes en cas d’allégations, selon qu’il conviendra, et à prendre les mesures qui s’imposent pour amener les auteurs d’actes répréhensibles à en répondre et rapatrier leurs unités lorsqu’il existe des preuves crédibles qu’elles ont commis des actes d’exploitation et d’atteintes sexuelles de manière généralisée ou systématique ;
42. Prie la MINUSCA d’être sensible aux effets qu’ont sur l’environnement les activités qu’elle mène en exécution des tâches qui lui sont confiées, et de maîtriser ces effets, selon qu’il convient et conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et aux règles et règlements applicables de l’Organisation ;
Document 9 : Résolution 2566 (2021) du conseil de Sécurité des Nations Unies du 12 mars 2021(Centrafrique)
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures, les déclarations de sa présidence et les déclarations à la presse sur la situation en République centrafricaine,
Se déclarant gravement préoccupé par la détérioration de la situation en République centrafricaine par suite des attaques lancées par des groupes armés avant et après l’élection du 27 décembre 2020,
Condamnant avec la plus grande fermeté les violations de l’Accord pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine (« l’Accord de paix ») et les violences commises par les groupes armés et autres milices, notamment celles visant à faire obstacle aux opérations électorales, les incitations à la haine et à la violence ethniques et religieuses, les violations du droit international humanitaire et les violations des droits humains et les atteintes à ces droits, y compris celles commises contre les enfants et les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre commis en période de conflit, et les violences dirigées contre les populations civiles de certaines communautés, qui ont fait des morts et des blessés et causé des déplacements,
Prenant note de la décision rendue par la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine le 18 janvier 2021, dans laquelle la Cour s’est prononcée sur les différends électoraux et a proclamé l’élection du Président Touadéra, et demandant à toutes les parties prenantes de respecter cette décision, de réaffirmer leur volonté de consolider la démocratie et l’état de droit en République centrafricaine et de contribuer à faire en sorte que le processus électoral soit mené à son terme de façon pacifique et crédible,
Accueillant avec satisfaction la feuille de route pour le dialogue proposée par le Président Touadéra et appelant le Gouvernement de la République centrafricaine et tous les acteurs politiques à prendre des mesures concrètes pour engager véritablement un dialogue, résoudre les questions qui subsistent et parachever le processus électoral par l’organisation des élections législatives et locales, soulignant de nouveau que seules des élections inclusives, libres, justes, transparentes, crédibles, pacifiques, tenues dans le respect des délais et exemptes de toute désinformation ou autre forme de manipulation de l’information, pourront apporter une stabilité durable à la République centrafricaine, notamment au moyen de la participation pleine, égale et effective des femmes, réaffirmant l’importance de la participation des jeunes, et encourageant les autorités de la République centrafricaine à promouvoir, avec le concours des partenaires concernés, la participation des personnes déplacées et des réfugiés conformément à la Constitution du pays,
Exhortant toutes les parties signataires de l’Accord de paix à honorer leurs engagements et à choisir la voie du dialogue et de la paix, soulignant qu’il est impératif de mettre fin de toute urgence à l’impunité en République centrafricaine et de traduire en justice les auteurs de violations du droit international humanitaire et de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, et encourageant les autorités nationales à poursuivre leurs efforts pour rendre opérationnelle la Commission vérité, justice, réparation et réconciliation,
Accueillant avec satisfaction le communiqué publié par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine à l’issue de sa réunion sur la République centrafricaine du 16 février 2021, se félicitant de la tenue de la réunion des chefs d’États à Luanda le 29 janvier 2021, et encourageant la mobilisation soutenue et coordonnée de la région, en particulier dans le cadre de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), en vue de renforcer le dialogue, d’apaiser les tensions et de rechercher des solutions politiques concertées à la crise,
Se déclarant profondément préoccupé par la situation humanitaire grave qui règne en République centrafricaine et par les conséquences de la détérioration des conditions de sécurité sur l’accès humanitaire, condamnant avec la plus grande fermeté la multiplication des attaques contre les travailleurs humanitaires, appelant l’attention sur les besoins humanitaires actuels de plus de la moitié de la population du pays, y compris les civils menacés de violences, et sur la situation alarmante des déplacés et des réfugiés, se félicitant de la collaboration entre la MINUSCA, les organismes des Nations Unies, l’Union africaine, la Banque mondiale, les partenaires techniques et financiers de la République centrafricaine et les organisations non gouvernementales, qui appuient le développement et l’action humanitaire dans le pays et ont su s’adapter à la situation provoquée par la pandémie de COVID‑19, qui a aggravé les vulnérabilités existantes, et demandant aux États Membres et aux organisations internationales et régionales de répondre rapidement aux besoins humanitaires définis dans le plan d’aide humanitaire en augmentant leurs contributions et en veillant à ce que tous les engagements pris soient pleinement honorés dans les délais prescrits,
Soulignant que la Commission de consolidation de la paix joue un rôle précieux en apportant des conseils stratégiques, en portant des observations à l’attention du Conseil et en favorisant une concertation, une coordination et une intégration accrues des efforts déployés à l’échelle internationale en matière de consolidation de la paix, et encourageant les partenaires concernés à appuyer les efforts déployés par les autorités de la République centrafricaine dans le cadre du Plan national de relèvement et de consolidation de la paix (RCPCA) pour poser les assises d’une paix durable en République centrafricaine et d’un développement durable de toutes les régions du pays, pour faire bénéficier rapidement la population des dividendes de la paix et pour mettre l’accent sur les projets de développement, y compris les investissements essentiels dans les infrastructures,
Condamnant dans les termes les plus vifs toutes les attaques, provocations et incitations à la haine et à la violence visant la MINUSCA et d’autres forces internationales, qui sont notamment le fait des groupes armés, rendant hommage aux membres du personnel de la MINUSCA qui ont sacrifié leur vie au service de la paix, soulignant que les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre, demandant à toutes les parties de respecter pleinement leurs obligations au regard du droit international humanitaire, et demandant instamment aux autorités de la République centrafricaine de collaborer avec la MINUSCA afin de renforcer la sûreté et la sécurité du personnel de la Mission, notamment en application des dispositions de la résolution 2518 (2020), et de prendre toutes les mesures possibles pour arrêter et traduire en justice les auteurs de ces actes,
Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 16 février 2021 (S/2021/146), dans lequel il est recommandé de doter la Mission d’un effectif supplémentaire de 2 750 militaires et de 940 policiers pour qu’elle soit mieux à même d’empêcher la détérioration de la situation sur le plan sécuritaire et de renverser la tendance tout en créant des conditions favorisant l’avancée du processus politique,
Réaffirmant les principes fondamentaux du maintien de la paix, tels que le consentement des parties, l’impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou pour la défense du mandat, considérant que le mandat de chaque mission de maintien de la paix est adapté aux besoins et à la situation du pays concerné, soulignant que les mandats qu’il autorise sont conformes à ces principes fondamentaux, réaffirmant qu’il escompte l’exécution intégrale des mandats qu’il autorise, et rappelant à cet égard sa résolution 2436 (2018),
Prenant note de la demande des autorités de la République centrafricaine tendant à ce que l’embargo sur les armes soit levé et des positions exprimées par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, se déclarant de nouveau disposé à réexaminer les mesures d’embargo sur les armes, notamment à apprécier s’il convient de les suspendre ou de les lever progressivement, en fonction de l’état d’avancement de la réalisation des objectifs de référence qu’il a définis, et insistant sur la nécessité pour les autorités de la République centrafricaine de veiller à la protection physique, au contrôle, à la gestion et à la traçabilité des armes, des munitions et du matériel militaire qui leur ont été transférés et au devoir de responsabilité à cet égard,
Constatant que la situation en République centrafricaine continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.Décide d’augmenter de 2 750 personnes l’effectif autorisé de la composante militaire de la MINUSCA et d’augmenter de 940 personnes l’effectif autorisé de la composante Police de la Mission, par rapport aux niveaux actuels approuvés au paragraphe 27 de la résolution 2552 (2020) ;
2.Souligne que ces renforts visent à donner à la MINUSCA les moyens d’accomplir ses tâches prioritaires compte tenu de l’évolution du contexte, en particulier la protection des civils et la facilitation de l’accès humanitaire, ainsi que d’empêcher toute nouvelle détérioration de la situation sur le plan sécuritaire et de renverser la tendance tout en créant des conditions favorisant l’avancée du processus politique, souligne en outre que ces moyens accrus ne remplacent en aucun cas la responsabilité première qui incombe aux autorités nationales de faire progresser le processus de paix et de protéger la population, note que le déploiement de ces renforts doit s’effectuer par phases, rappelle l’importance que revêt la coopération entre la MINUSCA et les autorités de la République centrafricaine conformément au mandat de la Mission, et prie le Secrétaire général d’examiner avant chaque phase la mise en place, la performance et la nécessité de renforts dans les rapports qui lui sont demandés au paragraphe 54 de la résolution 2552 (2020) et de présenter dans son rapport du 11 octobre 2021 une proposition sur la configuration générale de la Force de la MINUSCA ;
3.Prie le Secrétaire général de veiller à ce que les décisions concernant le déploiement de tout le personnel de la MINUSCA respectent :
i)les dispositions relatives à la performance des opérations de maintien de la paix énoncées dans les résolutions 2378 (2017) et 2436 (2018), notamment celle prescrivant une plus grande utilisation du Système de préparation des moyens de maintien de la paix aux fins du recrutement et de la rétention de personnel en tenue qualifié ;
ii)les dispositions de la résolution 2518 (2020), toutes les mesures appropriées devant être prises pour renforcer la sûreté et la sécurité du personnel de la MINUSCA ;
iii)les dispositions de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures sur les femmes et la paix et la sécurité, des efforts devant être faits pour augmenter le nombre de femmes à la MINUSCA conformément à la résolution 2538 (2020), et demande en outre que la participation pleine, égale et effective des femmes à tous les aspects des opérations soit garantie dans le cadre de ce déploiement ;
iv)la politique de tolérance zéro de l’Organisation des Nations Unies à l’égard de l’exploitation et des atteintes sexuelles et les dispositions de la résolution 2272 (2016) ;
4.Décide de rester activement saisi de la question.
|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
|
|
|
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama |
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz |
|
|
|
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 8
La lutte contre le terrorisme et le droit international
Exercice
Dissertation : Les mesures prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et la lutte contre le terrorisme
Documents de travail
1) R. KHERAD, « La paix et la sécurité internationale à l’épreuve du régime des tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) », in Les Nations Unies et l’Afghanistan, Paris, Pedone, 2003, pp. 47-76.
2) Conseil de sécurité, résolution 1373 (2001), 28 septembre 2001.
3) Résolution A/RES/60/288, adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2006 [extraits].
4) Conseil de sécurité, résolution 2133 (2014), 27 janvier 2014
5) CJUE, Grande Chambre, affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européenne, 3 septembre 2008 (Extraits)
6) Amnesty International, « Europe : des mesures disproportionnées », 17 janvier 2017 (Extraits)
7) M. KOHEN, « Combattre le terrorisme avec les armes du droit », Le Temps, 18 novembre 2015.
Indications bibliographiques
G. GUILLAUME, Terrorisme et droit international, Recueil des cours de l’Académie de droit international, La Haye, 1989 III, t. 215.
J-M. SOREL, « Le système onusien et le terrorisme ou l'histoire d'une ambiguïté volontaire », L'Observateur des Nations unies, 1999, n° 6, p. 31-57.
L. CONDORELLI, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international ? », RGDIP, 2001, pp. 829-848.
Bannelier (K.), Christakis (T.), Corten (O.) et Delcourt (B.) (dir.), Le droit international face au terrorisme, Paris, Pedone, 2002, 356 pages.
Dossier de l’Annuaire français de droit international de 2002, constitué de trois études consacrées au terrorisme, notamment celle d’H. TIGROUDJA, « Quel(s) droit(s) applicable(s) à la “guerre au terrorisme” ? », AFDI, 2002, vol 48, pp. 81-102.
M. H. GOZZI, Le terrorisme, Paris, Ellipses, 2003, 158 pages.
C. CHALIAND, A. BLIN, Histoire du terrorisme, Paris, Bayard, 2004, 667 pages.
P. KLEIN, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », Recueil des Cours de l’Académie de droit international, t. 321, 2006, pp. 203-484.
M. DELMAS MARTY et H. LAURENS (dir.) Terrorisme, Histoire et droit, Paris, CNRS Editions, 2010, 337 pages.
M. BETTATI, Le terrorisme : les voies de la coopération internationale, Paris, Odile Jacob, 2013, 304 pages.
Daniela QUELHAS, « La nouvelle Stratégie globale de lutte contre le terrorisme du Président Obama, entre rupture et continuité », Revue Sentinelle, Bulletin numéro 349 du 26 mai 2013
Brusil MIRANDA, « Vers un sommet de l'UA consacré à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme », Bulletin n°418 du 18/01/2015, http://www.sentinelle-droit-international.fr/?q=node/88
Résolutions fondamentales du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme :
1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015), 2309(2016), 2322 (2016), 2341 (2017), 2354(2017), 2370(2017), 2396(2017).
Résolutions fondamentales adoptées par l’Assemblée générale en matière de lutte contre le terrorisme :
Résolution 46/51 du 9 décembre 1991
Résolution 49/60 du 9 décembre 1994 (la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international figurant en annexe à cette résolution).
Résolution 51/210 du 17 décembre 1996 (Déclaration complétant la précédente figurant en annexe)
Rapport du groupe de Haut Niveau, « un monde plus sûr : notre affaire à tous », Doc. A/59/565, accessible en ligne sur le site http://www.un.org/french/secureworld/.
Document n°1 R. KHERAD, « La paix et la sécurité internationale à l’épreuve du régime des tâlebân (actes de terrorisme et logique de coercition) », in Les Nations Unies et l’Afghanistan, Paris, Pedone, 2003, pp. 47-76 [Extraits].
B) Les attentats terroristes et ses conséquences sur le régime tâlebân
La Charte des Nations unies ne fait référence à aucun moment au terme même de terrorisme. Celui-ci ne saurait, à première vue, constituer une menace contre la paix. Cependant elle octroie au Conseil de sécurité un pouvoir discrétionnaire pour qualifier un acte ou une situation de menace contre la paix. C’est en vertu de ce pouvoir que le Conseil qualifie pour la première fois en 1992 l’acte de terrorisme, de menace à la paix et la sécurité internationales, sans pour autant autoriser l’usage de la force armée; mais il a franchi le pas, en 2001, considérant que tout acte de terrorisme international est une menace contre la paix et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, y compris la force armée. Il est à remarquer que l’Etat hébergeant des groupes terroristes se voit sanctionné par des mesures coercitives n’impliquant pas l’emploi de la force. La question qui se pose est de savoir si l’acte de terrorisme ne doit pas être nécessairement relié à un Etat déterminé pour se voir opposer l’usage de la force, ce qui soulève la problématique de l’imputabilité des attentats terroristes au régime tâlebân.
1- Le régime tâlebân sanctionné à la suite des attentats anti-américains
Après les attentats, les résolutions du Conseil de sécurité deviennent beaucoup plus critiques à l’encontre du régime tâlebân. La résolution 1193 du 28 août 1998 met en exergue le caractère ethnique du conflit, les persécutions des Chiites et surtout la présence persistante de terroristes sur le territoire afghan. La résolution 1214 du 8 décembre 1998 menace les tâlebân de sanctions non spécifiées pour “refuge accordé aux terroristes internationaux, violations des droits de l’homme, encouragement au trafic de drogue et refus d’accepter un cessez-le-feu”. La menace de sanction et la pression des Etats-Unis et des Etats membres de l’Union européenne aboutissent à la rencontre des tâlebân et de l’Alliance du Nord, à Achkarâbâd, le 11 mars 1999. Les deux belligérants acceptent un échange de prisonniers et la poursuite de la négociation. Mais le mollah Omar met un terme à la poursuite des pourparlers en accusant Ahmad Châh Massoud de duplicité. Dès lors, le Conseil de sécurité, face à l’intransigeance des tâlebân, se voit contraint d’adopter la résolution 1267 du 15 octobre 1999. Celle-ci se fonde sur le non-respect du paragraphe 13 de la résolution 1214 du 8 décembre 1998, pour décréter des sanctions contre le régime tâlebân. En effet, le paragraphe 13 exige que les tâlebân cessent d’offrir un refuge et un entraînement aux terroristes internationaux et qu’ils traduisent en justice les personnes accusées de terrorisme. Ces sanctions comportent essentiellement l’interdiction pour la Compagnie nationale Ariana d’effectuer des vols internationaux, le gel des avoirs des tâlebân à l’étranger et l’interdiction des investissements.
Le paragraphe 6 crée un comité composé de tous les membres du Conseil de sécurité, pour assurer l’application de la résolution.
Le paragraphe 15 dispose que le Conseil de sécurité se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures -conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations unies-, en vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution. Le paragraphe 2 exige que les tâlebân remettent, sans plus tarder, Oussama Ben Laden aux autorités compétentes, soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice. La lecture de cette résolution permet de constater que la fermeté du Conseil de sécurité à l’encontre des tâlebân se manifeste en matière de lutte anti-terroriste, reléguant au second plan la question du respect des droits de l’homme par le régime tâlebân. A cet égard, une question fondamentale se pose. Le Conseil de sécurité n’avait-il pas déjà la possibilité d’intervenir lors de la guerre civile, face à la crise humanitaire et aux exactions commises en matière de droits de l’homme ? Une telle intervention aurait, me semble-t-il, mis fin à la crise humanitaire et aux violations des droits élémentaires de l’homme, conduit à la destruction des camps d’entraînement des terroristes et empêché l’émergence du régime tâlebân.
Il importe de souligner que le pouvoir discrétionnaire du Conseil lui offre toutes les possibilités de qualifier une situation de menace contre la paix (article 39 de la Charte), de prendre des mesures coercitives impliquant l’emploi de la force (article 42) et d’intervenir à tout moment en vertu du Chapitre VII même “dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ”(article 2§7). La pratique assez récente du Conseil de sécurité dans le domaine humanitaire confirme le propos. Ainsi, le Conseil a opportunément décidé, à partir de 1991, d’intervenir et de tenter de mettre fin aux situations de crise humanitaire, notamment celles qui provoquent un déplacement massif de la population, des conflits internes engendrant de lourdes pertes en vies humaines, et qui causent de grandes souffrances aux populations civiles.
Si l’on transpose ces situations à l’Afghanistan, l’on s’aperçoit que, lors de la guerre, le nombre de réfugiés et de déplacés a été estimé à plus de trois millions de personnes, et que les pertes en vies humaines ont dépassé le million de personnes. Quant aux grandes souffrances de la population, lorsqu’elles émanent d’une injustice, et tel est le cas de l’Afghanistan, “il en découle un droit attaché à l’état de victime, dont se dégage un devoir d’assistance”. En dépit de ces circonstances, le Conseil de sécurité n’a pas jugé opportun de qualifier la situation en Afghanistan de menace contre la paix. Il s’avère que la qualification d’une situation de menace contre la paix est, non seulement une question de fait, mais aussi de jugement politique. Il s’ensuit qu’une crise humanitaire grave, telle qu’elle s’est produite en Afghanistan, n’aura aucune chance d’être qualifiée de menace contre la paix si l’un des membres permanents y est impliqué. Ceci contraint le Conseil à adopter une approche sélective dans le choix des situations. Ainsi “le Conseil de sécurité est dominé plus par une logique de réaction que par une logique de situation”. Cela signifie que “les mesures qu’il adopte éventuellement correspondent à ce qu’il est politiquement en mesure de décider, sur la base de l’accord entre ses membres. Elles ne répondent dès lors pas nécessairement à ce qu’exigerait objectivement la situation”.
Quoi qu’il en soit, les sanctions décrétées par le Conseil de sécurité, si elles aggravent l’isolement diplomatique du régime tâlebân, frappent surtout un peuple exsangue et victime de plus de vingt ans de guerre. Il en résulte que les sanctions sont perçues, par la population civile, comme une punition, puisqu’elles aggravent leur situation. En outre, elles discréditent, avec le risque d’amalgame, tous les Afghans, sans distinguer les tâlebân de ceux qui proposent des solutions modernistes. Comme l’écrit à juste titre Barnett Rubin, “Si la situation de l’Afghanistan est affreuse aujourd’hui ce n’est pas parce que le peuple de l’Afghanistan est mauvais. L’Afghanistan n’est pas uniquement le miroir des Afghans : c’est le miroir du monde”.
Il est à noter que l’exercice de pressions sur le Pakistan, seule stratégie qui aurait pu être efficace, a été écarté par le Conseil de sécurité. Le soutien financier et militaire du Pakistan aux tâlebân n’a pas été dénoncé, laissant ainsi Islamabad libre de poursuivre son intervention directe en Afghanistan.
Les sanctions décrétées par le Conseil de sécurité, ayant pour objectif d’infléchir le soutien des tâlebân à Oussama Ben Laden et de faire pression sur ce dernier afin qu’il cesse ses activités terroristes, se sont avérées inefficaces. Bien au contraire, elles ont davantage radicalisé le régime tâlebân et accentué les activités terroristes du réseau Al-quaeda. Cette radicalisation aboutit : à la rupture immédiate des fragiles négociations sous l’égide des Nations unies, entre les tâlebân et l’opposition afghane ; à la destruction du patrimoine pré-islamique et des bouddhas de Bamyân, considérés comme patrimoine commun de l’humanité, et enfin à l’accentuation des pressions sur les organisations humanitaires. Le 3 août 2001, huit volontaires d’une association humanitaire sont arrêtés pour “prosélytisme chrétien”.
Ces faits traduisent l’influence déterminante de l’internationale islamiste et du réseau Al-quaeda dont Oussama Ben Laden est le symbole sur le régime tâlebân, notamment sur son chef, le mollah Omar, et sur son entourage. Dès lors, la question de l’implication du régime tâlebân aux attentats terroristes s’avère discutable.
- L’implication non prouvée des tâlebân aux attentats terroristes
Il semble que c’est dans la perspective des attentats terroristes du 11 septembre, prévus de longue date, que Ben Laden ait fait assassiner, le 9 septembre, le Commandant Massoud, chef militaire de l’Alliance du Nord. En l’assassinant, il pensait éliminer un atout décisif dont les autorités américaines auraient pu se servir après les attentats. Il s’ensuit que le 11 septembre, le monde apprend avec stupéfaction et angoisse que des attentats terroristes ont été commis aux Etats-Unis. Si, le jour même de la tragédie, le Président Georges W. Bush qualifie ces attentats d’“attaques terroristes”, il affirme très rapidement que “les attaques délibérées et meurtrières qui ont été menées contre notre pays étaient plus que des actes de terreur elles étaient des actes de guerre. Changeant ainsi de qualification, il déclare :“ A un acte de guerre, les Etats-Unis répondront par la guerre, contre le terrorisme” et fait le serment “d’engager une lutte monumentale du bien contre le mal”.
La condamnation de ces attentats est spontanée et quasiment unanime au niveau étatique. En revanche, une partie de la population des pays musulmans affiche sa satisfaction. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne adoptent, le 21 septembre, une déclaration aux termes de laquelle ils condamnent “ avec la plus grande fermeté les auteurs et les commanditaires de ces actes de barbarie”. Sur la base de la résolution 1368 du Conseil de sécurité, l’Union européenne considère que “la riposte américaine est légitime”. L’Organisation de la Conférence islamique, la Ligue des Etats arabes, le mouvement des non-alignés et l’OUA font de même. A son tour, l’OTAN condamne le terrorisme et invoque, en vertu de l’article 5 du traité de Washington, la légitime défense. Le 13 septembre, Oussama Ben Laden est désigné par le Secrétaire, d’Etat américain Colin Powell, comme étant le commanditaire des attentats suicides. Le régime tâlebân, tout en condamnant les attentats, nie l’implication d’Oussama Ben Laden et des “Arabes” présents en Afghanistan.
Dès lors, se pose la question de la qualification juridique des attentats terroristes, qui aura nécessairement des conséquences sur les justifications de la riposte américaine en Afghanistan. La qualification ne peut provenir en principe que du Conseil de sécurité, organe du maintien de la paix et de la sécurité internationales. En effet, le Conseil de sécurité, avec une célérité inhabituelle, adopte à l’unanimité, le 12 septembre, la résolution 1368 et le 28 septembre, en vertu du Chapitre VII, la résolution 1373. La première reconnaît, dans son préambule, le “droit inhérent” à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte. Mais elle ne désigne pas expressément le ou les bénéficiaire(s) de ce droit. Elle condamne avec force le terrorisme et demande une coopération accrue au plan international, en pleine application des conventions antiterroristes. La seconde réaffirme le considérant de la résolution 1368, mais elle utilise l’expression “le droit naturel” et non pas le “droit inhérent” conformément à la version française de l’article 51 de la Charte. Le paragraphe 1 de la résolution 1368 et le préambule de la résolution 1373 considèrent les attaques terroristes du 11 septembre comme une menace à la paix et à la sécurité internationales. Il importe de dire que la résolution 1368 n’est pas novatrice, puisque le Conseil de sécurité avait déjà, dans ses résolutions 731 du 21 janvier et 748 du 31 mars 1992, qualifié le terrorisme de menace contre la paix. En revanche, la nouveauté de la résolution 1373 est de dire que tout acte de terrorisme international, d’une manière générale, constitue une menace contre la paix et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, y compris celui de la force armée. L’importance de cette résolution est telle que certains auteurs n’hésitent pas à la considérer comme une convention anti-terroriste décidée par le Conseil de sécurité. En effet, par le truchement de cette résolution le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII, décide “un certain nombre d’obligations, qui sont d’autant plus remarquables qu’elles ne sont pas limitées au cas de l’Afghanistan mais concernent l’attitude des Etats vis-à-vis du terrorisme international en général et ne comportent pas de limites temporelles ou spatiales : les Etats doivent prévenir et réprimer le financement du terrorisme ; geler les fonds et avoirs financiers des terroristes et des entités contrôlées par eux… ; interdire à leurs nationaux de les financer ; s’abstenir de leur apporter quelque appui que ce soit, “actif ou passif”… ; instituer des contrôles efficaces aux frontières… ; intensifier l’échange d’informations opérationnelles… ; devenir partie aux conventions internationales en la matière et les “appliquer intégralement””. Cependant la question se pose de savoir si le Conseil de sécurité peut exercer des pouvoirs que la Charte ne lui attribue pas et s’il peut, comme le souligne à juste titre Jean-François Guilhaudis, “ainsi légiférer, concurrençant ou même confisquant le droit qui appartient aux Etats de consentir aux normes du droit international en devenant partie à des traités. Il suffit de soulever la question pour mesurer que l’édifice qu’établit la résolution 1373 (2001) reste fragile. Tout au plus le juriste admettra-t-il que cette résolution impose des obligations pour le cas présent, celui du 11 septembre”. Cela ne signifie pas pour autant que l’Etat victime d’actes terroristes peut utiliser la force armée en l’absence de l’autorisation spécifique du Conseil de sécurité. En effet, il n’est en principe possible à un Etat d’utiliser la force armée dans le cadre du mécanisme de sécurité collective du Chapitre VII, que dans la mesure où il existe une autorisation expresse.
Document n°2 : Conseil de sécurité, résolution 1373 (2001), 28 septembre 2001.
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001) du 12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que tous les États doivent :
a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme; b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme; c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles; d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;
2. Décide également que tous les États doivent : a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes; b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange de renseignements; c) Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs; d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États; e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes; f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure; g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de voyage;
3. Demande à tous les États : a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes; b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme; c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes; d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999; e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil de sécurité; f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé; g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés;
4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale;
5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies;
6. Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite à la présente résolution;
7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général;
8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
Document n°3 : Résolution A/RES/60/288, adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2006 [annexe : stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme].
Plan d’action
Nous, États Membres de l’Organisation des Nations Unies, décidons solennellement :
1. De condamner systématiquement, sans équivoque et vigoureusement le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, quels qu’en soient les auteurs, les lieux et les buts, car il constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales ;
2. D’agir d’urgence pour prévenir et combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et, en particulier :
a) D’envisager de devenir parties sans plus tarder aux conventions et protocoles internationaux en vigueur relatifs à la lutte contre le terrorisme, d’appliquer ces instruments et de n’épargner aucun effort pour parvenir à un accord et conclure une convention générale sur le terrorisme international ;
b) D’appliquer toutes les résolutions de l’Assemblée générale relatives aux mesures visant à éliminer le terrorisme international et les résolutions pertinentes de l’Assemblée qui ont trait à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ;
c) D’appliquer toutes les résolutions du Conseil de sécurité relatives au terrorisme international et de coopérer pleinement avec les organes subsidiaires du Conseil chargés de la lutte antiterroriste dans l’accomplissement de leurs mandats, sachant que de nombreux États ont encore besoin d’assistance pour appliquer ces résolutions ;
3. De reconnaître que la coopération internationale et toutes les mesures que nous prenons pour prévenir et combattre le terrorisme doivent être conformes aux obligations que nous impose le droit international, notamment la Charte des Nations Unies et les conventions et protocoles internationaux pertinents, en particulier les instruments relatifs aux droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit international humanitaire.
I. Mesures visant à éliminer les conditions propices à la propagation du
terrorisme
Nous sommes déterminés à prendre les mesures ci-après en vue d’éliminer les conditions propices à la propagation du terrorisme, s’agissant notamment des conflits qui perdurent, de la déshumanisation des victimes du terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, de l’absence de légalité et des violations des droits de l’homme, de la discrimination ethnique, nationale et religieuse, de l’exclusion politique, de la marginalisation socioéconomique et de l’absence de gouvernance, tout en sachant qu’aucune de ces conditions ne saurait excuser ou justifier des actes de terrorisme :
1. Continuer à renforcer et à utiliser au mieux les capacités de l’Organisation des Nations Unies dans des domaines tels que la prévention des conflits, la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire, la primauté du droit, le maintien et la consolidation de la paix, de manière à contribuer à la prévention des conflits et à la solution pacifique des conflits qui perdurent. Nous savons que le règlement pacifique de tels conflits contribuerait au renforcement de la lutte mondiale contre le terrorisme ;
2. Continuer à susciter, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, des initiatives et des programmes qui favorisent le dialogue, la tolérance et la compréhension entre les civilisations, les cultures, les peuples et les religions et à promouvoir le respect mutuel et la prévention de la diffamation entre les religions, les valeurs religieuses, les croyances et les cultures, et, à cet égard, nous saluons l’initiative du Secrétaire général en faveur de l’Alliance des civilisations. Nous saluons également les initiatives similaires prises dans d’autres parties du monde ;
3. Promouvoir une culture de paix, de justice et de développement humain, de tolérance ethnique, nationale et religieuse ainsi que le respect pour toutes les religions, valeurs religieuses, croyances et cultures en instituant ou en encourageant selon le cas des programmes d’éducation et de sensibilisation s’adressant à tous les secteurs de la société. À cet égard, nous encourageons l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à jouer un rôle clef notamment par le dialogue interconfessionnel et intraconfessionnel et le dialogue entre les civilisations ;
4. Poursuivre les efforts en vue d’adopter les mesures nécessaires et appropriées, compte tenu de nos obligations respectives découlant du droit international, pour interdire, en vertu de la loi, l’incitation à commettre des actes terroristes et prévenir de tels comportements ;
5. Réaffirmer notre détermination à oeuvrer pour la pleine réalisation, dans les meilleurs délais, des buts et objectifs de développement convenus lors des grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement. Nous réaffirmons notre volonté d’éliminer la pauvreté et de promouvoir une croissance économique soutenue, le développement durable et la prospérité pour tous dans le monde entier ;
6. Poursuivre et intensifier les programmes de développement et d’inclusion sociale à tous les niveaux, en tant qu’objectif à part entière, sachant que le progrès dans ce domaine, notamment en matière de chômage des jeunes, pourrait réduire la marginalisation, et donc le sentiment de persécution qui pousse à l’extrémisme et au recrutement de terroristes ;
7. Encourager l’ensemble des organismes des Nations Unies à renforcer les activités de coopération et d’assistance déjà en cours, s’agissant de la primauté du droit, des droits de l’homme et de la gouvernance, au service d’un développement économique et social durable ;
8. Envisager d’instituer, sur une base volontaire, les systèmes nationaux d’assistance qui privilégient les besoins des victimes du terrorisme et de leur famille et facilitent leur retour à une vie normale. À cet égard, nous encourageons les États à demander aux organes compétents des Nations Unies de les aider à mettre en place un tel système. Nous nous efforcerons également de promouvoir la solidarité
internationale avec les victimes et d’encourager la société civile à s’associer à la campagne mondiale de prévention et de condamnation du terrorisme. Ceci pourrait impliquer notamment que l’Assemblée générale étudie la possibilité de créer des mécanismes pratiques d’assistance aux victimes.
II. Mesures visant à prévenir et combattre le terrorisme
Nous sommes déterminés à prendre les mesures ci-après pour prévenir et combattre le terrorisme, notamment en privant les terroristes des moyens de mener à bien leurs attaques, d’atteindre leurs objectifs et d’obtenir les effets escomptés :
1. Nous abstenir d’organiser, de faciliter, de financer, d’encourager ou de tolérer des activités terroristes ou d’y participer et à prendre les mesures pratiques voulues pour que nos territoires respectifs ne soient pas utilisés pour des installations terroristes ou des camps d’entraînement ou pour la préparation ou l’organisation d’actes terroristes visant des États tiers ou leurs citoyens ;
2. Coopérer pleinement à la lutte contre le terrorisme, conformément à nos obligations en vertu du droit international, pour découvrir, priver d’asile et traduire en justice, par voie d’extradition ou de poursuites, quiconque aide ou facilite le financement, la planification, la préparation ou la commission d’actes de terrorisme ou qui tente de le faire ou qui offre l’asile à de tels individus ;
3. Veiller à ce que les responsables d’actes de terrorisme soient appréhendés et poursuivis en justice ou extradés, conformément aux dispositions pertinentes du droit national et international, en particulier du droit relatif aux droits de l’homme, du droit des réfugiés et du droit international humanitaire. Nous nous efforcerons à cet effet de conclure et de mettre en oeuvre des accords d’entraide judiciaire et d’extradition et de renforcer la coopération entre les organes de police ;
4. Intensifier la coopération, selon que de besoin, en échangeant dans les meilleurs délais des informations précises concernant la prévention et la répression du terrorisme ;
5. Renforcer la coordination et la coopération entre les États dans la lutte contre les infractions susceptibles d’être liées au terrorisme, y compris le trafic de drogues sous tous ses aspects, le trafic d’armes, en particulier d’armes légères, y compris les systèmes portables de défense aérienne, le blanchiment d’argent et l’introduction clandestine de matières nucléaires, chimiques, biologiques, radiologiques et d’autres matières présentant un danger mortel ;
6. Envisager de devenir parties sans délai à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses trois protocoles additionnels et de les appliquer ;
7. Prendre les mesures voulues, avant d’accorder l’asile, pour veiller à ce que le demandeur ne soit pas engagé dans des activités terroristes et, après avoir accordé l’asile, pour veiller à ce que le statut de réfugié ne soit pas utilisé d’une manière contraire aux dispositions visées au paragraphe 1 de la section II ci-dessus ;
8. Encourager les organisations régionales et sous-régionales concernées à créer des mécanismes ou des centres antiterroristes ou à renforcer ceux qui existent. Nous encourageons le Comité contre le terrorisme et sa Direction ainsi que, lorsque cela relève de leur mandat actuel, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation internationale de police criminelle, à offrir à ces organisations la coopération et l’assistance dont elles pourraient avoir besoin à cette fin ;
9. Reconnaître que la question de la création d’un centre international pour lutter contre le terrorisme devrait être examinée, au titre des efforts engagés à l’échelle internationale pour renforcer la lutte contre le terrorisme ;
10. Encourager les États à appliquer les normes internationales détaillées faisant l’objet des quarante recommandations sur le blanchiment de capitaux et des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du Groupe d’action financière, en ayant à l’esprit qu’une assistance pourra leur être nécessaire à cet égard ;
11. Inviter le système des Nations Unies à élaborer, avec les États Membres, une base de données complète et unique sur les incidents biologiques, en veillant à ce qu’elle soit complémentaire à la base de données sur la biocriminalité que l’Organisation internationale de police criminelle envisage de constituer. Nous encourageons aussi le Secrétaire général à actualiser la liste des experts et des laboratoires, ainsi que les directives et procédures techniques, mis à sa disposition aux fins de la conduite d’enquêtes rapides et efficaces sur l’emploi présumé. Nous notons en outre l’importance de la proposition du Secrétaire général tendant à associer, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, les principales parties prenantes en matière de biotechnologie, notamment les entreprises, la communauté scientifique, la société civile et les Gouvernements, au sein d’un programme commun visant à garantir que les progrès de la biotechnologie ne sont pas utilisés à des fins terroristes ou à d’autres fins criminelles mais à des fins d’utilité publique, compte dûment tenu des normes internationales fondamentales en matière de droits de propriété intellectuelle ;
12. S’employer avec l’Organisation des Nations Unies, sans nuire à la confidentialité, dans le respect des droits de l’homme et conformément aux autres obligations prévues par le droit international, à explorer les moyens :
a) De coordonner les efforts aux échelles internationale et régionale afin de contrer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations sur l’Internet ;
b) D’utiliser l’Internet comme un outil pour faire échec au terrorisme, tout en reconnaissant que les États pourront avoir besoin d’une assistance à cet égard ;
13. Renforcer les initiatives nationales et la coopération bilatérale, sousrégionale, régionale et internationale, selon qu’il convient, pour améliorer les contrôles frontaliers et douaniers, afin de prévenir et de détecter les mouvements de terroristes et de prévenir et de détecter le trafic d’armes légères, de munitions et d’explosifs classiques, d’armes et de matières nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques, entre autres, tout en reconnaissant que les États pourront avoir besoin d’une assistance à cet égard ;
14. Encourager le Comité contre le terrorisme et sa direction à poursuivre l’action menée avec les États, à la demande de ceux-ci, pour faciliter l’adoption de législations et de mesures administratives permettant de donner effet aux obligations relatives aux déplacements des terroristes, et pour identifier les pratiques optimales dans ce domaine, en s’inspirant toutes les fois que cela est possible de celles établies par des organisations internationales à caractère technique comme l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation mondiale des douanes et l’Organisation internationale de police criminelle ;
15. Encourager le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) à continuer de s’employer à renforcer l’efficacité de l’interdiction de voyager prévue par le régime de sanctions de l’Organisation des Nations Unies visant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées, et pour s’assurer, à titre prioritaire, du recours à des procédures équitables et transparentes pour l’inscription de personnes et d’entités sur les listes du Comité et pour leur radiation de ces listes ainsi que pour l’octroi de dérogations pour raisons humanitaires. À cet égard, nous encourageons les États à échanger des informations, notamment en diffusant largement les notices spéciales Interpol-Nations Unies relatives aux personnes visées par ce régime de sanctions ;
16. Intensifier les efforts et la coopération à tous les niveaux, selon qu’il convient, pour améliorer la sécurité de la fabrication et de la délivrance des documents d’identité et de voyage et pour prévenir et détecter leur falsification ou leur utilisation frauduleuse, tout en reconnaissant que les États pourront avoir besoin d’une assistance à cet égard. Nous invitons d’ailleurs l’Organisation internationale de police criminelle à perfectionner sa base de données sur les documents de voyage volés et perdus, et nous nous emploierons à utiliser pleinement cet outil comme il convient, en particulier en échangeant les informations pertinentes ;
17. Inviter l’Organisation des Nations Unies à mieux coordonner les activités visant à préparer une intervention en cas d’attaque terroriste perpétrée au moyen d’armes ou de matières nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques, en particulier en examinant et en renforçant l’efficacité du dispositif de coordination interorganisations actuel pour les opérations d’assistance, de secours et d’aide aux victimes, de sorte que tous les États puissent recevoir l’aide dont ils ont besoin. Nous invitons à cet égard l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité à énoncer des directives concernant la coopération et l’assistance nécessaires en cas d’attaque terroriste perpétrée avec des armes de destruction massive ;
18. Renforcer les efforts visant à améliorer la sécurité et la protection des cibles particulièrement vulnérables comme les infrastructures et les lieux publics, ainsi que les interventions en cas d’attaques terroristes et autres catastrophes, en particulier dans le domaine de la protection des civils, tout en reconnaissant que les États pourront avoir besoin d’une assistance à cet égard.
Document n°4 : Conseil de sécurité, Résolution 2133 (2014), 27 janvier 2014
Résolution 2133 (2014)
Adoptée par le Conseil de sécurité, à sa 7101e séance, le 27 janvier 2014
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient le mobile, le moment et les auteurs et réaffirmant aussi qu’il est impératif de combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
Rappelant toutes ses résolutions et déclarations présidentielles concernant les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
Réaffirmant l’obligation faite aux États Membres de prévenir et de réprimer le financement des actes terroristes,
Rappelant les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme, notamment la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et la Convention internationale contre la prise d’otages,
Condamnant fermement les enlèvements et les prises d’otages perpétrés par des groupes terroristes quel qu’en soit le but, y compris celui d’obtenir des fonds ou des concessions politiques,
Préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages imputables à des groupes terroristes agissant dans le dessein d’obtenir des fonds ou des concessions politiques, en particulier celle des enlèvements commis par Al- Qaida et les groupes qui lui sont associés, et soulignant que les rançons versées à des terroristes financent de futurs enlèvements et prises d’otages, multipliant ainsi le nombre des victimes et perpétuant le problème,
Déterminé à prévenir les enlèvements et prises d’otages perpétrés par des groupes terroristes et à faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs sans qu’il soit versé de rançon ou accordé quelque concession politique, et ce, dans le respect du droit international applicable, et prenant acte à cet égard de l’œuvre accomplie par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, en particulier la publication par celui-ci de plusieurs documents-cadres et de bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne les enlèvements contre rançon, qui vient compléter les activités menées dans ce domaine par les entités des Nations Unies qui luttent contre le terrorisme,
Considérant qu’il faut redoubler d’efforts pour soutenir les victimes et ceux qui sont touchés par les enlèvements contre rançon et prises d’otages perpétrés par des groupes terroristes et se soucier spécialement de protéger la vie des otages et des personnes victimes d’enlèvement, et réaffirmant que les États doivent veiller à ce que toutes mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient conformes aux obligations que leur impose le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit international humanitaire, selon qu’il convient,
Prenant note de la décision issue du Sommet du Groupe des Huit, tenu à Lough Erne, de s’attaquer à la menace que sont les enlèvements contre rançon perpétrés par des terroristes, d’envisager les mesures de prévention que la communauté internationale pourrait adopter dans ce sens et d’encourager la poursuite de la réflexion par les experts, y compris dans le cadre du Groupe Lyon- Rome, le but étant de mieux cerner le problème, et prenant note également du paragraphe 225.6 du document final de la seizième Conférence au sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés, dans lequel ceux-ci ont condamné les actes criminels que sont les prises d’otages accompagnées de la demande, par des groupes terroristes, de rançon et/ou de concessions politiques,
Déterminé à soutenir les efforts tendant à empêcher les terroristes d’avoir accès à des fonds et à des services financiers, notamment les travaux que mènent les organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme et le Groupe d’action financière pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et les circuits de financement du terrorisme à l’échelle mondiale,
S’inquiétant que, dans une société mondialisée, les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les nouvelles technologies de l’information et des communications, en particulier Internet, aux fins de recrutement et d’incitation à commettre des actes de terrorisme, ainsi que de financement, de planification et de préparation de leurs activités,
Rappelant ses résolutions 1904 (2009), 1989 (2011) et 2083 (2012), venues confirmer notamment que les prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 1 visent également le paiement de rançons à des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la Liste relative aux sanctions contre Al-Qaida,
Réaffirmant que les actes de terrorisme et les méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations Unies, de même que le fait de sciemment financer et de planifier des actes de terrorisme ou d’inciter à des actes de terrorisme,
1. Réaffirme sa résolution 1373 (2001), dans laquelle il a décidé en particulier que tous les États doivent prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme et s’abstenir d’apporter quelque forme d’appui, actif ou passif que ce soit, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes;
2. Réaffirme également la décision qu’il a prise dans sa résolution 1373 (2001), à savoir que tous les États doivent interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes, directement ou indirectement, à la disposition de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant pour le compte ou sur instruction de ces personnes;
3. Demande à tous les États Membres d’empêcher les terroristes de profiter directement ou indirectement de rançons ou de concessions politiques, et de faire en sorte que les otages soient libérés sains et saufs;
4. Demande également à tous les États Membres d’œuvrer en étroite coopération en présence d’enlèvements ou de prises d’otages commis par des groupes terroristes;
5. Réaffirme la décision qu’il a prise dans sa résolution 1373 (2001), à savoir que tous les États doivent se prêter mutuellement la plus grande assistance à l’occasion d’enquêtes criminelles ou de poursuites pénales relatives au financement d’actes de terrorisme ou à l’appui à de tels actes;
6. Considère qu’il est nécessaire pour les experts d’approfondir la réflexion sur les enlèvements contre rançon perpétrés par des terroristes et demande aux États Membres de poursuivre les débats d’experts au sein de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales ou régionales compétentes, notamment le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, le but étant de dégager les mesures complémentaires que la communauté internationale pourrait prendre pour prévenir les enlèvements et empêcher les terroristes d’en profiter directement ou indirectement ou d’avoir recours aux enlèvements pour obtenir des fonds ou des concessions politiques;
7. Note que les rançons versées à des groupes terroristes constituent l’une des sources de revenus qui viennent soutenir l’effort de recrutement mené par ces groupes, renforcer leur capacité opérationnelle d’organiser et de perpétrer des attentats terroristes, et encourager la pratique des enlèvements contre rançon;
8. Engage le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste à tenir, avec l’aide de spécialistes de la question, une réunion extraordinaire à laquelle participeraient les États Membres et les organisations internationales et régionales compétentes afin de débattre des mesures visant à empêcher les groupes terroristes de perpétrer des enlèvements et des prises d’otages dans le but d’obtenir des fonds ou des concessions politiques, et demande au Comité contre le terrorisme de faire rapport au Conseil sur les résultats de cette réunion;
9. Rappelle que le Forum mondial de lutte contre le terrorisme a adopté le Mémorandum d’Alger sur les bonnes pratiques en matière de prévention des enlèvements contre rançon par des terroristes et d’élimination des avantages qui en découlent et engage la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme à en tenir compte, selon qu’il conviendra, dans le respect de son mandat, y compris pour ce qui est de faciliter le renforcement des capacités des États Membres;
10. Demande à tous les États Membres d’encourager les partenaires du secteur privé à adopter ou à respecter les lignes directrices et bonnes pratiques applicables pour prévenir les enlèvements terroristes ou y faire face sans verser de rançon;
11. Demande également à tous les États Membres de coopérer et d’engager un dialogue avec tous les organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme, selon qu’il conviendra, l’objectif étant de leur donner les moyens de lutter contre le financement du terrorisme, notamment en usant de rançons;
12. Encourage l’équipe de surveillance associée au Comité des sanctions contre Al-Qaida, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1988 (2011) et les autres organes des Nations Unies chargés de la lutte contre le terrorisme d’œuvrer en étroite coopération pour renseigner sur les mesures prises par les États Membres sur la question ainsi que sur les tendances et l’évolution dans ce domaine;
13. Décide de rester saisi de la question.
Document 5 : CJUE, Grande Chambre, affaires jointes C-402/05 P et C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européenne, 3 septembre 2008 (Extraits)
280 Il convient d’examiner les griefs par lesquels les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, en substance, qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies ne laissant place à aucune marge à cet effet, ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel quant à sa légalité interne, sauf pour ce qui concerne sa compatibilité avec les normes relevant du jus cogens, et bénéficie donc dans cette mesure d’une immunité juridictionnelle.
281 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Communauté est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité CE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de la légalité des actes des institutions (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 23).
282 Il convient de rappeler également qu’un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique communautaire dont la Cour assure le respect en vertu de la compétence exclusive dont elle est investie par l’article 220 CE, compétence que la Cour a d’ailleurs déjà considérée comme relevant des fondements mêmes de la Communauté (voir, en ce sens, avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, points 35 et 71, ainsi que arrêt du 30 mai 2006, Commission/Irlande, C-459/03, Rec. p. I‑4635, point 123 et jurisprudence citée).
283 En outre, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. À cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière (voir, notamment, arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, Rec. p. I‑5305, point 29 et jurisprudence citée).
284 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le respect des droits de l’homme constitue une condition de la légalité des actes communautaires (avis 2/94, précité, point 34) et que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect de ceux-ci (arrêt du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00, Rec. p. I-5659, point 73 et jurisprudence citée).
285 Il découle de l’ensemble de ces éléments que les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité CE, au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux, ce respect constituant une condition de leur légalité qu’il incombe à la Cour de contrôler dans le cadre du système complet de voies de recours qu’établit ce traité.
286 À cet égard, il importe de souligner que, dans un contexte tel que celui de l’espèce, le contrôle de légalité devant ainsi être assuré par le juge communautaire porte sur l’acte communautaire visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, et non sur ce dernier en tant que tel.
287 S’agissant plus particulièrement d’un acte communautaire qui, tel le règlement litigieux, vise à mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, il n’incombe donc pas au juge communautaire, dans le cadre de la compétence exclusive que prévoit l’article 220 CE, de contrôler la légalité d’une telle résolution adoptée par cet organe international, ce contrôle fût-il limité à l’examen de la compatibilité de cette résolution avec le jus cogens.
(…)
290 Il y a dès lors lieu d’examiner si, comme l’a jugé le Tribunal, les principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire impliquent qu’un contrôle juridictionnel de la légalité interne du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux est en principe exclu, nonobstant le fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 281 à 284 du présent arrêt, un tel contrôle constitue une garantie constitutionnelle relevant des fondements mêmes de la Communauté.
(…)
301 Il est certes exact que la Cour a déjà admis que l’article 234 du traité CE (devenu, après modification, article 307 CE) pouvait, si ses conditions d’application étaient réunies, permettre des dérogations même au droit primaire, par exemple à l’article 113 du traité CE, relatif à la politique commerciale commune (voir, en ce sens, arrêt Centro-Com, précité, points 56 à 61).
302 Il est également vrai que l’article 297 CE permet implicitement des entraves au fonctionnement du marché commun qui seraient causées par des mesures qu’un État membre adopterait pour mettre en œuvre des engagements internationaux qu’il a contractés en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.
303 Toutefois, ces dispositions ne sauraient être comprises comme autorisant une dérogation aux principes de la liberté, de la démocratie ainsi que du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés à l’article 6, paragraphe 1, UE en tant que fondement de l’Union.
304 L’article 307 CE ne pourrait en effet en aucun cas permettre la remise en cause des principes qui relèvent des fondements mêmes de l’ordre juridique communautaire, parmi lesquels celui de la protection des droits fondamentaux, qui inclut le contrôle par le juge communautaire de la légalité des actes communautaires quant à leur conformité avec ces droits fondamentaux.
305 Une immunité juridictionnelle du règlement litigieux quant au contrôle de la compatibilité de celui-ci avec les droits fondamentaux qui trouverait sa source dans une prétendue primauté absolue des résolutions du Conseil de sécurité que cet acte vise à mettre en œuvre ne pourrait pas non plus être fondée sur la place qu’occuperaient les obligations découlant de la charte des Nations unies dans la hiérarchie des normes au sein de l’ordre juridique communautaire si ces obligations étaient classifiées dans cette hiérarchie.
306 En effet, l’article 300, paragraphe 7, CE prévoit que les accords conclus selon les conditions fixées à cet article lient les institutions de la Communauté et les États membres.
307 Ainsi, en vertu de cette disposition, si elle était applicable à la charte des Nations unies, cette dernière bénéficierait de la primauté sur les actes de droit communautaire dérivé (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C‑308/06, non encore publié au Recueil, point 42 et jurisprudence citée).
308 Toutefois, cette primauté au plan du droit communautaire ne s’étendrait pas au droit primaire et, en particulier, aux principes généraux dont font partie les droits fondamentaux.
309 Cette interprétation est corroborée par le paragraphe 6 du même article 300 CE, selon lequel un accord international ne peut entrer en vigueur si la Cour a rendu un avis négatif sur sa compatibilité avec le traité CE, à moins que celui-ci n’ait été modifié au préalable.
310 Il a cependant été soutenu devant la Cour, notamment lors de l’audience, que, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans plusieurs décisions récentes, s’est déclarée incompétente pour contrôler la conformité de certains actes intervenus dans le cadre de la mise en œuvre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, les juridictions communautaires devraient s’abstenir de contrôler la légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux, dès lors que cet acte vise également à mettre en œuvre de telles résolutions.
311 À cet égard, il convient de constater que, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, une différence fondamentale existe entre la nature des actes concernés par lesdites décisions, à l’égard desquels cette juridiction s’est déclarée incompétente pour exercer un contrôle de conformité par rapport à la CEDH, et celle d’autres actes pour lesquels sa compétence apparaît incontestable (voir Cour eur. D. H., décision Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège du 2 mai 2007, non encore publiée au Recueil des arrêts et décisions, § 151).
312 En effet, si, dans certaines affaires dont elle a été saisie, la Cour européenne des droits de l’homme s’est déclarée incompétente ratione personae, celles-ci concernaient des actions directement imputables à l’ONU en tant qu’organisation à vocation universelle remplissant un objectif impératif de sécurité collective, en particulier des actions d’un organe subsidiaire de l’ONU instauré dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actions se situant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs valablement délégués par le Conseil de sécurité en application de ce même chapitre, et non des actions imputables aux États défendeurs devant ladite Cour, ces actions n’ayant par ailleurs pas eu lieu sur le territoire de ces États et n’ayant pas découlé d’une décision des autorités de ceux-ci.
313 En revanche, au paragraphe 151 de la décision Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège, précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que, dans l’affaire ayant donné lieu à son arrêt Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande, précité, concernant une mesure de saisie mise en œuvre par les autorités de l’État défendeur sur son territoire national à la suite d’une décision d’un ministre de cet État, elle a reconnu sa compétence, notamment ratione personae, vis-à-vis de l’État défendeur, bien que la mesure en cause eût été décidée sur la base d’un règlement communautaire pris lui-même en application d’une résolution du Conseil de sécurité.
314 En l’espèce, il y a lieu de constater que le règlement litigieux ne saurait être considéré comme constituant un acte directement imputable à l’ONU en tant qu’action relevant de l’un des organes subsidiaires de celle-ci instaurés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou se situant dans le cadre de l’exercice de pouvoirs valablement délégués par le Conseil de sécurité en application de ce même chapitre.
315 En outre, et en tout état de cause, la question de la compétence de la Cour pour se prononcer sur la validité du règlement litigieux se pose dans un cadre fondamentalement différent.
316 En effet, ainsi qu’il a déjà été rappelé aux points 281 à 284 du présent arrêt, le contrôle, par la Cour, de la validité de tout acte communautaire au regard des droits fondamentaux doit être considéré comme l’expression, dans une communauté de droit, d’une garantie constitutionnelle découlant du traité CE en tant que système juridique autonome à laquelle un accord international ne saurait porter atteinte.
317 La question de la compétence de la Cour se pose en effet dans le cadre de l’ordre juridique interne et autonome de la Communauté, dont relève le règlement litigieux, et dans lequel la Cour est compétente pour contrôler la validité des actes communautaires au regard des droits fondamentaux.
318 Il a en outre été soutenu que, eu égard à la déférence s’imposant aux institutions communautaires à l’égard des institutions des Nations unies, la Cour devrait renoncer à exercer un contrôle de la légalité du règlement litigieux au regard des droits fondamentaux, même si un tel contrôle était possible, dès lors que, dans le cadre du régime de sanctions instauré par les Nations unies, compte tenu en particulier de la procédure de réexamen telle qu’elle a été récemment améliorée de manière significative par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, les droits fondamentaux sont suffisamment protégés.
319 Selon la Commission, tant que, dans ledit régime de sanctions, les particuliers ou entités concernés ont une possibilité acceptable d’être entendus grâce à un mécanisme de contrôle administratif s’intégrant dans le système juridique des Nations unies, la Cour ne devrait intervenir d’aucune façon.
320 À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, si, effectivement, à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité de plusieurs résolutions, des modifications ont été apportées au régime des mesures restrictives instauré par les Nations unies pour ce qui concerne tant l’inscription sur la liste récapitulative que la radiation de celle-ci [voir, spécialement, les résolutions 1730 (2006), du 19 décembre 2006, et 1735 (2006), du 22 décembre 2006], ces modifications sont intervenues postérieurement à l’adoption du règlement litigieux, de sorte que, en principe, elles ne sauraient être prises en compte dans le cadre des présents pourvois.
321 En tout état de cause, l’existence, dans le cadre de ce régime des Nations unies, de la procédure de réexamen devant le comité des sanctions, même en tenant compte des modifications récentes apportées à celle-ci, ne peut entraîner une immunité juridictionnelle généralisée dans le cadre de l’ordre juridique interne de la Communauté.
322 En effet, une telle immunité, qui constituerait une dérogation importante au régime de protection juridictionnelle des droits fondamentaux prévu par le traité CE, n’apparaît pas justifiée, dès lors que cette procédure de réexamen n’offre manifestement pas les garanties d’une protection juridictionnelle.
323 À cet égard, s’il est désormais possible pour toute personne ou entité de s’adresser directement au comité des sanctions en soumettant sa demande de radiation de la liste récapitulative au point dit «focal», force est de constater que la procédure devant ce comité demeure essentiellement de nature diplomatique et interétatique, les personnes ou entités concernées n’ayant pas de possibilité réelle de défendre leurs droits et ledit comité prenant ses décisions par consensus, chacun de ses membres disposant d’un droit de veto.
324 Il ressort à cet égard des directives du comité des sanctions, telles que modifiées en dernier lieu le 12 février 2007, que le requérant ayant présenté une demande de radiation ne peut en aucune manière faire valoir lui-même ses droits lors de la procédure devant le comité des sanctions ni se faire représenter à cet effet, le gouvernement de l’État de sa résidence ou de sa nationalité ayant seul la faculté de transmettre éventuellement des observations sur cette demande.
325 En outre, lesdites directives n’imposent pas au comité des sanctions de communiquer audit requérant les raisons et les éléments de preuve justifiant l’inscription de celui-ci sur la liste récapitulative ni de lui donner un accès, même limité, à ces données. Enfin, en cas de rejet de la demande de radiation par ce comité, aucune obligation de motivation ne pèse sur ce dernier.
326 Il découle de ce qui précède que les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.
327 Partant, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 212 à 231 de l’arrêt attaqué Kadi ainsi que 263 à 282 de l’arrêt attaqué Yusuf et Al Barakaat, qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies ne laissant aucune marge à cet effet, doit bénéficier d’une immunité juridictionnelle quant à sa légalité interne sauf pour ce qui concerne sa compatibilité avec les normes relevant du jus cogens.
328 Les moyens des requérants sont donc fondés sur ce point, de sorte qu’il y a lieu d’annuler les arrêts attaqués à cet égard.
329 Il en découle qu’il n’y a plus lieu d’examiner les griefs dirigés contre la partie des arrêts attaqués relative au contrôle du règlement litigieux au regard des règles de droit international relevant du jus cogens et, partant, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner le pourvoi incident du Royaume-Uni sur ce point.
330 En outre, dès lors que, dans la partie subséquente des arrêts attaqués relative aux droits fondamentaux spécifiques invoqués par les requérants, le Tribunal s’est limité à examiner la légalité du règlement litigieux au regard de ces seules règles, alors qu’il lui incombait d’effectuer un examen, en principe complet, au regard des droits fondamentaux relevant des principes généraux du droit communautaire, il y a également lieu d’annuler cette partie subséquente desdits arrêts.
Document n° 6 : Amnesty International, « Europe : des mesures disproportionnées », 17 janvier 2017 (Extraits)
La résolution n° 2178 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en un temps record en septembre 2014, imposait aux États l'adoption de lois visant à s'attaquer à la menace des « combattants terroristes étrangers ». Depuis, de très nombreuses mesures de lutte contre le terrorisme ont été proposées ou mises en œuvre dans la plupart des États européens. Au lieu de renforcer le système européen de protection des droits humains, ces mesures ne font que le démanteler progressivement, mettant ainsi en danger des droits durement acquis.
Les principales caractéristiques que ces programmes de lutte contre le terrorisme partagent sont :
- des procédures accélérées, grâce auxquelles les lois sont adoptées à la hâte, avec très peu, voire aucune, consultation auprès des parlements, des experts, ou d'autres membres de la société civile ;
- des dérogations aux engagements en matière de droits humains, dans la loi, ou dans la pratique, avec bien souvent des effets néfastes sur la vie de la population ;
- la consolidation du pouvoir dans les mains de l'exécutif, de ses agences et des services de sécurité́ et de renseignement, ne laissant souvent que peu, voire aucun, rôle au système judiciaire pour autoriser les mesures ou pour effectuer un contrôle réel ;
- l'inefficacité́ ou l'absence de mécanismes de contrôle indépendants chargés de surveiller la mise en œuvre des mesures et des opérations de lutte contre le terrorisme, d'identifier les abus et d'amener les responsables de violations des droits humains à rendre des comptes ;
- une définition vague et extrêmement large du « terrorisme » dans la législation, en violation du principe de légalité́, ce qui mène à de nombreuses violations ;
- des exigences en matière de preuves revues à la baisse, passant de la norme traditionnelle du « soupçon raisonnable » au simple « soupçon », voire dans certains États, à une absence totale d'exigence en matière de soupçon ;
- des liens très faibles, voire parfois inexistants, entre des soi-disant « actes préparatoires » ou des infractions non réalisées, et l'infraction pénale elle-même ;
- l'utilisation de mesures de contrôle administratif pour restreindre le droit de circuler librement et la liberté d'association de certaines personnes, en lieu et place de sanctions pénales qui leur offriraient de meilleures garanties contre les abus ;
- la pénalisation de nombreuses formes d'expression qui sont loin de constituer une incitation à la violence, ce qui menace la contestation légitime, la liberté d'expression et la liberté artistique ;
- moins de possibilités de contester les mesures et les opérations de lutte contre le terrorisme, en particulier en raison de l'utilisation par l'État de preuves secrètes, qui ne sont généralement pas divulguées aux personnes affectées par les mesures ni à leur avocat ;
- l'invocation par les États de problèmes de sécurité nationale ou de « menace terroriste » afin de prendre arbitrairement pour cible les refugiés et les migrants, les défenseurs des droits humains, les militants, les opposants politiques, les journalistes, les minorités, et les personnes exerçant en toute légalité́ leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion ; et
- le manque d'attention porté aux besoins et à la protection des droits de groupes particuliers, notamment les femmes et les enfants.
La récente vague de mesures de lutte contre le terrorisme constitue également une violation de l'un des principes fondateurs de l'UE : le principe de non-discrimination. Bien souvent, ces mesures se sont avérées discriminatoires en théorie et dans la pratique, et ont affecté certaines populations de manière disproportionnée et extrêmement néfaste, en particulier les musulmans, les étrangers, ou les personnes considérées comme musulmanes ou étrangères.
Document n°10: M. KOHEN, « Combattre le terrorisme avec les armes du droit », Le Temps, 18 novembre 2015.
Il y a presque une quinzaine d’années, six jours après les attentats du 11 septembre, j’ai publié un article d’opinion dans ces mêmes colonnes sous le titre «L’arme de la civilisation, c’est le droit». Entre-temps, il y a eu les guerres d’Afghanistan, d’Irak, de la Libye, du Mali et d’autres régions d’Afrique. Le conflit israélo-palestinien s’enlise dans sa spirale quotidienne de violence sans que la communauté internationale ne fasse quoi que ce soit pour le régler une fois pour toutes. Depuis lors, non seulement le terrorisme n’a pas été vaincu, mais il s’est développé de façon exponentielle. A Al-Qaïda s’ajoute maintenant les Daech et autres Boko Aram. Le terrorisme contrôle désormais une partie du territoire de deux Etats au Moyen-Orient et des Européens sont embrigadés par centaines, voire par milliers.
Mon article dans «Le Temps» du 17 septembre 2001 était un plaidoyer pour combattre le terrorisme avec les armes du droit, tant sur le plan interne qu’international. Malheureusement, le droit a été sans cesse laissé de côté. Recours à la force et renversement des régimes sans autorisation du Conseil de sécurité ou détournant cette autorisation; maintien du camp de détention de Guantánamo, lequel jette l’opprobre sur l’état de droit et les droits humains sans pour autant renforcer d’un pouce la sécurité des Etats-Unis. Echanges d’hypocrisies entre Russes, qui ont enlevé un morceau de territoire à l’Ukraine, en Crimée, et Occidentaux, qui avaient auparavant enlevé un morceau de territoire à la Serbie, au Kosovo. Les uns et les autres se rappelant l’existence de certains principes fondamentaux de droit international, tel celui du respect de l’intégrité territoriale, uniquement quand cela les arrange. Retour à une politique de demi guerre froide qui peut être utile pour satisfaire certaines exigences de politique interne, mais qui néglige qu’il existe un ennemi commun farouche et fanatique aux portes de l’Europe et en son sein même déjà. Peuples européens se laissant tromper par les chants des sirènes xénophobes qui poussent à combattre le tchador ou la construction de nouveaux -et impossibles- minarets, au lieu de se concentrer sur l’essentiel, accentuant le clivage même que les terroristes appellent de tous leurs vœux.
Presqu’une quinzaine d’années après le 11-Septembre, les réflexes ataviques se manifestent à l’identique. François Hollande a tenu, presque mot par mot, le même discours que George W. Bush. Son maître mot a été «la guerre». Certes, la situation aujourd’hui n’est pas la même qu’en 2001. Il faut se battre aujourd’hui contre un ennemi ayant désormais une assise territoriale. Or, bombarder massivement la vile syrienne faisant office de fief de Daech en raison de l’attentat terroriste n’est pas précisément la démonstration d’une politique raisonnée. Assimiler la lutte contre le terrorisme à la «guerre» est un chemin semé d’embuches. Cette qualification ne rend pas en soi la lutte plus efficace. Le terroriste est un criminel, pas un combattant. L’unilatéralisme militaire ne mène nulle part.
Les conditions sont réunies depuis un bon moment pour que les grandes puissances utilisent une fois pour toutes les moyens de la sécurité collective décrits par la Charte des Nations unies. Pour ce qui est de la situation en Syrie et en Irak, il semble qu’il ait fallu le 13 novembre pour que certains dirigeants s’aperçoivent qu’il fallait travailler d’entente avec la Russie. Il est temps de se concentrer sur l’ennemi à abattre, Daech, plutôt que de spéculer sur la démocratisation de la Syrie. Churchill n’a pas hésité à s’allier avec Staline pour combattre Hitler. S’il avait tenu le même discours que certains dirigeants français à propos du régime dictatorial de Bachar al-Assad, peut-être que le drapeau à croix gammée flotterait encore sur Paris. Le mot d’ordre devrait, d’abord, être celui d’en finir avec le contrôle territorial de Daech; ensuite pourra-t-on parler de la nécessaire démocratisation de la Syrie. Cela exige une action concertée au sein du Conseil de sécurité, dans le cadre du Chapitre VII de la Charte, qui vise non seulement l’indispensable volet militaire, mais aussi les volets économique et politique. Car il n’est un secret pour personne que certains Etats de la région favorisent, ou à tout le moins laissent agir, Daech.
Une situation due aux errements des grandes puissances
Que personne ne se trompe. La situation actuelle n’est pas le résultat des «imperfections» du droit international ou du prétendu angélisme de ceux et celles qui prônent son respect. L’afflux des réfugiés qui fuient ceux-là même qui commettent les attentats est le résultat des errements des grandes puissances en Irak, en Libye et en Syrie depuis des années. Les moyens de la sécurité collective sont là à la disposition des Etats depuis belle lurette. L’arsenal des instruments internationaux de lutte contre le terrorisme aussi. Que certains gouvernements décident d’agir seuls ou dans une coalition organisée autour du commandement exclusif et incontesté d’une seule puissance est un choix politique dont les conséquences se font durement sentir aujourd’hui. Ce n’est pas parce que l’on doit faire face à un ennemi qui ne respecte même pas la plus insignifiante règle du droit humanitaire, ou la dignité humaine tout court, que l’on doit répondre en s’abaissant à son niveau.
Certes, tout système juridique est perfectible. Il n’est toutefois pas besoin d’adapter le droit humanitaire aux conditions de la lutte anti-terroriste pour mener celle-ci efficacement. Le terroriste qui se trouve en Europe est un criminel de droit commun qui doit être arrêté, jugé et condamné. Les terroristes qui font partie des forces combattantes en Syrie et en Iraq et qui commettent les pires exactions imaginables contre les populations civiles et les forces armées qui les combattent commettent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qui méritent d’être traités comme tels. Les outils sont là. Il ne manque que la volonté politique pour les utiliser. Lorsqu’on laisse de côté le droit pour combattre le terrorisme, c’est parce que le terrorisme a imposé sa vision des choses.
Le drame de Paris du 13 novembre devrait au moins servir à asseoir une réponse collective de la communauté internationale. Une réponse qui servira à fortifier l’Etat de droit dans son ensemble, à résoudre les conflits qui servent d’argument aux groupes terroristes pour recruter de nouveaux adeptes. Une réponse qui permettra, enfin, de créer de meilleures conditions pour lutter contre ce fléau qui ne fait pas de différence entre ses victimes, qu’elles soient chrétiennes, juives, musulmanes ou encore non-croyantes.
|
Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques
|
Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |
Équipe pédagogique en droit international public :
|
Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama |
Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz |
3ème année de LICENCE
TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)
Séance n° 9
Corrections / révisions
Les questions devront être posées en amont au chargé(e) de TD afin de pouvoir faire l’objet de révisions lors de cette séance.
Pour lecture sur le thème de la notion du combattant en droit international humanitaire :
1) Article 43 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (la définition légale des combattants)
2) Article 4 de la 3ème Convention de Genève (la définition légale des combattants)
3) Mireille DELMAS-MARTY, Vers une communauté de valeurs ? Les forces imaginantes du droit, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p.59-62
Document N° 1 : Article 43 du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (la définition légale des combattants)
Article 43 — Forces armées
1. Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnue par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
2. Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.
3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.
Article 44 — Combattants et prisonniers de guerre
1. Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse est prisonnier de guerre.
2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d’être considéré comme combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une Partie adverse, de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.
3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. Étant donné, toutefois, qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :
a) pendant chaque engagement militaire ; et
b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.
Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37, paragraphe 1 c.
4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre.
Article 45 — Protection des personnes ayant pris part aux hostilités
1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice. S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.
2. Si une personne tombée au pouvoir d’une Partie adverse n’est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu’il soit statué sur l’infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’état. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.
3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la Ive Convention a droit, en tout temps, à la protection de l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l’article 5 de la Ive Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.
Document No. 2 : Article 4 Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
ARTICLE 4 –
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d’une autorité non reconnue par la Puissance détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international ;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :
1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d'internement;
2) les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance protectrice.
Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l'égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu'il est prévu à l'article 33 de la présente Convention.
Document n° 3 : Mireille DELMAS-MARTY, Vers une communauté de valeurs ? Les forces imaginantes du droit, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p.59-62
La dénomination de « crime de guerre » postule une nette séparation entre la guerre et la paix, les ennemis combattants et les civils innocents ; or les nouvelles pratiques de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme remettent en cause une telle séparation.
(…)
En réalité, c’est tout le cadre juridique des opérations de maintien de la paix qu’il faudrait reconstruire. Qu’il s’agisse de l’enquête, de la collecte des preuves, voire de l’arrestation des suspects, le modèle procédural de la CPI serait beaucoup mieux adapté, d’autant plus que l’on se rapproche d’opérations policières, les militaires pouvant devenir témoins, ou même auxiliaires de justice, devant la justice pénale internationale. Mais ce modèle se heurte aux résistances politiques, notamment des Etats-Unis. De même en ce qui concerne la notion de suspect, écartelée entre le droit de la guerre et le droit pénal. Entre les ennemis combattants et les criminels non combattants, on voit en effet apparaître une troisième catégorie, celle des « ennemis combattants illégaux » (« unlawful enemy combattants »), esquissée par la jurisprudence américaine et explicitée par la Cour suprême d’Israël dans un arrêt de 2006.
C’est pendant la Seconde Guerre mondiale que la Cour suprême des Etats-Unis a utilisé cette expression à propos de saboteurs allemands arrêtés sur le territoire américain et jugés par une commission militaire. Elle précisait alors la différence : alors que les combattants légaux (lawful) bénéficient, lorsqu’ils sont capturés et détenus, du statut défini par le droit humanitaire comme celui de prisonniers de guerre, les combattants illégaux ont un statut hybride ; comme combattants, ils peuvent être capturés et détenus, et comme auteurs d’actes illégaux, ils peuvent être jugés et punis selon une procédure d’exception. En pratique, ils n’ont ni les droits des prisonniers de guerre ni les droits reconnus aux accusés dans un procès pénal. Il est vrai que la formule a été officiellement abandonnée par l’administration Obama et la catégorie de « unlawful enemy combattant » remplacée par celle de « unprivileged enemy belligerent » ; le Military Commission Act de 2009 a toutefois maintenu la procédure d’exception devant les commissions militaires.
Pour éviter de créer un statut de « hors-la-loi », la Cour suprême d’Israël a proposé une troisième catégorie qui échappe à la distinction combattants/non-combattants. Les juges, conscients de l’enjeu posé par cette pratique dite des « assassinats ciblés », selon laquelle les « combattants illégaux » n’auraient ni les droits des prisonniers de guerre – s’ils sont arrêtés, ils seront jugés comme criminels – ni ceux des civils – ils peuvent être tués sans jugement, comme des ennemis combattants, et la mort de civils innocents est admise comme « dommage collatéral » -, reconnaissent que le droit est particulièrement nécessaire en cas de guerre. Pour réintroduire une légitimité juridique, ils refusent de considérer à l’avance si tout assassinat ciblé est conforme ou non au droit international et apprécient chaque cas selon le principe d’équilibrage (balancing).
Mais en écartant le paradigme du crime de guerre la Cour suprême d’Israël a été amenée à esquisser, comme celle des Etats-Unis avant elle, un nouveau paradigme – celui de la guerre contre le crime – qui risque de brouiller la distinction entre droit pénal et droit de la guerre, et surtout de ruiner l’idée même de valeurs communes, y compris la dignité humaine, privée par le principe d’équilibrage de son caractère « interrogeable ».
Si le dépassement du paradigme du crime de guerre semble inéluctable, la solution qui consiste à renationaliser le droit applicable risque d’engager les États dans un processus régressif de vengeance en chaîne. Loin d’interdire ou de limiter l’inhumain en favorisant la construction de valeurs communes, le nouveau paradigme de la guerre contre le crime pourrait conduire à le légitimer.

